
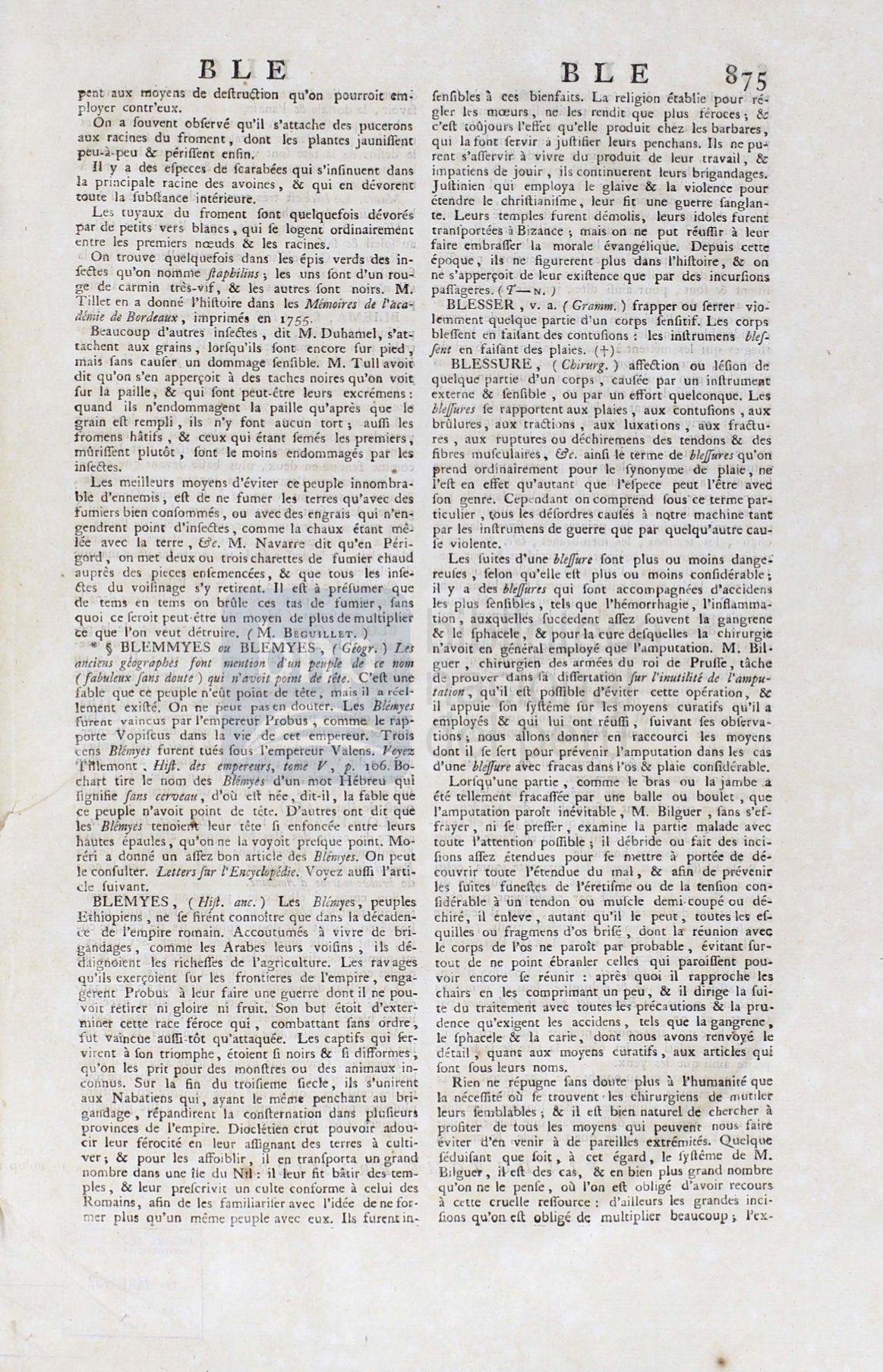
]'Cnt. aux moyens
p loyer contr'eux.
BLE
de
deíl:r~éti"on
c¡u'on pourroit i:m:
On
ª.
fouvenr obfervé qu'il
s'a~tache
eles pucerons
aux racrnes du froment, dont
les plantes jauniffrnt
peu-a-peu
&
péri!fent enfin.
H
y
~
des eíp.eces de foarabées qui s'in!inuent dans
la pri:1c1palc racrne des avoines,
&
qui en dévorent
tome
la fobftance interiéure.
L es
tu~aux
du froment font quelquefois dévorés'
par ele pet1ts vers blancs, qui fe logent ordinairernent
entre les premiers nceuds
&
les racines.
.,
On trouve quelquefois d ans ks épis verds des in·
feél:t:s qu'on nomme
flaphili11s
;
les uns font d'un rou::'
ge de carmín
ttcs-vif ,
&
les autres font noirs.
M i
Tillet en a donné l'hiíl:oire dans les
Mémoires de l'áca-,
dfmie
do
Bordeaux,
imprimés en 17 55.
B.:aucoup d'autr'es iníeél:es , dit M. Duhamel
1
s'at–
t achenr aux grains, lorfqu'ils font encore fur pied,
m ais fans cauíer un dommage fenfible. M . Tull avoit
<lit qu'on s'en
apper~oit
a
des t aches naires qu'on voit
for la paille,
&
qui font peut-etre leurs excrémens:
quand
ils n'endommagent la paille qu'apres que
le
grain eíl: rernpli , ils n'y font aucun tort ; auffi les
fromens hatifs ,
&
ceux qui étanr femés
les premiers,
muri!fent plutót '
font
le
moins endommagés par les
iníeél:es.
•
Les meilleurs moyens d'évirer ce peuple innombra–
l:>le d'ennemis, eíl: de ne fumer les terres qu'avec de_s
fumiers bien confommés, ou avec des engrais qui n'en·
gendrent point c\'infeél:es' comme la chaux étant me
lée avec Ja terre,
&c.
M. Navarre dit qu'en Péri–
gord , on met deux ou trois charettes de fumiér chaud
a u pres des pieces enfemencées,
&
que tous
les infe–
él:es du voilinage s'y reti rent. Il eíl:
.a
préfumer que
d e
tems en rems on brille ces
tas ele
fumier, fan s
quoi ce íeroit peut·etre un moyen de plus de multiplit:r
te que l'on veut détru ire.
(
M. BEGU!l.LET. )
*
~
BLEMMYES
ou
BLEMYES ·,
(
Géogr.) Les
ancims géogrophes
font mention
d'tm
peuple de
ce
no111
( fabuleux fans doute
)
qui n'avoit point de téte.
C'eíl: une
fa ble que ce pcuple n'eut point de tete, mais il
::i
réel–
lement ex iíl:é. On ne peut pasen douter. Les
Blémyes
furent vainc us p ar l'empereur Probus , comme le r-ap·
porte Vopifcus dans la vie de cet emptreur. Trois
cens
Blémyei
forent tués fous l'empereu r Valens. //
oyez
T l'llemont •
Hifl.
des empereurs,
tome
V,
p.
1i:>6. Bo–
chart tíre
le
norn des
Blimyts·
d'un mot Hébreu qui
fignifie
f ans cerveatt,
d'ou
elt
née, dit-il, Ja fable que
ce peuple n'avoit point de rece. D 'amres ont die qúc
les
Blémyes
tenoient leur tete
li enfoncée entre · Jeurs
hautes épaules , qu'on ne la voyoit preíque point. Mo·
réri a donné un afTez bon article des
Blémyes.
On peut
le
confulter.
Letters far
l'Encyclopidie.
Voyez auffi l'arti–
clt: fuivant.
BLEMYES, (
Hijl. anc.
)
Lés
Blémyes ,
peuples.
Ethiopiens , ne fe firént conn o!tre que dans la décaden–
c.'é
de l'elnpire romain. AcCOllturnés
a
vivre de bri–
t andages , comme les Arabes leurs voilins ,
ils dé–
d:tignoienr
les richeffes de l'agricultl1re. Les ravages
qu'ils exen; oient íor les
frontieres de l'empire, enga–
gerent P robus
a
leur faire une g uerre dont,il ne pou–
voit rétlrér ni gloire ni fruit. Son but etoit d'exter·
tniner cette race féroce qui , combattant fans ordre,
fut
v ai'ncoe ádffi-tót qu'attaquée. Les captifs qui kr–
v ircnt
a
fon triomphe, étoient fi noirs
&
¡¡
difformes;
qu'on les prit pour des moníl:res ou des animaux in–
connus. Sur la fin du rroi!ieme !iecle, ils s'unirent
au x Nabatiens qui, ayant le memi:
pencha.ntau bri·
gañdage , répandirent la cooíl:ernation dans plulieurs
provinces de l'empire. Dioclétien crut pouvoii' adou·
cir ltur fé(ocité en
leu r affignant des terres
a
c.ulri–
ver;
&
pour les affoiblir, il en tranfporta un grand
nombre dans une
?le
du Nil: il leur
fit
barir des tem–
p les,
&
leur prefcúvit un cu he conforme
a
celui
des
Romains, afin de les familiarife r avec l'idée de ne
fo~mer p lus qu'un meme peup le avec eux. lis forcnt in.:
B L E
875
frnlibles
a
ces bienfairs. La religion étabiie pour ré–
g ler ks mceurs, ne les rendit que plus féroces;
&
c'eít toujou1's l'effet q u'elle produit chez les barbares,
qu i la font fer.vir
á
ju!l:ifier leurs penchans. lis ne pu•
rent s'aíl'ervir
a
vivre du produit de leur travail,
&
imp~ti.ens
de jouir , ils
concinu~rent
leurs brigandages.
J
uíl:Jmen qut employa
Je
gla1vc:
&
la violence pour
étendre le chriíl:ianifme, leur
fit
une gucrre fanglan·
te. Leurs temples furent démolis, Jeurs idoles furent
trant"portées
a
Bizance ; mais on ne put nfoffir
a
leur
faire embrafTer Ja morale évangélique. Depuis cette
époq ue, ih ne figurercnt plus dans l'hiíl:oire,
&
on
ne
s'apper~oit
de kur ex iíl:.ence que par des incurfions
palfageres.
(<J.'-
N.
)
BLESSER, v. a.
(
Gramm.)
frapper ou fer-I'er
vio~
lemment quelque partie d'un corps frn!itif. Lt:s corps
ble!fent en faifant des contulions ( les in!trumcns
blef-
fant
en faifant des plaies.
(t ) ~
•
l
BLESSURE, (
Chirnrg.
)
affeél:ion eu lé!ion de
quelque partie c\'un corps , caufée par up
iníl:rume~t
externe
&
fenlible , ou par un effort qudconque. Les
blef!ures
fe rapportent aux plaies , aux é:ontufions , aux
brulures, aox traél:ions , aux luxations, aúx fraél:u·
res , aux ruptures ou déchiremens des tendons
&
des
fib res muíc u\aires ,
&c.
ainli
J~
térme de
blef!ures
qu'on
p rend ord inairement pour le
fynonyme de plaie, ne·
l'eíl: en effet qu' autant que
l'éípece peut !'erre avec
fon genre. Ccp.,ndant on comprtnd fous"ce terme par–
ticu \ier ,
~bus
les défordres catites
a
nqtre machi ne tant
par les lníl:rumens de guerre que par quelqu'autre cau–
fe violente.
Les fuices d'une
ble.f!ure
font plus ou moins
dange~
reufes , felon qu'elle eíl: plus ou moins con!idérable;
il y a des
ble.f!ures
qui font accompagnées d'accídens
les plus frn¡ioles, tels que l'hémorrhagie, l'inflamma–
rion, auxquelles fuccedent a!fez fo1.<vent
la gangrene
&
le fphacele,
&
pour la cure defquelles la chirurgie
n'avoit en général employé que l'ampmation. M. Bil·
guer , chirurgien des armées du roí de Pruffe, tache
d~
prouver dans
ía
difTertation
fur l'inutilité
de
l'ampu–
tation,
qu'il ' eíl: pdíllble d'évirer cette opération,
&:
il appuie fón 'íyíl:eme fur 1es moyens curatifs qN'il a
employés
&
.qui lui ont réuffi,
fuivant fes obft:rva·
tions ; nous allons donner en
raccourci
les moycns
dont il fe fert pour prévenir l'a(Tlputation dans les cas
d'une
blejfure
a ec fracas dans l'os
&
plaie confidérable.
Lorfqµ'une partie , . cornme
le
oras ou la jambe a
été tellement f.racaífée par une baile ou boulet , que
l'amputation paro!t inevitabfe, M. Bilguer , fans s'ef.
frayer, ni
fe
prelfer, examine la partie lllalade avec
tou te l'attention poffible; il débride ou fait des inci–
fi ons a!fez .étend ues pour fe
rnettre
3.-
portée de dé–
couvrir
tome
\'étendue du mal,
&
afin de: préveni r
les fuites fune(\es de l'éretifme o.u de la teFtlion con·
f¡d érable
a
un tendon O\l mufcJe demÍ-COUpé
Oll
dé·
ch iré, il eoleve , autant qu'il
Je
pellt ,. mutes les ef–
quilles ou fragmcns d'os br-ifé , dont hr réunion avec
Je
corps de l'os ne paroit par probable , évitant fur–
tou t de ne point ébraoler celles qui paroilfent pou–
voir encore
fe
réunir : apres quoi il
rapprocl~e
les
chairs en les comprimant un peu,
&
il dirige la fui·
te du traitement avea toutes
le5
préca·utions & la pru–
dence qu'exiaen.t les accidens, tels que la gangrene•
Je fphacele
&
la carie , dont nous avoos
renvo~é
Je
détail , quani aux- rnoyens cmatifs , aux articles qui
fonr fo us leurs noms.
Ríen ne r-épugne fans detite plus
a
l'humahité que
la néceffité eu fe trouvent . les chirurgiens de mutiler
leurs femhlables ;
&
il eíl: bien naturel de cbercher
3.–
profiter de tous les moyens qui peuvent nous faire
éviter d'en venir
a
de pareilks extrémités. Quclq ue
féduifant que foit ,.
a
cet égard, le fy freme de M.
Bilgue'l , il-e!l: des cas,
&
en bien plus g ran? nombre
qu'on ne le penfe, ou l'on efr obligé d'avoir
r~c~m~s.
a
cette cruelle relfource : d'ai lleurs les grandes 1nc1•
fi.ons
qu~on
dl:
~pligé ~<;
multiplier beaucou¡:i; 1'ex.-
















