
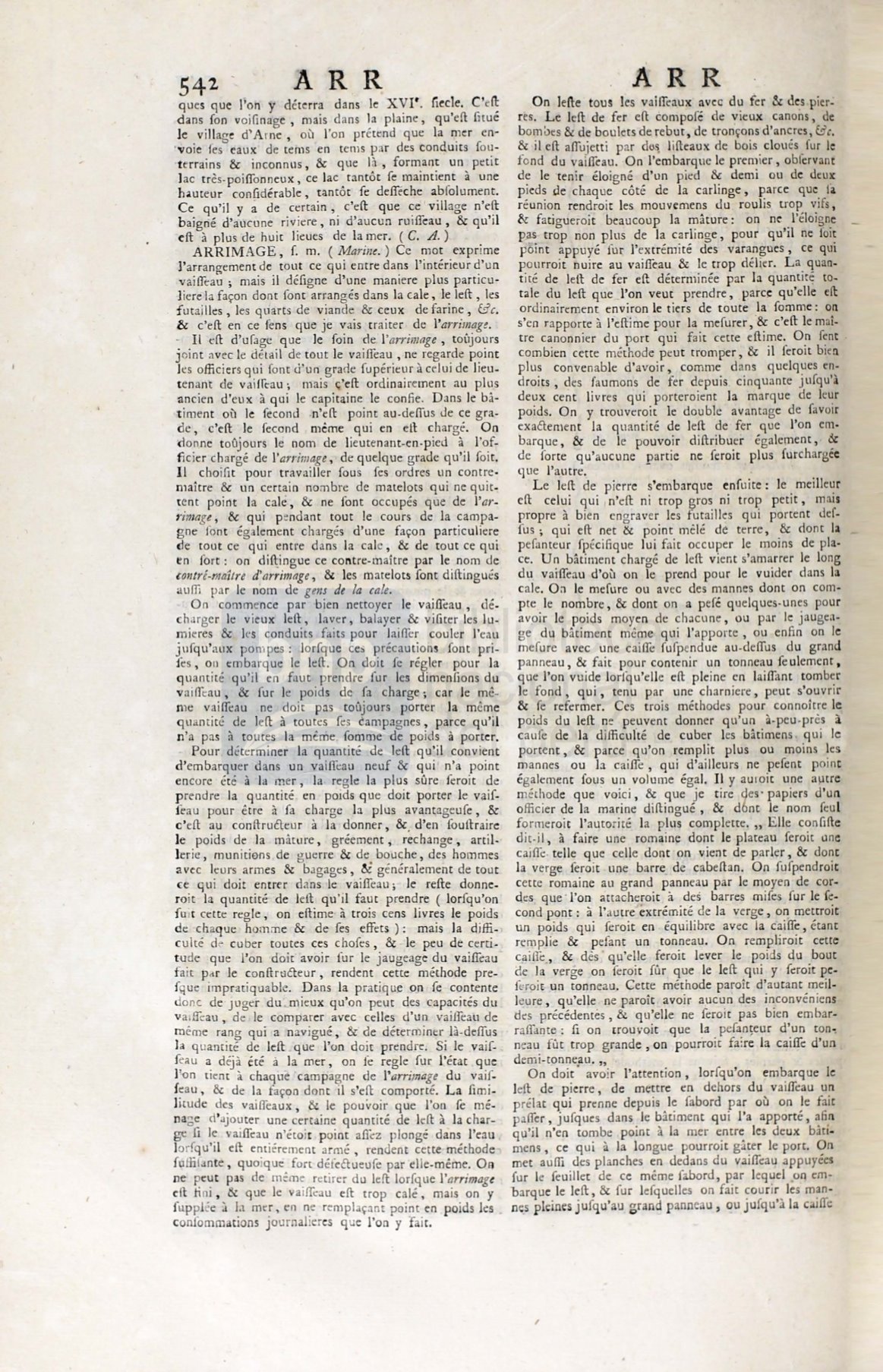
54
2 -
ARR
ques que l;on
y
déterra dans le XVI'. liecle. C'dl:
dans fon voifi nage , mais dans la plaine, qa'e!l licué
Je
village d'Arne , ou
l'on prérnnd que la mer en–
·voie fes caux de terns en
tems par des concluics fou–
t errains
&
inconnus,
&
que la , formant un petit
lac tres- poitTonneux, ce lac rantót fe maimienc
a
une
hauteur conlidérable, tantót fe deJféche abfolument.
Ce qu'il y a de certain, c'eíl: que ce village n'eíl:
baigné d'aucune riviere , ni d'aucun ru iffeau ,
&
qu'il
dl:
a
plus de huir lieues de lamer. (
C.
A.
)
ARRIMAGE, f. m. (
Marine.
)
Ce mot exprime
l'arrangement de tour ce qui entre dans l'intérieur d'un
vaiffeau ; mais il déligne d'une maniere plus particu–
l iere la
fa~on
done font arrangés dans la cale, le leíl:, ks
futai lles, les quarts de viande
&
ceux de farine ,
&c.
&
c'eíl: en ce fens que je vais traiter de
l'arrimage.
-
Il eíl: d'ufage q ue
le foin de
l'arrimage,
toüjours
j oint avec le détail de tout le vaiffeau, ne regarde point
ks officiers qui font ci'un grade fupérieur
a
cdui de lieu–
tenant de vaiffcau; mais <;'eíl: ordinairement au plus
ancien d'eux
a
qui le capitaine le confie. Dans le ba–
t imenc ou le fecond
.n'dl: point au.deffus de ce gra–
de, c'eíl:
le fecond meme qui en ell:
charg~.
On
<lon ne toOjours le nom de lieutenant-en-pied
a
l'of–
fic ier chargé de
l'arrimage ,
de quelque grade qu'il foit.
11
choilit pour travailler fous
fes ordres un contre·
maitre
&
un certain nombre de matelots qui ne quit.
rent point la cale,
&
ne font occupés que de
l'ar–
rimage ,
&
qui pendant tout le cours de la campa–
gne íont éga lement chargés d'une
fa~on
particuliere
<le rout ce qui entre dans la cale,
&
de tout ce qui
en
fort: on diíl;ingue ce contre-maitre par le nom de
contré-maltre d'arrimage,
&
les marelots font diíl:ingués
auffi par le nom de
gens de la cale.
On commence par bien nettoyer le vailfeau , dé–
charger le vieux letl:,
laver , balayer
&
viliter les la–
mieres
&
k-s conduirs faits pour Jaiffer couler l'eau
j11fqu'a11x pompes: lorfque ce:; précautions font pri–
fes , on embarque le leíl:. On doit fe régler pour la
q11antité qu'il en fuut prendre fur les dimenlions du
vaiffeau,
&
fur
le
poids de fa charge; car Je me–
me vaiffeau
ne doir pas rot1jours poner
la meme
qu antité de leíl:
a
toutes fes campagnes, parce qu'il
n'a pas
it
tomes la meme. fomme de poids
a
porter.
Pour déterminer la quancité de leíl: qu'il conv ient
d'embarq uer dans un vaitTeau neuf
&
qui n'a point
encore éeé
a
la mer, Ja regle la plus sure feroit de
p rendre la quantité en poids que doit ¡iorter le vaif–
feau pour etre
a
fa
charge
la plus avantageufe'
&
c'eíl: au confhuél;eur
a
la donner'
& .
d'en fouíl:raire
le poids de Ja mature' gréement' rechange, artil–
Jerie , munitions de gue rre
&
de bouche , des hommes
a
vec
leurs armes
&
bagages,
&
généralement de tout
ce qui doit encrer dans le vaitTeau ;
le
reíl:e donne.
roit la quantité de leíl: qu'il faur prendre ( lorfqu'on
fo 1 cette regle, on eftime
a
trois cens livres le poids
de chaquc homme
&
de fes elfets ) : mais la diffi–
culté d cu ber routes ces chofes,
&
le peu de certi–
t ude que l'on doie avoir fur
le
jaugeage du vaiJTeau
fait p•r le conft rnéteu r, rendent cette méthode pre–
fque impratiquabJe. Dans la pratique on
fe
contente
onc de JUger du mieux qu'on peut des capacités du
va1lfeau , de le comparer avec celles d'un vai/feau de
méme rang qui a n vigué ,
&
de dérermincr H-detTus
la quantité de leíl: que l'on doit prendrc. Si le vaif–
feau a déja été
a
la rner, on
le
regle fur l'écae que
l'on tiene
a
chaque campagne ele
l'arritnage
du vaif–
f~au ,
&
de la
fa~oo
done il s'eíl: comporté. La limi–
l1tude
d~s
vaiffeaux,
&
le pouiroir que l'on fe mé–
na;;e
cl'ajo~cer
une certaine quantité de leíl:
a
la char–
ge
fi
I~
vaiJTeau n'étoit point alI"c:z plongé dans l'eau
lorfqu'1 l eft entiérement armé , rendent cette méthode
fofli íante , quoique fon défeétueufe par elle-méme.
ÜR
ne
~e~t
pas de rnémc: rctirer du leíl: lorfque
l'arrimage
cft
h 111 ,
&
que le va1/fc:m eft rrop calé, mais on y
fup~lée
:i
l_a mr:, en n.e
rempla~ant poi~t
en poids les
confommac1ons JOurnaheres q e l'oa y
t:
ir.
ARR
On !elle tous les vaiffeaux avec du fer
&
des pier–
res. Le leíl: de fer eíl: compofé de vieux canons, de
bomaes
&
de boulets de rebut, de
tron.~ons
d'ancres,
&c.
&
il eíl: atTujetti par dllS. liíl:eaux de beis cloués fur le
fond du valffeau. On !'embarque le premier, obii:rvanc
de le ·1enir éloigné d'un pied
&
demi ou de deux
pieds de chaque cóté de
la carlinge, parce que
la
réunion rendroit les mouvemens <lu
roulis trop vifs,
&
fatigueroit beaucoup la matare: on ne
l'éloigne
Pi!5 trop non plus de la carlinge, pour qu'il ne loit
point appuyé fur l'ex trémité des varangues , ce qui
pomroit nuire au vaiffeau
&
le rrop déli r. L a quan–
tité de lell: de fer efl: déeerminée par la quantiré to–
tale du leíl: que l'on veut prendre, pare' qu'elle eft
ordinairement environ le riers de toute la fomme: on
s'cn rapporre
a
l'cíl:ime pour la mefurer,
"&
c'eíl: le mai–
trc canonnier du port qui fait cette eaime. On fent
combien cene méchode peut tromper,
&
il feroit bien
plus convenable d'avoir, comme dans quclques en–
droi ts , des faumons ele fer depuis cinquante jufqu'ii
deux cent livres qui porteroient la marque de leur
poids. On
y
erouveroic
le double avantage de favoir
exaétement la quantité de leíl: de fer que l'on em.
barque,
&
de
le pouvoir diíl:ribuer égale¡nent,
&
de forre q u'aucune partie ne íeroit plus furchargéc
que l'amre.
-
Le leíl: de picrre s'embarque enfuite: le meilleur
eíl:
celui qui n'eíl: ni trop gros ni trop petit, mais
propre
a
bien engraver les futailles qui portent def–
fus; qui eíl: net
&
point melé de terre,
&
done la
pefanteur fpécifique lui fait occuper le moins de pla–
ce. Un batiment chargé de leíl: vier.t s'amarrer le long
du vaiffeau d'o\1 on le prend pour
le
vuider dans la
cale. O:i le mefure ou avec des mannes dont on com–
pte le nombre,
&
dont on a pefé quelques-unes pour
avoir le poids moyen de chacune, ou par
le
jaugea–
ge du batiment meme qui l'apporte ,
OU
enfin on Je
mefure avec une cailfe fufpendue au-de!Tus du grand
panneau,
&
fait pour contenir un ton neau fe ulemenr,
que l'on vuide Jorlqu'elle eíl: pleine en laiffant tomber
le
fon<l, qui, tenu par une charniere, peut s'ouvrir
&
fe refermer. Ces trois méthodes pour connoirre le
poids du left ne peuvene donner qu'un a-pcu-pres
a
caufe de
la difficufté de cuber les bacimens qui le
portent,
&
parce qu'on remplit plus ou moins
le
mannes ou
il
caitTe, qui d'ailleurs ne pefent point
également fous un vol ume égal.
11
y au1 oit une aurre
méthode que voici ,
&
que je tire ejes· papiers d'un
officier de Ja marine diíl:ingué ,
&
d6nt
Je
nom feul
formeroit !'autoricé la plus complette. ,, Elle confifte
dit-il ,
a
faire une romaine done le plateau feroic une
caifl"c. telle que celle done on vient de parler,
&
done
la verge feroit une barre de cabeíl:an. On fufpendroit
cette romaine au grand panneau par
le
moyen de cor–
des que · J'on arracheroit
a
de5 barres mifes fur
Je
fe–
cond pont :
a
l'au tre exerémité de la verge , on mettroit
un poids qui feroit en équilibre avec la caiffe , étant
remplie
&
pefant un
tonneau. On rempliroit cetre
cailli:,
&
des q u'elle feroit lever
le
poids du bout
de la verge on feroie fUr que le leíl: q11i y fc:roit pe–
feroit un tonneau. Cctte méthode parolt d'autant meil–
leure , qu'elle ne paroit avoir aucun des inconvéniens
des précédentés ,
&
q u'elle ne feroit pas bien emhar–
ratTante :
n
on crou ·oit que la
pefan~eur
d'un ton–
neau fUt trop grande , on poufroit fa:re la caiffe d'un
demi-ronne!lu. ,,
On doit avoir l'attention, lorfq u'on embarque le
Ieíl: de pierre, de mettre en dehors du vaiffeau un
prélat qui prenne depuis le fabord par ou on le fait
paffer , jufqucs dans le b:i.timent qu i l'a apporté, afin
qu'il n'en tombe point
a
la mer entre les deux bau–
mens , ce qui
a
la longue pourroit gater le port. On
met auffi des planches en dedaos du vaiffeau appuyées
fur le feuillet de ce méme fabord, par lequel on em–
barque le left,
&
fur lefquelles on fait courir les man–
n _s plcines juli u'a\I grand panne u, ou jufqu'l la
e
iffe
















