
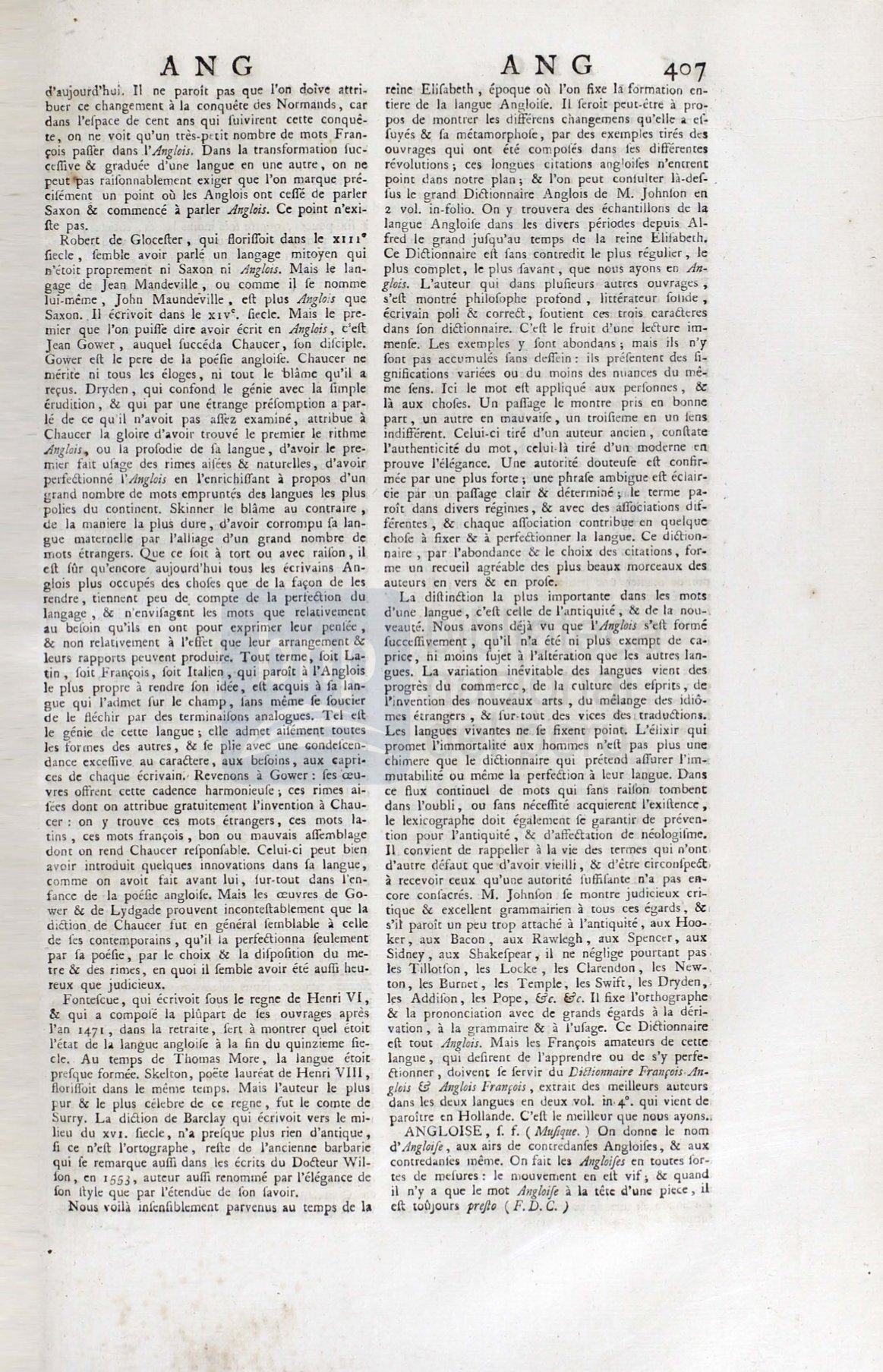
ANG
d'aujourd'hu~.
II ne paroit pas que l'on d.olve attri–
bucr ce cbangement
a
la conquete des Normands, car
dans l'efpace de cent ans qui fuivirent cette conque–
te, on ne voit qu'un tres-petit nombre de rnoes Fran–
~is
paíler dans
-1'.Anglois.
Dans la transformatioo fuc–
cdlive
&
graduée d'une langue en une autre, on no
peut l>as raifonnablemeot exiger que l'on marque pré–
cifémen~
un point ou les Anglois oot ceJfé de parler
Saxon
&
commencé
a
parler
Anglois.
Ce point n'exi–
fie pas.
Robert de Gloceíl:er, qui fioritToit dans le
XI
r
1°
íiecle, femble avoir parlé un
laogage mitoyen qui
n'étoi t propremerit ni Saxon ni
/111glois.
Mais
k
lan–
gage de Jean Mandeville, ou comme ij fe nomme
lui-meme, Jobn Maunde-ville •
efl:
plus
Anglois
que
Saxon. .
ll
écrivoit dans le x
1
v°. liecle. Mais
le
pre–
mier que l'on puifü: dire avoir écrit en
Anglois,
c'eíl:
Jean Gower , auquel fuccéda Chaucer , fon difciple.
Gower
di:
le pere de: la poélie angloife. Cbaucer ne
mérit'e ni tous les éloges, ni touc
lt:
'blame qu'il
a
r~~us.
Dryden, qui coafond le génie avec lá limpie
érudition,
&
qui par une énange préíomption a par–
lé
de
ce qu 'il n'avoit pas affrz examiné, ami bue
a
Chaucer la gloire d'avoir erouvé le prernier
le
riehmc:
./fnglois.,
ou la profodie de
fa
langue, d'avoir le pre–
rr.ier fait ufage des rimes aifées
&
naturdles, d'av oir
perfeél:ionné
l'
/lnglois
en l'enrichill'ant
a
propos d'un
grand nombre de moes empruntés des langues les plus
polies du continent. Skinner le blame au contraire ,
de la maniere la plus dure, d'avoir corrompu
fa
lan–
gue maternelle par l'alliage d'un grand nombre de
mots étrangers.
~e
ce foic
a
eort ou avec raifon, il
dt
fur qu'encore aujourd'hui tous les
écrivains An–
glois plus occupés des chofes que de la faY.on de les
rendre, tiennent peu de. compte de la perfeél:ion du
langage ,
&
n'envifagtnt les mots que relacivement
au befoin qu'ils en ont pour exprimer leur penlee ,
&
non relativement
a
l'effe t que leur arrangement
&
leurs rapports peuvent produ\re. Tout terme, foit La–
tin, foic
Fran~ois,
foit Italien, qui paroit
a
l'Anglois
le pfus propre
a
rendre fon idée' eít acquis
a
fa
lan–
gue qui l'admet fur le champ, fans meme
fe
foucier
de
le
fléchir par des terminaifons analogues. Tel
di:
le génie de cene langue ; elle admet aiférnent toutes
ks formes des autres,
&
fe plie avec une Gondefcen–
dance exceffive. au caraél:ere, aux befoins, aux c:apri·
ces de chaque écrivain.' Revenons
a
Gower: fes 'reu–
vres offrent cette cadence harmon ieufe; ces rimes ai–
lees dont on attribue gratuitemenr l'invention
a
Chau–
cer : on
y
trouve ces mots étrangers , ces mots la–
tins , ces mots
fran~ois
, bon ou mauvais affemblage
done un rend Chaucer refponfable. Celui-ci peut bien
avoir introduit quelques innovations dans
fa
langue ,
comme on avoic fait avant lui, fur-tout dans l'en–
fance de la poéúe angloife. Mais les reuvres de Go–
wer
&
de Lydgade pro uvent inconteítablement que la
d iébon . de Chaucer fut en général fernblable
a
celle
de fes coneemporains, qu'il la perfeétionna feulement
par
fa
poélie , par le choix
&
la difpofition du me–
tre
&
des ri01es, en quoi il femble avoir été auffi heu–
reux que judicieux.
Fontefcue, qui écrivoit fo':1s le regne de Henri
VI,
&
qui a compoíé la plupart de fes ouvrages apres
l'an
147 [ '
daos la retraite' fort
a
montrer quel étoi t
l'état de la langm: angloife
a
la fin du quinzieme fie–
cle. Au temps de Thomas More, la langue étoit
prefque formée. Skt:lton, poCte laurfat de Henri
VI II,
fioriífoit dans le méme eemps. Mais l'aueeur le plus
pur
&
le plus cékbn:
de
ce regne , fot le cornee de
Surry. La diél:ion de Barclay qui écrivoit vers le mi-·
lieu ·du
xv
1.
fiecle, n'a prefque plus rien d'antiqm:,
fi ce n'eíl: l'ortographe , reíte d" l'ancienne barbarie
qui fe remarque auffi dans les écries du Doél:eur Wi l–
fon, en
1553 ,
auteur aulfi renommé par l'élégance de
fon
llyle que par l'étendüe de fo n favoir.
Nous ,·oila infonfibkment parvenus au temps de la
A N G
407
reine EJiíabeth , époque ou l'on fixe la formation en–
tim: de la lan gue Angloife.
11
'feroit peue-étre
a
pro- ..
pos de montrc:r ks différens change.mens qu'elle a el:.
fuyés
&
fa
métamorphofe, par des exemplc:s tirés des
ouvrages qui ont été compot'és dans les différenres
révolmions ; ces longues ci tations angloifes n'entrenc
point dans notre plan;
&
l'on peut contulter la-def–
fus le grand Diélionnaire Anglois de M. J ohnfon en
2
vol.
in-folio. On
y
trou vera des échantillons de
l~
langue Angloife daos
les divers périodc:s depuis Al–
fred
le
grand jufqu'au temps de
la rtine Elifabeih.
Ce Diél:ionnaire
di:
fans comredit le plus régulicr, le
plus complct, le plus favant, que not1s ayons en
An–
glois.
L'auteur qui dans plufic:urs autres ouvrage
,
s'eít montré philofophe profood ,
lirtérateur folide ,
frrivain poli
&
correét, foutien t
Cl!S
trois caraél:eres
daos fon diél:ionnaire. C'dl
le
fruit d'une lcél:un: im–
menfe. Les exemplrs
y
font abondans ; mais
ils
n'y
font pas acct1:nulés
fan~
deJfein : ils préfentent des li–
gnifications variées ou du moins des nuances du mé–
me fens. Jci
le mot
efl:
appliqué aux perfonnes,
&
la aux chofes. Un paffage le monere pris en bonne
part, un autre en mauvaife, un troifieme en uo fens
indifférent. Celui-ci tiré d'un auteur ancieo, coníl:ate
l'auehenticité du mot, celui-la tiré d'un rnoderne
en.
prouve l'élégance. U ne autoricé douteufe eít confir–
mée par une plus forte; une phrafe ambigue eíl: éclai r–
e>ie pár un palfage clair
&
détt:rmi:ié;
,,k
terme pa–
roit dans divers régimes,
&
avec des alfoCiations dif–
fércntes,
&
chaque alfoc iation conerib1,1e on quelque
chofe
a
fi.xer
&
a
perfeél:ionner la langue. Ce
d
ifrion–
naire , par l'abondance
&
le clioix des citaeions, for–
me un recueil agréable des plus beaux morcc:aux des
auteurs en vers
&
en profe.
La diíl:inél:ion la plus importante dans les mots
d'une langue, .c'eíl: celle de l'antiquité,
&
de la nou-"
veauté. Nous avons déja vu que
l'Anglois
s'eít formé
fuccdlivement , qu'il n'a été ni plus exempc de ca.
price' ni moins fujet
a
l'altération que ks autres lan–
gues. La variation
inévitable des
langues vient des
progres du commercc, de la culture des efprits, de
l'invention des nouveaux ares , du mélange des idio.
mes
étrangers ,
&
'fur.tout des vices des 1traduél:ior.s.
Les langues vivantes ne fe fixent point. L'élixir qui
promet l'immortalité aux hommes n'eíl: pas plus une
chimerc que le diél:ionnaire qui préeend affurer l'im-.
murabilité ou rnéme la perfeél:ion
a
leur langue. Dans
ce flux continuel de mots qui
fa ns raiJbn
tombenc
daos l'oubli, ou fans néceffité acquieren,t l'exiíl:ence,
le lexicographc doit également fe garantir de préven–
tion pour l'antiquité ,
&
d'affeél:ation de néologifme.
ll .
convient de rappeller
a
la vie dc:s rermes qui n'ont .
d'aurre défaut que d'avoir vieilli,
&
d'etre circonfpeét,
a
recevoir ceux qu'u oe aucorité fuffifante n'a pas en–
core coaíacrés. M. J ohnfon
fe montre judicieux cri–
tique
&
excellrnt gramrnairien
a
cous ces égards,
&1
s'it paroic un peu trop attaché
a
l'antiquité, aux Hoo–
ker, aux Bacon , aux Rawlegh , aux Spenctr, aux
Sidney, aux Shakefpear
1
il ne néglige pourtaot pas ·
les Tilloefon, les Locke , les Clarendon, les New- ,
ton, les Burnet, les Temple, les Swift, les Dryden,
J~s
Addifon, les
Pope,
&c. &c.
Il
fixe l'orthographe
&
la prononciation avec de grands égards
a
la déri- .
vation ,
a
la grammaire
&
a
l'ufage. Ce Diétionnaire
c:ít touc
Anglois.
Mais les
Fran~ois
amateurs de cene
langue , qui defirent de l':ipprendre ou de s'y perfe–
élionner, doiven t fe ferv ir du
Diftio11naire Franrois.
./111-
gloís
&
Anglois Franfois,
exrraic des meilleurs autcurs
daos les deux langues en deux .vol. in.
.¡.º.
qui vient de
paroitre en H ollande. C'eíl: le meilleur que nous ayons..
ANGLOISE,
f.
f. (
Mu.fique.
)
On donnc le nom
d'/Jngloife,
aux airs de conrredanfes AnO'loifes,
&
aux
coneredanfes meme. On fait
les
./lngloije':
en toutcs for–
tes de
~efures:
le
mouvement en
ell:
vif;
&
quand
il n'y a que
le
mot
Angloife
a
la tete d'une piece , il
d\:
tOÚJOUrs
prej/o (F. D. C. )
















