
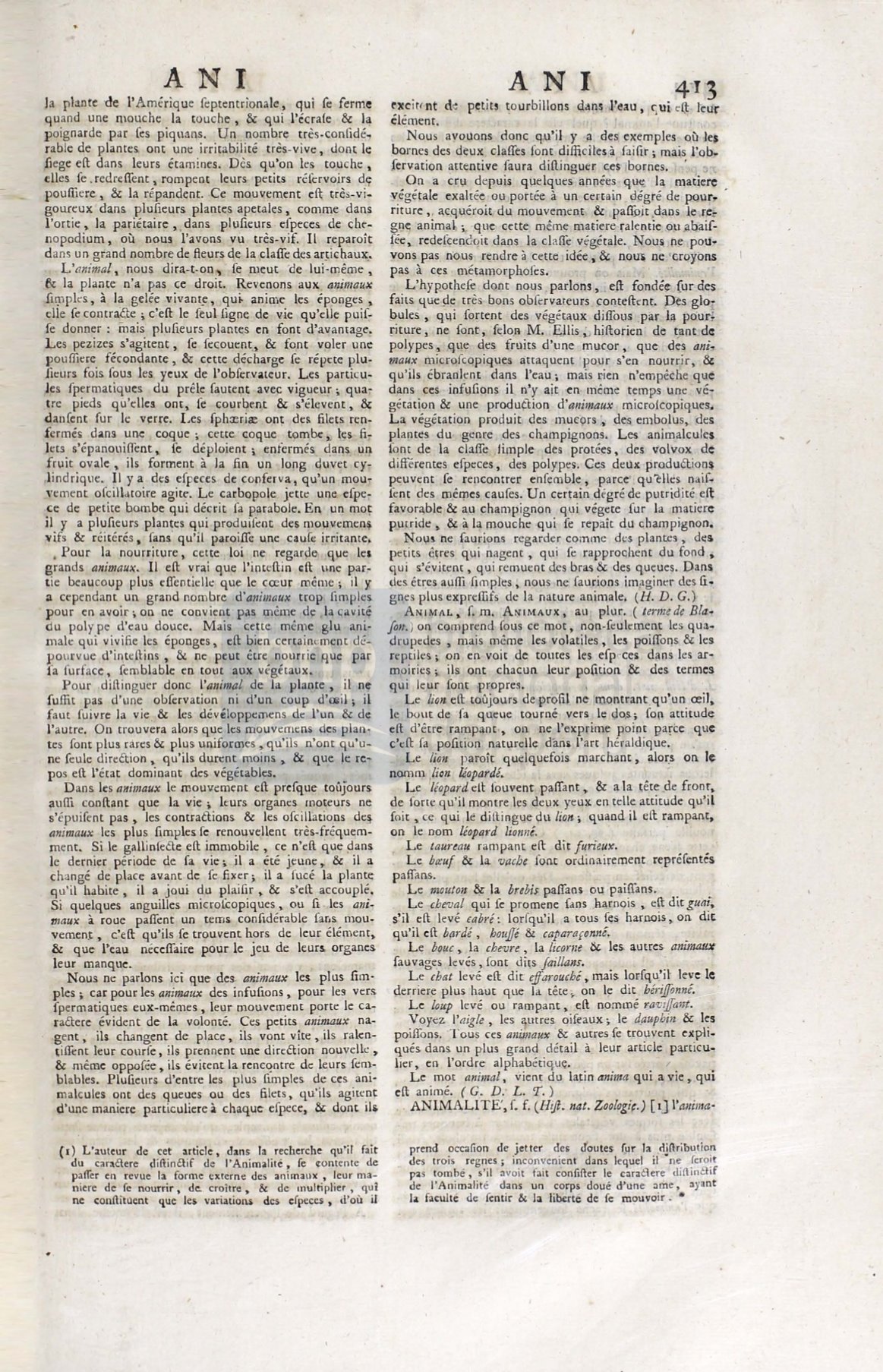
A NI
la plante -de l'Amérique feptentrionale, qui fe ferme
quand une mouche la touche,
&
qui l'écra!e
&.
l<i
poignarde par frs piquans. Un . nombre tres-confidé,
rab ie de plantes ont une irritabilicé tres-vive, dont le
fiege eft dans leurs étarnines. Des qu'on les touche,
elles fe . rcdrelTent, rompeot leurs petits rélervoirs di;
pau!Iiere,
&
la répandent. Ce mauvement eíl: t;res-vi–
goureux dans. plufieurs. plantes apetales, comm<;: dans
l'ortie. la pari¿taire,, dans plufieurs. efpeces de cht–
nopodium, ou nous l'avons vu tres-vi.t".
II
reparoit
d ans un grand nombre de fieurs de la clalTe d,es
aqichau~.·
L'animal,
naus dira-t-on
~
fe meut 'de lui-meme,
&
la plante n'a pas ce droit. Revenons al)x
animaux.
fiippk&,
a
la gelée vivant_!!'
qu~
anime les éponges '
elle fe
contrae.te;. c'eíl: le feul ligne de vie qu'elle puif–
fe
donner : mais plufi.eurs plantes en font d'avancage.
Les pezizes s'agitent, fe fecouent,
&
foot valer une
pouffierc fécondante,
&
cette qécharge fe répete plu–
fü:urs fois íous les yeux de l'obfervateur. Les particu–
les fpermatiqucs du prele fautent
a.v~ vigue~¡.r;
qua;
tre pieds q
ú'dles.
onc, fe courbent
&
s'élevent,
~
clanfent fur le
v~rre.
Les fphxfill!
on~
des filets ren–
fermés daos une coque ; cene eoque tombc: •) les fi–
ltts s'épanouiífent • fe déploient ; enfermés_ daos un
fruit ovale, ils forrnent
a
la fin un long cjuvet
cy–
,lindrique.
11
y
a des efpeces de copforva; qu\un mc:iu–
vemeot oícilldtoire agite. Le carbopole
jettc:
une
efpe~
ce de petite hambe qui décrit fa parabole. En un moi:
il y a plufieurs plantes qui produifent des
mou\!emen~
"1ifs
&
réitérés • fans' qu'íl paroiJTe
~ne
cau(e jrritante,
• Paur la nourriture, cette . loi ne
regarp~
.que
les.
graods
animaux.
II dt
vrai que l'ínteftin
,ft
une par–
tie beaucoup plus elfeotielk que le cceur mcime; il
y
a
cependant un grand nombre
d'animaux
trop ftmples.
pour en avair; an ne coov ient pas meme
d~ .
la c;avit,é
du poly pe d'eau douce. Mais cette men1e glu aní–
male qui vivifie les éponges,
eíl:
bien cert,ain .ment dé–
pourvue d'intefrins
>
&
ne peut etre nourrie ijUe par
fa
furface, femblable en
tol:it
aux 11égétaux. .
Pour difii11guer done
!'animal
de la pla11te , il ne
fuffit pas d'une obfervation ni d'un coup
d'~il
;
i~
faut fuivre la vie.
&
les dévéloppernens de l' un
&
de
l'autre. On trouvera alo•s que
les
mouvemens des plan.
tes font plus
rá~es
&
plus uniformes• qu'ils n'ont qu'u–
ne feule directioh • qu'ils durent moins •
&
que le re–
pos e(t l'état dominant des végétables.
Daos les
a11imaux
le
mouvement efr prefque toüjours
au!Ii coaíl:ant que la vie
>
kurs organes. moteurs ne:
s'épuifent pas • les cootrnB:ions
&
les ofcilfatioos dq
animaux
les plus Jimple& fe renouvellent tres-fniquem–
ment. Si le galliníééte efr immobile , ce n'eíl que
pan~
le
demier période de
fa
vie; il a été j.eune •
&
il a
changé de place a11ant de fe fixer; il a fucé la plante·
qu'il habite, il a joui du .plailir •
&
s'eíl: accouplé.
Si quelques anguilles microii:opiques, ou
(i;
les
ani-
11lllUJC
a
roue paífent un tems coníidérable far.s mou–
vemen.t, c'eíl: qu'ils
fe
trouvent hors de leur élémenr,
&
que l'eau nécclTaire pour
le
jeu de leua org.anes
leur manque.
Nous ne parlons
ici
que des
animaux
les. plus
fim–
ples ; car pour les
animattx
des infoftons, pour
les
vers
fpermatiques eux-mcmes, leur mol!lvement porte
le
ca–
raél:ece évident de la volonté. Ce.s petits
animaux
na–
gent, ils changent de place, ils vont vite• ils rakn–
t iífent leur courfe, ils prennent nne direél:ion nou.velk •
&
merne oppofée . ils évirent la renc::<?ntre dt leuri;
fen~blables. Plufieurs d'entre les plus funples de ce& am–
malcules ont des queues ou des filets • qu'ils agitrnt
d'une maniere particuliere
a
chaque efpece,
&
dont ils.
( 1)
L'auteur de cet article, dans la recherche qu'ir fait
du caraé\ere díftinélif de l'Anim;>lité, fe 1tontente de
patTer en revue la forme externe des animaux , leur ma–
niere de
fe
nourrir, de. croitre,
&
de rnultiplier , qui
ne conílltuent que les variations des cfpeces , <l'ou il
A N 1
~xeit<
nt
d.:
élémenr.
4"13
p~tits ~ourbillons
cla!ls
d'e!au,
c;ui
d.I:
teúr
·Nous avouQns done qu'il
y
a des exemples ou leJ
bornes des deux claífes font diffidles
~
fai(ir; mái"' l'ob,,.
fervation attentive faura diftinguer
c:,es
íbornes. · :,
On a cn,1 depuis qµelques an11ées
qu~
la matierc
végétale exaltée ou portée
a
un
cena.indégré de paur,
riture ,. aequéroit du mouvement
&
paíf9jc ,dans
jo ,r.e;
gn~ anim'<I~;.
que cette meme maEiere ralentie
eu
_abaif–
fée, redefcendoit daos la claífe
v~gérale. ,
Noug ne pou.
vons pas n'ous rendre
a
cette idée ,
&
n011i
ne 'Groyons
pas
a
ces m6tamorphofes.
.
L'hypothefe done nous parlons, . eíl: fondée- (qr des
faits que de tres bons 0bfervateurs conteíl:rnt. Des glo·
pules , qqi fortent des végétaux dílfous par
lij
poud
riture, ne font, felo.B
M.
EJlis ;,, hiíl:orien de t,ant de
poi
y
pes• que- des fruits d'une mucor, que des
ani,
maux
microfcopiques attaquent 'pour s'en nourrir,
&
qu'ils ébranlent dans l'eau; mais cien n'empeche qll.e
dans ces infofions il n'y ait en mome temps une vé–
gétation
&
une produtl:ion
d'411ímau!I
microlcopiques,
La végétation produit des muc:ors :,. de& embolus, des
plantes du· .genre des champignons. Les animalcule.s
ÍO[)t de la cl:úfe Jimple des protées, des ll'olvox de
différentes efpeces, des polypes.
Ges
deúx ¡:ire.duét.iont
peuvent
fe
rencontrer enfemble, parce· qu'elles
na~r.
fent des meq¡es caufes. Un Certain dégré de
p~1trid ité
eíl;
favorable
&
au champignon qui vc!gete fur la matiere
putride
>
&
a
la mouche qui fe repait d_u champignon.
No1n ne faur-iens regarder com!ne des plantes,
d<!s
petits
e~res
qui nagent • qui fe rapproqhent du fond.
qui s'évitenc, qui remuent des bras
&
des queues.
Dan~
<les
ét~es
auíl! ·limp'les: nous ne: faurions im¡igint'r des
fr •.
gnes plus expretlifs de la nawre aoimale.
(H. D.G.)
ANIMAL.,
f.
ro.
AtirtMAlTX,
au plur. (
term.ede Bla.
fon. )
on comprend fous ce mot, non-feu.Jement les qua–
drupedes • mais meme
les
volatiles' les poiífo11s
&
les
reptiles; on en vait de tomes les efpcces dans les
ar–
moiries ;. il& ont chacun leur po(ition
&
des termes
~ui
leur íont 1pmpres.
,
Le
/ion
eíl tauj.ours de próñl ne [rQQntrant qu'ulll ceil,
le bout de
fa
q,ueue tourné vers le do.s; íoo attitude
eíl: d'fare rampaot ,
011
ne !'exprime
poi.peparte que
c'dl:
fa
pofüion naturGlle dá.n11. l'art héraldique.
.
Le
/ion
paroit q
uclq
uefois. marchant , ¡1-lor,s, on
le.
nomm
/ion fiopardé.
'
Le.
1
léopard
elt ÍOuYent paffant •
&
a la tete de fronr,
de forte qu'il montre les deux yeuii. en.telle attitude qu.'il
foit, ce qui lé difliog1:1edu
lion.;
quaod il eíl: rampant.
on le oom
léopard /ionnt.
·
. Le
1aurea11
rampaot efl: dit
jur.ieux.
Le
bteuf
&
la
wzche
font ordinairement repréfentés
p affans.
Le
mouton
&
la.
br.ebü
palfaos
ou
paitrans.
Le
cheval
qui fe promene fans lurnois , ell: dit
guai,
s'il eíl levé
cabré:.
lorl"qu'il a t0us
fe~
harno1s •
011
d1t
qu'il eíl:
b(lrdé
,
houjfé
&
caparafonné.
•
Le
bouc
,
la
chevre
,
la
licorne
&
les.
autres.
amma.t~
fau11age,s kvés, foot dit.s
failla11;.
Le
chat
levé efr dit
effm'ouché
•
mais lorfqu'il·
l~ve
le
derriere plus ha:ur que la tete , on·
le
dit
bérij/imné.
. Le
lou-p
levé ou ramµant, eíl: nommé
ravif[am.
Voy:ez
I'
aigfe
,
les ¡¡tme1; oifeaux; le
dµuphin
&
l~s
poilfons. Tous ces
a11ü11att~
&
auues fe trouvent explt–
q ués. dans. un p1us grand détail á leur articlc panicu-
lier, en l'ordre alphabétiq.w;.
,
Le mot
animal,
vient du laiin
anima
qui a vie, qui
eíl: animé.
(
G.
D.
L.
T. )
ANIMALlTE',
f.
f.
(Hi.ft.
nat.
Zoologi~.)
[
1J
l'a11ima·
prend oc-caííon de jetter des d'outes (ur la .diílribution
des trois regnes ; inconvenient dans lequel il ·ne fero!t
pas tombé, s'il avoit fait confiíler le coral:.lere diainéhf
de
I'
Animalité dans un corps doué d'une ame, •yant
la faculté de fentir
&
la liberté de fe mouvoir - •
















