
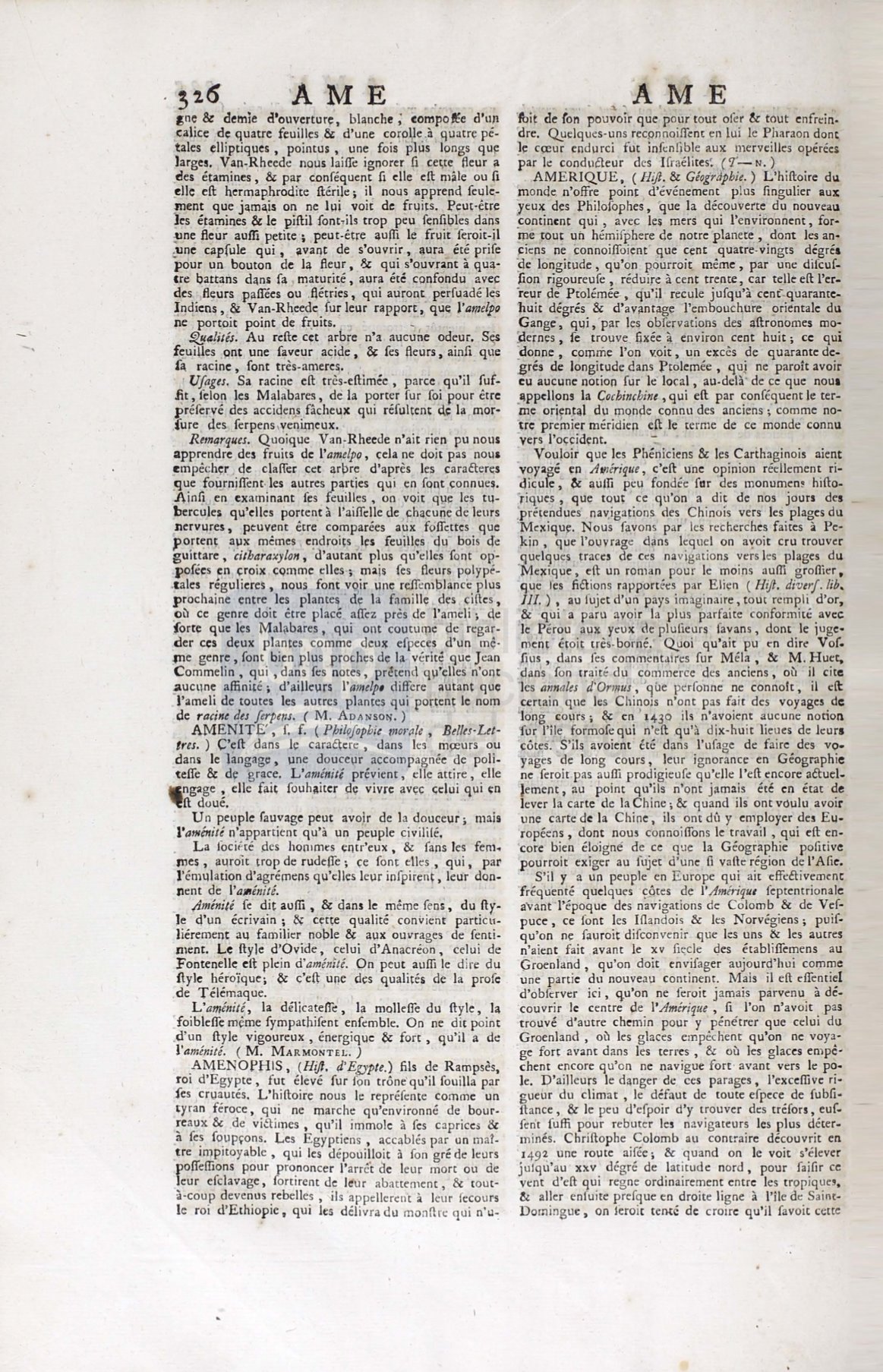
;~6
AME
..
gne
&
detnle
d.'ouvertur~,
bl¡¡nche ; C:ompoft:e d'u)l
ca)ice de quatre feuilles
&
d'une corol,le .a quatre pé–
'tales clliptiqucs , pointus , une fois'
pl¡i~
longs quF
larges.
Van~Rheede
naus laiffe ignorer
li
cet,re fteur
a
.des étall}Ím:s;
&
par c.o.nféquent
f¡
die
dl;
male ou
(i
~lle
eíl:
hermaphrodite ftérile
¡
il. naus appre¡id feulc,–
;ment que
ja.ma.isan ne
h1i
vait de fn¡its.
feut·~tre
Jes é¡ amines
&
le I?iilil font, ils trap peu fc;nf¡l.Jles dans
.t1ne fleur auffi petite; ,peut-écre auffi
l~
frµit
f~roit-il
,ur¡e capfule qui,
~var¡t
de s'auvrir, 3Ura été prife
paur un bouran de la
~eur,
&
qui
s'ouvr~nt
a
qua–
cre battans dans fa , ll)aturité, al!ra éré cor¡fondu avec
des ,fleurs p¡i!Tées ou ,flérries, qui
au~on~
perfi,¡adé lc;'s
!nqícns,
~
Van-Rh.cedc fur leur rappart, que
l'aflle/pg
ne .
portÓit point
d~ f~uirs.
1
.., .
·
~"litis.
Au rcíl:e cct arore n'a aucune odeur.
S~s
fc;.u_iUes .Pnt une
f~veur ac;i~e,
&
fes fleurs, ain!i que
fa.
racine , font
tres-amere~.
.
.
'
Ufages,
Sa racine eft. tres-eíl:imée, p are.e qu'i!. fuf–
.fü,
fel!J!)
les
M alabares,
de
la porter fur Coi pour erre
préfcpré des acciden,sJacheux qui réfulcent
~ l~ , mor.íure des. ferpens ,yer¡Íll}eux.
Ref!Jgrques.
Quoique Van-Rheede n'ait ríen pu nous
apprendrc des fruits d!= l'
amelpq,
~ela
ne qoit
p.asnou&
~mpec:h1=~ ,
de
c~a!fer
cet arbre d'apres
le~
caraél:en:s
_c¡ue fol!_rnjffent· les autres parties qui en fQl\t' connue4.
.l\iní).., en exarninant fes feÚilles , on vQit qye les tq–
bercu)e~
qu'elks parcent
a
l'aiífdle de cha.cupe de leurs
nervi¡_res, peuvent erre comparées aÜx fo!Tc;ttcs que
~orten~
aux rncmes ,
c:ndroi~s l~s
feu illes dq bois
efe
guíttare ' .
cilharaxylon,
·a·auran't plu·s qJ•elJés Tont oP.–
.¡iofé~s
f.º
~roix .
<;Qnirnc elles-;- mais fes fleurs polypé–
.tales regulieres , nous font
v~ir
IJPC
n:ífeniP,lance p lus
prochaine entre les
plante~
.
cf~
la
fo
mi
111,l
des cifks .
Ἴ
ce: genre dóit etre placé. a([ez pres de 1'.arpeli ;
qe
far.teque les l\1al¡1bares ; qui ont coututp<; pe regar–
.der cc:s dc:ux
plan~es
comme deui¡:
efpece~
ii'ur¡
m~.flle genre, font bien Jllus
prach~s
de J¡¡.
v~rí~~
c;¡ue J ean
·cammelin ,' qui ; daiis' ft:s nores, prétenc\
q\l'elle~
ri'ont
?-Ucqne afllnité; d'¡¡i\leµrs
1'{ln¡elp1
c!iffere
a
1
utknt que
l'ameli de toures les aurres planees q ui
ponen~
le
nom
oc;
racint des
ferpe1u. (
M.
A pANSOlj; )
•
.l\MENITE' ,
f,
f. (
Pf;ilpfopbie mortife, Belles-Let–
tres.
)
C'eíl: dans le caraétere , dans les
m~urs
ou
dans le lángag¡,, une
douce~r
accompagnée de poli–
teífe
&
d1=
grace,
L'améniti
pr~vient,
die atrire , elle
• ngage , elle
fai~
fouh;\itcr
pe;
vivrc av<;c <;elui qµi
~n
~~~
-
.·
U n peLiple fauvage peut ;¡valr de la douceµr; mais
}'p111éitité
n'appartjent qu'a un peuple civililé,
. L a foci f. té .des ho111rnes c:ncr'eux ,
&
fa)ls tes fem.
ftlCS ,
auro'it
~rop
de rude{fe; <;e font elles , qui , par
l'émul a~ion
d'agrérnefls qµ'elles leur
infpiren~,
leur don-
nent
de )'
a111énité.
·
.
¡Jménité
fe
dit auíli '
&
clans le me¡pe fens , du
íl:y–
Je c!'µn
~crivain
;
&
c~tte
q\lalité conviene particu–
liérement au fami lier nol>le
&
a\.lX ouvrages de fenti-
111ent. Le llyle d'Ovide, celui d'Anacréon, celu i de
fantenelle ell: plcin
d'amén'ité.
On peut auffi le dire dµ
fiyle héro'jque;
&
c'e(t une des quali¡és de la profe
.de Télémaque.
'
L 'aménité ,
la dé)jcatefTe, la molleífe du íl:yle,
fa
'fo ibleffe mcme fympathifent enfemble. On ne dit point
.d'un íl:yle vigoureux, é¡iergiq ue
&
fon , qu'il a de:
l'aménité.
(
M.
MAR MONTEL.
)
_AMENOPHIS,
(Hijf.
d'Egypte.)
fils de Rampses,
ro1 d'Egypte, fut élévé fur f9n rróne' qu'il fouilla par
fes cryaurés. L'hiíl:oire nous
le
repréfente camme un
~yran
féroce, qui ne rparche qll'environné de bour–
~eaux
&
.de viél:imes , qu'il immolc
a
fes capricc;
&
.ª
fe~ fo_up~ans.
Les Egypriens , acqblés p ar un maí–
_t re m¡pitayable, qui les dépouilloit
ii
fon gré de leurs
poífeffions pour prononcer )'arree C!e leur mort ou de
lcur efclavage , fortirent de leur abattement
&
tour-
3-caup devenus rcbelles , ,¡¡s appelleren't
a
le~r
íecours
le roi d'Ethiop ie • qui les délivra du monflre qui
n·u~
AME
. ,
a...
.
'!bit de fon pouvoir que pour tout ofer
&
tout enfrdn–
dre.
~elques-uns
r¡:q:¡pnoiífmt en iui le Pharaon dont
Je q;eur endurci fot infenfible aux tnervei lles opéréc¡
par le condL1éteur des ·Ifn¡élites:
(r- N. )
AME RIQUE , (
Hijl.
&
GéQgrt1pbie.)
L 'hiíl:oire du.
monde, n'offre point d'événernent plus fing ulier aux;
jeux des Phi)afophes, que la découverte_du nouveau
_contincnt qui , ave¡;
les
mers qui l'envirannent, for·
me
,:out qn }¡émiíphere de notre ·planete , dont les an·
,cie¡is ne
connaiífoi~nt
s ue cent quatre-vingrs dégrés
:cJe
longitude' qu'on pqurroit meme, par une difcuf–
f!on rigoureufe , réduire
a
cent cre11te, car telle eíl: l'cr–
·reur dé Ptolémée. , qu'il rc:cqle jufqu'a ccnf ..quaranre–
'J¡uit dégrés
&
d'av¡rnt;ige !'embouchure orientalc du
Gange, qui ;par
les
obíervations des aíl:ronomes mo–
'.Pernes , fe troµve . fi11ée
~
enviran cent huit; ce qui
:donne, cprpme l'on v.ait, un ex;ces de quarante de–
.&rés de longitude dans Pcolemée,
qu~
ne paroit avoir
cu aucune notion fur le local, au-dela· de ce que noua
_l!ppclh:ms la
f;ochincbine,
gui eíl: par conféquent
le
ter–
me
orjen¡ªI du Q19npe connu des anciens ; comme no–
lr~
premier m¿ridiep eft Je terme de ce monde connu
-vers
l'a~ddent.
-
· Vou!oir que les fhéniciens
&
les Carihaginois aient
·voyaj,é
~n
At11ériq11e,
c'eíl: une: opinion réellement ri–
<)icule,
~
;¡ulli pe4 fondée fdr des monumem hiíl:o–
'riqµes , qu<;
tQu~
ce qu'on a dit de nos jours des
:prérendues'
nav,iga~ions de~
,Chinoís vers les plages du
').Ykici~ur·
Nous fa,vons par les recherches fai cc:s
a
Pc:–
~in
, que l'ogvrage
é\~ns
lequel on ayoit cru trouver
quelqµ c:,s
~races
de ces navigations vers les plages du
ºMe¡cique, eft un roman pour le moips auffi gro!lier •
·q.ueres fiél:ion s r<1pportées par Elien (
lfifl.
diverf. lib.
llf.
) ,
¡¡u fujet d'µn 'pays imaginaire , touc rcmpli d'or,
,~
·qui · a paru ¡¡yqir la plus parfaite conformité .avec
'll: Peróu
ª \!X
yeu~
de p.lufieurs favans , dont
le
1uge•
mem·
é¡oi~ tres- born~.'
Q,uoi qu'ait pu en dire Vof•
¡¡;us , dans fes
comment~ires
fur M éla ,
&
M. Huer.
"dan's fon craité du com'merce des anciens; ou il cite
..Íes
~nnale¡
¡{Ormus ,
'que perfo1iné ne connolt, il
dl:
certain que les Chinois n'ont pas fait des voyagc:s de
~or¡g
coL]rs ;
&e
en '
1430
ils n'avoient aucune notion
'fur
l'il~.
formafe qui n'eft .qu'a dix-huit lieues de leurs
córeS'." S'ils avoient été dans l'ufage de faire de1>
vo.
yages ·de long coµrs,
Jew
ignorance en Géographie
ne: ferolr.pas auffi prodigieufe qu'elle l'eíl: enc9re aél:ue).
Jement , ¡¡u · point qu'ils n'ont jamaís été c:n érat de
levc:r Ja caree de la Chine;
&
quand ils ont vóulu avair
µne carte de la Chi ne, ils ont du
y
employer des
fa¡.
ropéens
1
dont nous co¡¡noi!fons le travail , qui eíl: en–
'core bien éloigné de ce que la Géographie po!itive
pourraít exiger au fujet d'unc:
fl
vafte région de l'Afie.
S_'il
y
a un peuple en E urope qui ait effeél:ivemcnc
'fréquenté quelques
~ptes
de
l'¡fmériqut
fcptenrrionale
a\>ant ' l'époque des navigations de Cólomb
&
de Vef–
puce, ce font les Iílandois
&
les Narvégiens; puif·
qu'on ni:
f~t¡roit
diícon venir qi1e les uns
&
les aurres
n'aient fait avant le xv
fi~cle
ejes établiffemens au
Groenland , qu'on doit envifager aujourd'hui cor:nme
une partie du nouveau
~onrl nent.
Mals il eíl: e!Tentiel
d'óbfervtr ici, q.u'on ne feroit jamais parvenu a dé–
cou vrir le centre de
l'Améri9ue,
fi l'on n'avoit pas
trauvé d'autre chemin poµr
y
pénétr<Zr que celui du
Groenland , oli les glaces empec hent qu'on ne: voya–
ge fon avant dans les terres ,
&
ou les glaces empe•
chent encore qu'on ne navigue fort · avant vers le po·
le. D'ai!leurs Je d¡¡nger de ces parages, l'exceffivc ri–
gueur du climat ,
le
défaut de toute efpcq: de fubfi·
ftance ,
&
Je
peu c!'efpoir
d'y
trouver des tréfors, euf.
fen'c fuffi pour reburer les navigareu rs les plus déter–
minés. Chriíl:ophe Colomb au comraire découvrit en
·1492
une rourc aifée ;
&
quand on le voit s'élever
jufqÚ'au xxv dégré de latitud e nord, pour faifir ce
vent d'eft qui regne ordinairemenr entre les rropiques,
&
aller enfuite prefque en droite ligne
a
\'lle de Sainr–
Domingue, on li:roit tenté de croire qu'il favoit cerre
















