
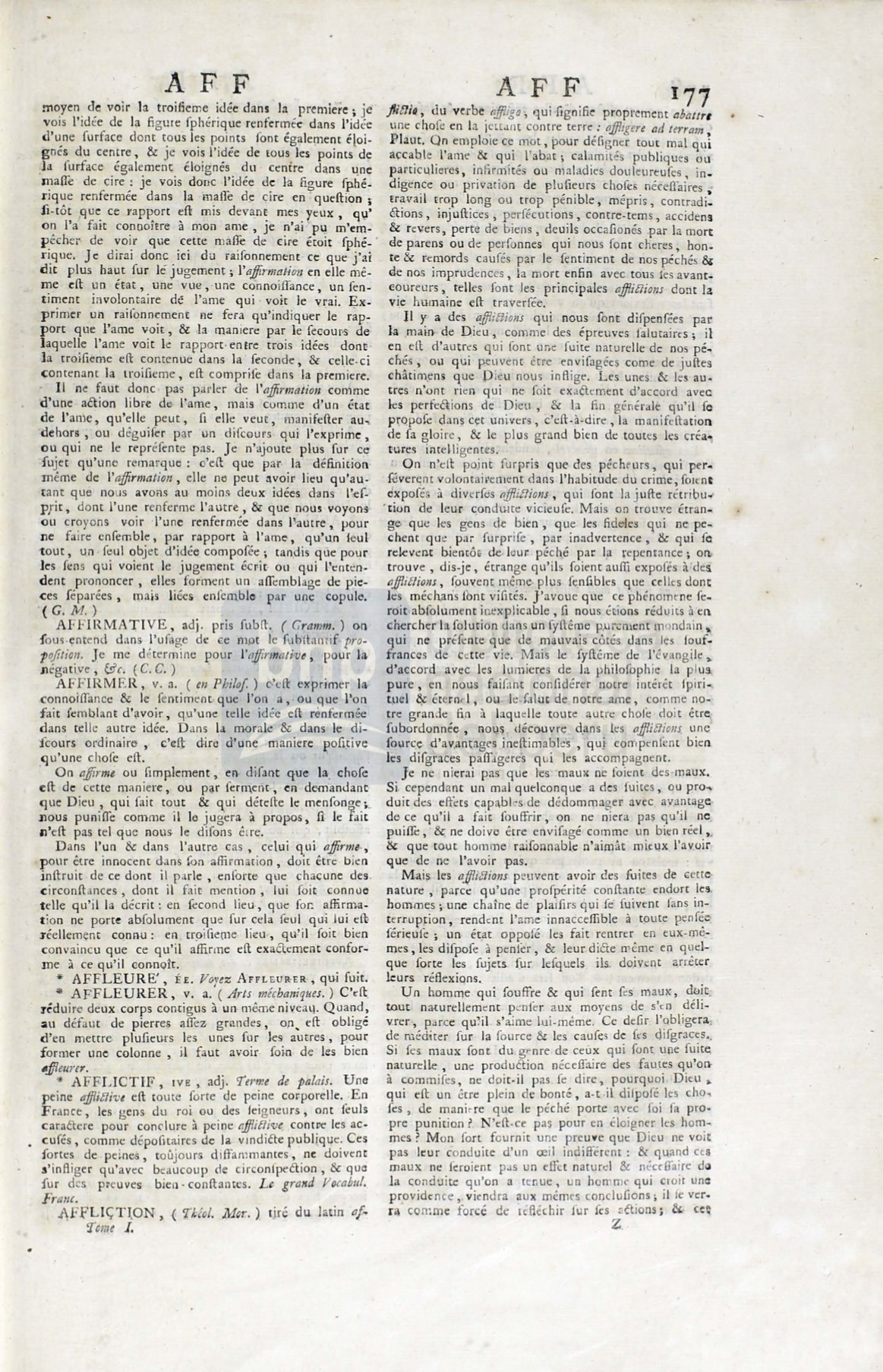
AFF
moyen de volr la troifieme i<lée daos la premiere ; je
vais l'idée de la figure fph érique renfermée dans l'id ée
cl'une furface dont tous les points fonr
ég~le¡nenc
éloi–
gnés du centre,
&
je vais l'idée de taus les points de
.Ja
furface également éloignés du cenire dans qne
maífe de cire
~
je vais done l'idée de la fioure fphé–
r ique renfermée daos la
mal.feds: <;i re
en'?
queftion
¡·
fi-tot que ce rapport
eíl!
mis
deva.n~
mes
ycux ,
9i,¡'
on l'a
1
fait conoohre
a
mon ame , je n'ai
p~
m'ern"
~echer
de
~oi.r
que
_c~ue
maf'.e de cire étoir fphé- ·
nque. Je d1ra1 done 1c1 du. ra1fonnemenr ce que j'ai
rlit p lus haur fur lé jugement;
l'af!irmalion
en elle me–
me cíl: un éfat, une vue , une cci'nnoiffance, un fen–
timcnt írwolontaire dé l'ame qui · volr
le
vrai. E*–
prímer un raifonncment ne fera qu'indiquer le
r~p:
port que !'ame voit,
&
la man iere par le
fe0ou~s
de
laquel~e
!'ame voit
¡¿
rapport· en !re rrois idées donn
la tro;liorne eíl: contenue daos la feconde,
&
cel.le-ci
contenant la troifieme , eíl: comprife dans la prem iere.
· 11
ne faut done . pas parler ·de
l'ajfirmaiio11
comme
d'une aétion libre
d~
l'ame, mais comme d'un état
de l'anie, qu'elle peut, fi elle veut,
manif~!ler
au ...
dehors , ou. deguifer par un difrnurs qui !'exprime
1
ou qui
ne le
repréfente pas. Je n'ajoure plus fur
et;
fujet qu'LJne rernarquo : o'dt c;¡ue par· la'
défini~ion
meme de
l'ajfirmation,
elle
ne
peut avoir lieu qu'au.–
tant que nous avo;is au moi ns. deux idées dans l'ef–
p,rit, dont l'une renferme l'autre ,
&
que oous voy.ons–
ou croyons voir ·!'une renfermée dans
l~a utre"
pour
ne faire cnfemble, par rapport
a
l'ame, qu'un leut
tour, u.n feul objet d'jdfo compofée; ran,dis q üe po\]r
ks fc::ns qui voient
le
jugeca1ent
é.cr-it· on qui l'enten–
dent prononcer , elles forment un afTemblage de pie–
ces féparées , roais liées. enfem.ble I?ª r l¡ne copLJle.
'(
G.
M.)
AFF IRMATIVE, adj. pris fubíl:.
(
Gramm.)
011
fous -entend dans. l'ufage de: <0e mpr
le
fubítanrif
pro–
po.(itio'!.
Je me d érerrnine
I_>Our
!'a.ffirmatiw"
pour
b
11egar1ve ,
&c.
E
C.
C.)
AFF IRM ER, v. a. (
en Philof )
o'eíl: expri·mer la
connoifTance
&
le fenriment que l'on a, · Gu que l'on
fait feml:!lant d\1voir, q.u'une telle idée eíl: renft:rmée
dans tel lc autre idée. D ans la morale
&
dans le di–
fco urs ordinaire ,
c'd.t
dire. d'une maniere poli.tive
c¡u'une chofe eíl:.
·
.
· On
Pjfi1·me
ou íimplement, en. d i.fant que la. chofe
eíl:
de cette man iere, ou p¡¡r ferm,ent, en demandant·
c¡ue Dieu, qui fait tour
&
qui déteíl:e
le
men fon~e
;_
nous punifTe comme il' le jugera
a
propos,
fi.
le taic
ll'eíl: pas tel que
AOllS·
le difons Ctre.
Dans l'un
&
dans l'aurre cas , celui qui.
ojfirme- ,
pour ene innocent dans
Con
affirmation, doit etre bien
inftruit de
ce
done il parle , enforre que chacune des.
c irconíl:ances, dont il fain mention , luí foit connue
t elle qll'il la décri t :
en
fc::cond lieu., q·m: for. affirma–
t ion ne porte abfolument . que fur cela feul qui luí
e~
.réellement conn-u: en tr!)ifiecne fü:u-, qu-'il foit bien
convaincu que ce qu'il affirme
dl
exaél;cment confor–
me
a
ce
qu'il eonnoír.
*
AFFLEURE',
ÉE.
Voyez
AFPLEUlHR,
qui foit.
*
AFFLEURER, v.
a. (
//.rts méchaniques.)
C'~íl:
rédu irn deux corps contigus
a
un meme nivcaq. Quand,
au défatr t de pieri-es
affez,
grandes,
on,
eíl: obLigé
d'en mettre plufiem-s les unes for les aunres , pour
former une colonne ,
j.J
faut avoir
foi.n.
de les bien
•ffleurer.
*
A FICLICTFE,
1ve ,
adj .
<J'erme de polois.
Una
peine
ojfliflive
eíl: toute forre de peine
co~porelle.
En
Fraoce , les oens d-1.1
roi ou des leig neurs, ont feuls
car.aétere pm;"r condllFe
a
peiot:
a./fli[l_ive
cont~
les ac–
cufés , commt: dé-pofitaires
de
la. vtndtéte publ¡,que: Ces
fortt:s de pei.nes, roujours d iffammantes , ne dotvcn t
s'in flige r qu'avec beaucoup ck circonfpeétion,
&
quo
fur des pPeuves bien - coníl:antes.
L e. grand f/ocab11!.
Fro11c.
.l\ffLl<;T~ON,
(
'[héol. Mor.
)
e.iré
du
hain
af
crome
J.
jliéUQ,
clu ' verbe
,;f;go;
~¡ ·fi~ifie
propremcnr
~b?it?,
une chofe en la jeu<1nt contre terrc :
t1j/l1gere ad terram
Illaut.
Qn
emploie ce mor , pour déíigner rouc mal qui
accable !'ame
&
qui l'abat; calamités publiques
0
~
1
partiet¡liGres, infirmi tés ou maladies dou leureufes in–
digence ou pri11acion
de
plufieurs chafes néceffa¡'res ,
era1•ail
~rop
long ou trop pénible, mépris, conrradi:
&ions, injuíl:ices , perfécurions, contre-tems, accidens
&
revers, perta de biens, deuils occalionés .par la mort
de pareos ou de perfonnes qui nous font cheres , hon–
re
&
r-emords caufés par le fentlment de nos
~chés
&
ae
nos imprudences, la mort enfin avec taus tes avant–
coureurs , telles font les prio<;ipales
ojjiifiio11s
dont
la
vie
hum~ine
eíl: traverfée.
.JI
y
a
des
ojfiiflions
qui nous font difpenlees par
la .main-
de Dieu, c0mme
des
épreoves falutairc-s; il
en
eíl
d'autrcs q ui font une fuite naturelle de nos pé.
chés , ou qui
peuven~
erre envifagées come de juíl:es
chacim.ens que P
i.tuno1.1s inflige. Les unes
&
les au.
tres n'ont ríen qui ne foit exaékmen t d'accord avec
les perfe&:ions de Dieu ,
&
la
fin
générale qu'il fo
ptQpofe .dan§ q:t trnivers, c'cíl:-a-dire, la manifríl:ation
de
fa
gloire ,
&
le J?l us grand \>ien de to.utes les <;réa,
~1.Hes
i
ncd
ligel'lt~s.
· On n'd t poi nt f.urp ris que des péc hrnrs, qui
per~
f-éverent volootaivement dai:is l'habitude du crime, forme
dx,pofés
a
div ríes
affl.iflions ,
qui font la j ufl:e récribu..–
' tion de leur condu.ite vicieufe. Mais oo trot?ve
érran~
ge q ue les gens
de
b.ien, que ks fiddes qui
ne
pe~
chent que par furprife , p ar inadvertence,
&
qui
fo
relev.enr b.ien•ÓE
de.
leur. pécQ.é par la repentance; ori.
trouve ' dis-je, étrange qu'ils foient aum expofés a :des
0J/litli~11s.,
'..ouvent
_me~e-
plus fe.nlibl.:s q_ue. celles dont.
lc:s mecll,ans Íi:lnt vríites. J'avoue que ce phenomrne fe–
roit-abfolumenr inex plicable, fi nous écions réd uits
a
CI\
chercher la
folu~ion
dans un
fy.íl:eme p,urcment mondain. ..,
qui ne prtferrn:. que de m¡¡uvais có.rés <lans
les
fouf–
frances
de
cctte vie. Mais le
fy.íl:eme de: l'évangile
>
d'accord avec les lumieres de la philofophie la plus.
pure , erl nous fai fan.t confidérer notre intéret
fpiri~
tp~l
8;c
éter.nrl,
OY-
.Je-fal ut de, notre ame , comme no-.
tre grande fi_n
a
laqudle toure
aut.rechofe doit erre.
fubordonnée, nous . dcícouvre d_ans les
affl.ié1io11s
une
fourc.e.
d
'av.an~ages
ineíl:imable's , quj eompcnfem birn
les difgraces pafTagere"s q ui les accompagnenr.
Je ne
nier.aipas que
les ·mam<
ne foicnt des-maux.
Si. cependant un mal quelcon que a des fuites , ou
pro~
duit des efl.:C: cs <;ap1\bks de dédomf1]ager avec. avanrnge.
de
ce
qu'il a fait fou ffri r, on ne niera pas qu'rl ne,
puiffe, ·
&
ne doive erre envifagé comme un bien réel ,.
&
que tour homrne raifonnable n'aimat mi_ei¡x l'avoir
que de ne l'avoi r pas.
Mai~
les
ajflmions
peuv:ent avoir des fu.ices de
Gettc–
nature, parce qu'une profpérité conftante
en~orr
.les.
hommes ; une chalne
de
plaifirs qui fe fuivent Jans
r~ter.rup~ion,
rendcnt !'ame innacceflible
1t
tpllte
~enfee
férieufe ; un état oppofé les fait remrer en eux-me_–
mes, les difpofe
a
ptlniú,
&
leur diere meme en quel–
que forre les fujets
f.urlefquels i!s. dojvcQt aneter
kurs réflexions.
· Un homnie qui fouffre
&
qui fent fc:s maux, d1,¡iu.
tout narnrellemcnt prnfer aux moy.ens ele s'cn .déli–
v.rer,
par.cequ}il s'aime
l.ui-meme. Ce defir l'obltgera,
de méditer fur la fo urce
&
les caufes de frs cl1fgraces•.
Si fes. maux foat du gPnre de ceúx qui font une foite.
nacur.elle , une produétion néc elfaj re des fautes qu'on–
a
commifes, ce doi t-il pas fe d ire, pourquoi Ditu ..
qui eft un erre plein
de
bonté , a-t .il dilpofé lts
cho~
fc:s,
de
manir re que le péché porte ;ivec foi
fa
pro–
pre punition? N 'cft-ce pa$ pour
en
éloig ne r lts hom–
mes
?
M on
fort
fcurn it une preu ve que D ie u
ne
voi¡;_
pas leur conduice d'un ceil indiffércnt:
&
q u.and ces
maux ne feroient pas un effct narurd
&
nécdfaire d<J
la con:foite q u'on
a
ten ue, un hommr qui c1 oi c
una
pr_ovidrn ce ,. viendra aux memrs conclu fions; il fe ver.
ra
con:me forcé
c!c:
rdléchir fu r fes
~élrons ;
&
ce~
z;_
















