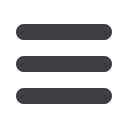
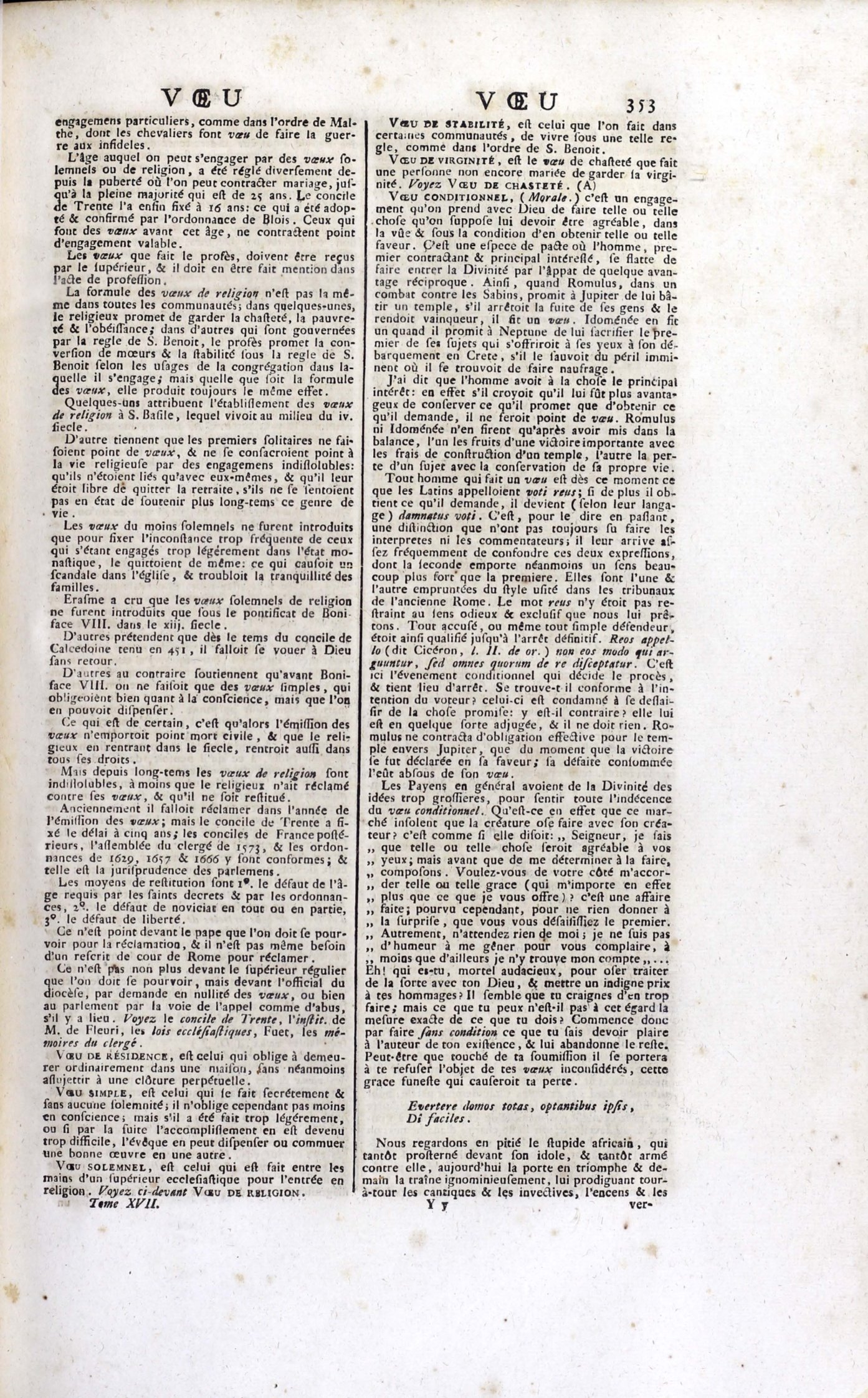
engagemens particulíers, comme da·ns l'ordre de Mal·
the,
dont les chevaliers font
vrzu
de faíre la guer·
re ;ulx lnfideles.
L'Sge auquel on peut
s'eng:~ger
par des
vrzu•
fo.
lemnels ou de religíon, a été réglé diverfement de–
puís la puberté
du
l'on peur contralter mariage, jul:.
qu'a la pleioe majorité qui efl de
2.5
a
os.
~e
coocile
de Trente l'a entin fixé
a
I6
aos: ce qui
a
été adop–
té & confirmé par l'ordonnaace de 61ois . Ceux qui
font des
TJIZIIX
avant Cet age, .ne COOtraaeot point
d'engagement valable.
Les
flrzux
que fait le proles, doiveot étre
re~us
par le lupéríeur,
&
il doir en erre fait meocion daos
J'alte de profeffibn .
·
La formule des
vtzux
de religío'f
n' eQ: pas la ml!–
me
dans toutes les communautés; dans
qQelques~unes,
le religieux promet de garder la chafleté, la pauvre·
t~
&
l'obéilfance; dans d'aurres qui font gouvernées
par la regle .de
S.
Benoit, le prófes promer la con–
verfion de mreurs
&
la flabilité lous
IJ
regle dé
S.
Benoit felon les ufages de la congrégation daos la–
quelle il s'eogage
¡
mais quelle que foir
la formule
des
'lifZfiX,
elle produit coujours le meme elfet.
Quelques-lJos attribuenr l'érabliflemenr des
fltzfiX
de rdigion
a
S.
Bafile, lequel vivoit au milieu du iv.
fiecle.
D'aurre tiennenr que les premiers fqlitaires ne fai•
· foient point de
'litJ!IIX,
& ne fe COnfacroieot point
a
la vie
religieufe par des engagemens indíflolubJes:
qu'ils n'éroienr líés qu1avec ·eux·memes,
&
qu'il leur
éroit libre de quirrer la retraite, s'ils ne fe ·tentoíent
pas en érat de
fou~enir
plus
long-~ems'
ce genre de
vie.
'
·
Les
vtzux
du moins folemqels ne !ureot íntroduits
que pour fixer l'í.nconflance trop 'fré<juente de ceux
<JUi s'érant engagés trop légérement daos Pétat mo–
naflique, le 'quirtoieot de
m~me : ~e
qui cáuf'oit
tm
fcandale daos ·l'églife,
&
troubloit
1~ ~r.allliilillité
<les
familles.
1
·
·
· Erafme a cru gue les
'IJ/:8tiX
folemnel~
de religíoo
ne furenc introdúlts que fous le pOf!tificat de &oni -
face
VIII.
dans le xiij. fiecle.
·
··
'
D'aurres prétendenr que des le tems du cqnoile
d~
Calcedqine ten
u
en
4S'
1 ,
il
·falloit fe vquer
a
Oieu
fan s rerour.
·
·
'
'
·
·
·
D 'a urreS.
~u
COQtraire fourieonent qu'avant Boni–
face
Vlll.
ou ne faifoit que des
-przux
{imples, qui
ob ligeoien t bien qoant :lta· confcieóce, oiai; que l'on
en pouvoit difpeofér :
·
"
Ce qui el\ de cercain, c'efl qulalors l'é"lilfion des
JJ~ux
n'emporroit poinc ' rnorc !=ivile,
&
que le reli,–
g¡eux en
rencran~
daos le fiecle, rentroit auffi daos
tou
s
fe, .droi
es •
·
·
·
lVb ts dépuis long·tems les
vtzux
tle
rel~i~
font
ind illolubles,
a
moins que le religíeu¡ n'ait rtl!clamé
contre fes
vtzux,
&
qu~il
ne foir re!licué.
Anciennem~nt
il falloit rá'clamer daos l'aonée de
l'émiflion des
tJ~IIX;
maís le
~oncile
de 'Prent'e
·a
6-
:xé
le délai
a
cinq aüs; les concites de Fraoce poflé–
rieurs, Paflemblée
du
clergé de
i
s
7~,
&
res ordon–
nances de
162.9,
I6)?
&
1666
y
foil
e
conformes;
&
telle ell la jurifprudence des
p~rlemens.
·
Les moyens de rellicurion font
1•.
le défaut de
1'~ge nequi's par les faints decrets
&
par les ordonna!1-
ces,
2.~.
le défauc de noviciac· en tOQG ou en
partí~,
3°. le
d~faut
de liberté.
·
· ·
·
Ge
n~efl
point devane le pape que l'on doit fe pour·
voir pour la réclamacioo,
&
il
n'-efl pas meme bef'oin
d~un
refcrit de cour de Rome pour ·réclamer.
Ce o'ell ¡fas non plus devant le fupérieur régulier
que l'on doic fe pouryoir, mais devant l'officiat du
diocefe , par demande en nullité des
'CJrztiX,
ou b.ien
au parlement par la voie de
l~appel
comme d'abus,
s'il
y
a
li~u.
Voyez
le
concile
de
Trente, l'inflit. ,de
M.
de Fleuri, lei
lois
ecc/ijiafliqtle.r,
Fue~,
les
m.i-
moires
dtl
clerg;.
· ·
V
(JIU DE
RÉSID.ENCI!:,
ell:
celui qui oblige a demeu–
rer ordinairemenc dans une· maifo.u , fans · néanmoins
afluj ertir
a
une cl3cure
p
erpé~uelle.
· V
su
~IMPLE,
ell celui
q.uile fait fecrétement
&
fans áucu'ne lolemnité; il n
'oblige cepen.dant pas moíns
en confcience; maís s',il a été fait trop légérement,
ou
fi
par ta
fuire
t•·accompliflement
en
e
ll devenutrop difficile, l'év"que en peut difpenfer
ou
commu.et;
·Une bor-me reuvre en une autr.e.
·V
.:.u
SOLEMNEL, eíl ce)uí qui
ell
fait entre
l~s
mains
d'un fupérieur ecclefiallique pour l'enrrée
en
religioa •
l(.qyez
ci-de'IJ&nt
V
a¡
u
o~ RBL~GJ.o,N_ .
·
. '
'I~me
XVJ1.
V<D:U
3 f3
Vav
:01
STABILJTÉ,
ell
cel.uique l'on fait daos
certaml!s communaurés, de
vivrefous une telle re•
gle, comme daos l'ordre de
S.
Benoic.
V
a;
u
DE "VJRGINJTÉ, efl
le 'fltzUde ehalleté que fait
une perfonne non enc
orr mari.éede garder la virgi–
niré.
Voyez
VCEu
DE
CH A.ST-ETÉ.
(AJ
V
a>!J
CONDJTJOli!N
Et., ( MQra/6.)
c'eíl un engage–
menc q.u'on prend avc:c ·Dieu de faire telle ou celle
. chofe qu'on fuppofe lui devoir
~tre
agréable , da'ns
la vík
&
fous la condition d'en· obcenir telle ou telle
faveur. · pefl une efpece de
paéle ou l'homme , pre–
mier contraélant
&
principal
iottref.lé, fe fbcre de
faire entrc:r la · Divinicé par t
•appar dequelque
avan~
tage réciproque .
~inG
, quand Romulus, dans un
combar contre les Sabios, promít
a
Jupiter .de luí ba–
tir un temple, s'il
arr~toit
la fui te de fes gens
&
le
rendoit vainqueur, il ñr un
1Jtztl.
Idom.énée en
ñt
un quand il pro.míi
a
Neptune de lui facrifier le pre–
mier de fel fujecs quí s'otfriroit a fes yeux
a
foo dé,.
barqoement en
Cre~e,
s'il le fauvoit du péril immi–
nenc o4 il fe trouvoit de lfaire naufrag!!.
J!ai dit que l'homme avoit
a
la chofe le priné.'ipal
.
íntér~t:
en etfet s'i! croyoit qu'íl luí .fut plus avama,.
ge1,1x de conferver ce qu'il promet que d'obunir ce
qu'il demande,
il
ne feroít poiót de
vmu.
Rómulus
ni ldoménée ·n'en tireor
qu'apr.~s
avoir mis daos la
balance, l'un les fruics d'une vi&oire importante avee
les fr$i5 d.e
~onflruélion
d'un temple., l:'autre la
per~
te d'u'n fuje.t avec la confervatioh de fa propre vie.
'Fouc homme qui fait un
'Vt6tl
efl des ce momenc ce
que les Latins appelloient
71oti rtPI;
fi de plus il ob..
tient ce qu'il demande, it devient ( felon leur
lang~ge)
dt~mn11t11s
'liOfÍ.
C'efl, pour le ' dire en pa.flanc,
une
diílin~bon
que n'ont pas roujours fu
faire
les
interpretes ni les commenrareurs; il
leur arri ve
a[~
fez fréquemment de confondre ces deux expreffions,
dont la leconde emporte oéanmoins un
feos
beau..
coup "plus forc' que la premiere, Elles font
1 1'une &l'autre empruntées du flyle ufiré daos les
.rribut:J.aUJ>
de
l'a.nci~nne
Rorne. Le mor
rtuJJ
n'y éc
mt pasr~flraint au feos odieux & exclufif que nous luí pn:;.
tons . Touc accufé , ou
m~me
rout limpie défendeur •
éroit ainfi qualifié jufqu'a !'arree définirif.
Reos
t~ppe!Jo
(
dit Cicéron, /.
JI.
de or.
)
fiPR
eo.r
mudo
fUi"''·
ztiUntttr. fid omnu quomm de re
diflept~tur.
C'efl:
ici l'évenemenc concfirionnel qui décide le prores,
&
tient 'lieu d'arrer. Se crouye·t· il conforme
a
l'in–
ten.tion du voreur? celui-ci ell
condamn~ ~
fe deflai<–
fir
de la chofe promife:
y
efl-il contraire? elle luí
ell en quelque
for~e
adj ugée,
&
il
ne
doi~
rien. Ro..
rqulus ne conrraéla d'obligation etfeélive pour le tem–
ple eovers Jupirer, que do momenc 11ue la viéloire
fe fut déclarée
en
fa faveur; fa défaite confommée
J!eO.t
abfous de fon
v~u.
Les
Payen~
e!'
général avoient de la Divinicé des
idées trop gr.qflieres, .pour fentir
toute l'iodécence
da
vrzr1
conditron11el
•.
Qu'eft-ce
~~~
etfet que ce mar–
ché infolent que la créacure ofe faire avec fon créa·
teur? c'ell comme
fi
elle dífoir·: , Seigneur, je fais
, que telle ou telle chofe feroit agréable a vos
, yemc; maís avant que de me détermioer
a
la faire,
,. com¡Yofons. · Voulez-vous de v.otre c6té m'accor..:
,; der telle
oo
telhi grace ( qui m•importe ·en etfet
, plus' que ce que je vous oifre
),
?
c'eft une affaire
;, faite¡ po"urvu cependal1t, pour ne ríen donner
a
., la furprífe , que vous vous défailiffiez le premier.
, Autrement, n'attendez ríen qe _moi; je ne fuis pas
, d' humeqr
a
me
g~ner
pour vous complaire,
~
;, moíos que d'ailleur.s je n'y tro,uy.e mon
comp~e,
.. ,
Eh
1
qui es'!tu, mortel audadeux, pour ofer traiter
de la forre avec ton Dieu,
~
mettre un indigne prix
a
t~s
hommages?
11
femble
qüe
tu
craillnes d'c:o trop
faire; mais ce que tu peux n'ell·il pasí ¡ cet égard la
mefore exalte de ce que tu dois?. Commence done
par faire
fons
cont/i.tion¡
ce que t:u fais devo;ir plaire
a
l'auteur de ton exiffef:\Ce, & Juj abandonne. le reJle.,
P.eut·!tre que coucbé d.e ta foumiflio.n
il
fe portera
a
te r"efufef l'ob,jet de teS
'lJfZU~ ÍUCOII(id~ré_s,
CettC
gr~ce
funefie qui cauferoit ta pene.
E'lltrtere
dDtlios
tot.a~,
opta»tibus,
ipJi.r.,
D~
fociles.
·
Nous regardons e.n pitié le fiupide africail), qui
· tanrót proflerné devaot fon idole,
&
t~ntót
armé
contre elle, aujourcJ.•hui la porte en triomphe &
de~
math la tralne igoominieufement, lui ·p¡odiguant tour–
a-tour
les
cant.iq.ues
&
lc;s
inveéHves, l;encens
&
. les
Y
r
,.
ver•
















