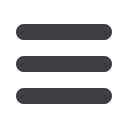
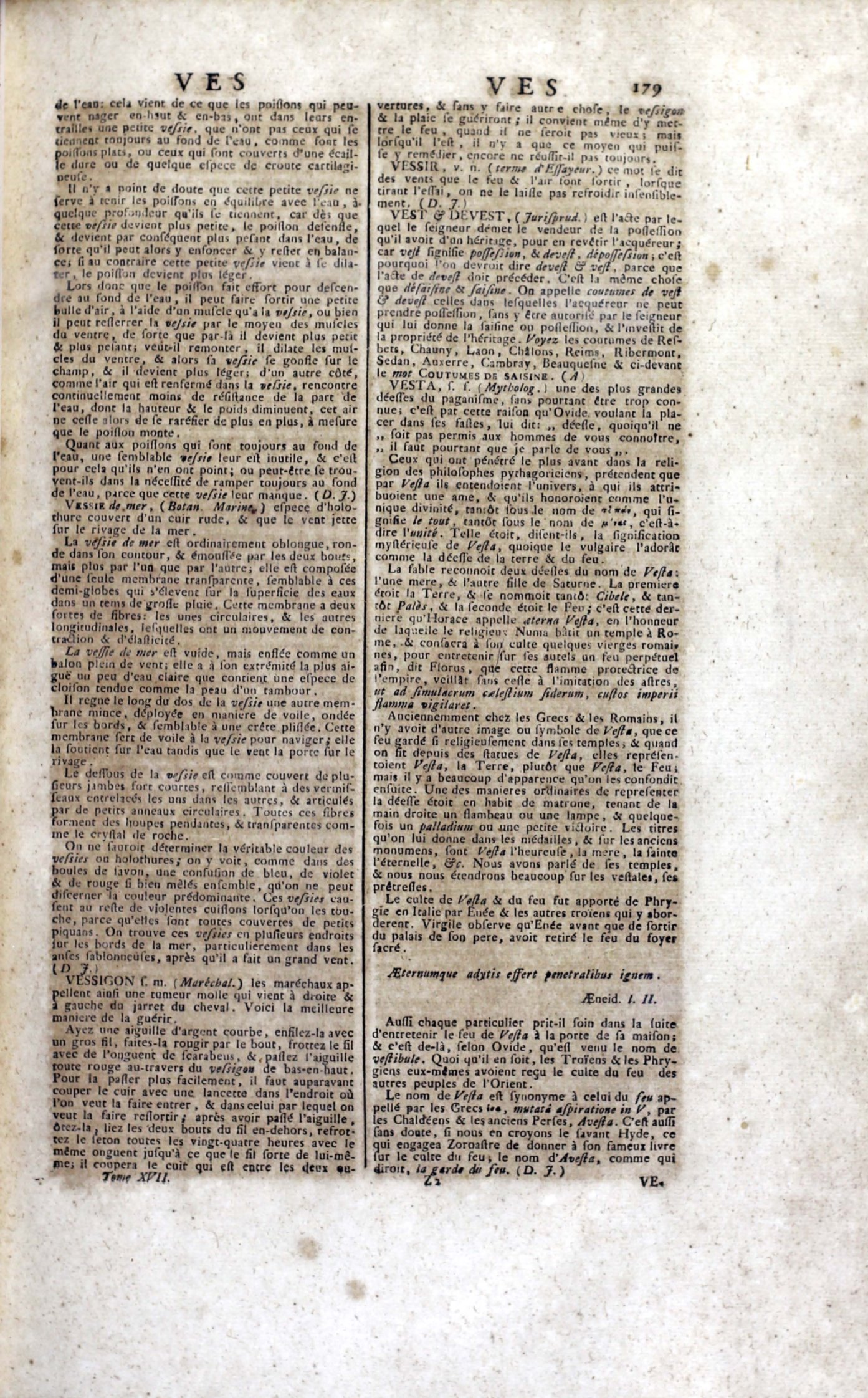
VE
4ie
t•
o:
e:
1
vien de ce que
les
p
iOons
q
i
pca–
•~nf
n ger en-h1ut
&
en-bls ,
ou
daos
lran en–
u
n~
une
pelite
vtfií, '
que u'onr pas ceux qui fe
tien neGt roo,ours au fond
de 1\:
u , comme foqt les
poi!T'ons
pi
es,
ou ceux qui font
ouvcrrs
d"un~
éc3il–
le dure
oo
de
quC'Ique
clpc
e de
croare cartila.,i–
oeuf<!.
11
n' • a
point de doute
que
rre petite
wfiit'
ne
ferve
l
t
nir
1
S
poifli
ll
n
éq
i11ure avec
1'.:
O,
a.
quelque _r.toC·
r¡¡Jcur qa'ib
t".:
u nno:nr,
car
de>
que
cer
"'fiil
d..!v1cnr
plu perite, le poif\on defenfte ,
&
devu!nt par conféquent plu
pl'CJnt
daos
l'eau, de
{orte qo'il peu t alors
y
enfonccr
&
y
refler er¡ balan-
e;
ti
u coocraire cette perite
v~fi;,
viene
1~
Jita–
t er, le poifi'
n
dcvienr pln
téger.
Lors done que le poíffon fait etfort pour d.efcen·
dre au fllnd de l'eau , il peut faire forrir une perite
IJulle d'air.
a
l'aidc d'un mufcte qu'a la
flljlit'.
ou bien
il peor rcflerrer la
•ljsi1
par le mayeo
des
mufcles
d11 venrre
de forre que par-la
íJ
devienr plus perir
~
plus pelanc; veuc.-il rcrmonter. il dilate les mul–
c:lel du venere.
&
alors f:t
fltjii~
fe goofie fur le
champ, &
il ·deviene plu i
féger;
d'un aucre c6té,
comme l'air qui efl renferm6 dans la
'fltúit,
renconrre
c:ontinuellemcnt moins de rélil\aoce de la part 'cte
l'eau,
dont
la hauteur
&
le poids diminuent, cer air
oe ceíle
:~Ion
f!e fe rarétier de plus en plus,
a
mefure
que le poiflon monte.
Quanr
aux
poiflons qdi font toujours au fond de
t'eau, une femblable
•dsi1
leur etl iourile,
&
c'cll
pour cela qu'ils n'e:n onc poim
¡
ou
peur-~tre
fe trou–
yent-ils dans la néceffité de ramper toujours au fond
de l'cau
J
pAree que cerre
w[si,
leur manque.
(D.
J.)
V
as<:nt
J,
·""",
(BotAn . MtJri"
)
efpece d'hplo–
thurc couvcrr d'un cuir rude,
&
que le veor 1ecre
{Llr le rivage de la mer.
La
111fii1
~~~
,,.
efl ordinairement obl ongue, ron–
de
dansIon contour,
&
~ntouff~e
¡Jar les deux bouts ,
m~il
plus par l'uo. que par l'aurre; elle efl compafée
d'une feule mcmbrane tranfparcme. femblable
a
ces
demi-globes qui
~·c!revent
fur la fuperlicie des eaux
dans un te'!lt de ·¡roRe pluie. Cl!tte membrane a deo"
fortes de ftbrc:s :
les
unes circubi es,
&
les nutres
longitudinales, lefqltellcs ont un mouvement de con–
crKlion
&
tl'élafllcité,
Ll
"''.1/i~
Ji
"""
efl vuide, mais cnflée comme un
~aJan
plein de venr; elle
a
11
ton
c,xtrémité la pJos ai·
gue uu
peu
4'eau ,claire que conriertt une efpece
de
c:loifon tendue cornme la
p~au
d'un tambour.
11
regne le lc»ng dLJ' dos
de
la
-ru.fsit
une autre mem·
brane mince
d~ploy~e
en maniere de voile, ondée
fur
1
S
bonfs.
&
femblable
a
une
cr~ce
piHlée. Cette
membrarae fert de voile
a
13
w.fsit'
pour navigcri elle
la foutic:nt fur l'eau tandis que le went la porte lur le
rivue .
·
·
Le
detrous d
la
,,.¡;;,
ell commc couvert
de
plu–
(leurs j.lmb
1
fort counes. r lfc mblanc
a
des vennif–
feaux
c:ntreh~
les uns
dan~
les aurres, & arriculés
par de perit anncaux circulaires, Toutes ces fibreli
Torment des houpes pendantes,
&
tranfparentcs
com–
me
.le cryflal ele rGche.
On
r¡c
f.1uroif dérerminer la véritable couleur des
,,¡¡;u
oa holothures; on y voit, commc d.1ns
des
boules de
13vou
une confnuon de btcu, de violet ·
&
de
rouge
fi
b1~ m~lés
enfcmblc, gli'on ne peur
dtfc
rner
la
couleur prédominólnte. Ces
tJifsit#
~.-au
ftllt QU
ret\e
de vfolenteS CUifionS lorfqu'oo les tbo–
c:he, paree qu' Hes 'fonr routes couverces de perits
piquans. On trouve c:es
'11tjiies en
plufieurs endroits
lar les bords de la mer, parciculieremeot dans les
• res
fablonncüfes.
apr~s
qu'il a fair un grand vent.
(D
7.1
.
E'5 SIGON
C:
n1. C
MtJrith•l.)
les maréchaux
ap·
llent
aiafi une tunteur molle qul vieot
a
dl"OÍte
&
J3Uct)e
tia
jarret
do
cheval. Voici la meilleure
maniel'e de la
gu~rlr.
y
z
une
aigoille d'arg,mt courbe, enfilcz-la avec
n
gro
ftl, faires-la ropgir par le bour. frottea le
61
ec:
de
l'ougu~ot
de fcarabeus ,
& ,.
patlez l'aiguille
ute
rouge au-travers do
t;,/iig••
de bas•en-baut.
our fa
pa(ler pla$ facilernent,
il
faur auparavant
uper
le cuir avec une. lancertct daos t•eodroit
o~
1
n
veur la faire entrer ,
&
daos celui J'lr lequel on
VCilt
1
fi
ire reflortir
1
apres
avqir
palié
l'aig~aille.
6
z-la
1
liez les 'deux bours da
61
en-dehors, refrot•
le &eton
toute~
les •iogt-quatre heures avec le
mfme
on¡uent
jofqu·~
ce
que le
fil
forre
de
lui-Ole–
e¡
il
tooper
te
coit
c¡oa
t:A
eotre les .tcux
4fl–
,.-,.,,
XPI/.
V E S
179
verrures,
&
fans
y
f
ir
aurr
e
c-hofe,
le
ifsig
&
la plaie
e
gu~rironr
;
il
conviene
m~me
d' y
mt't–
tre
le feu , qul n
ll
ne
íeroit
p
s
' reu
; mai1
lorfqu'il
1' ll,
il
n'\' a quo
ce mo,•en qu i puif–
fe }'
rem~Jier,
encoré nc
r
uffir-1l pJ ·couj ur .
VESSIR.
V.
n. (
lernl#
"'Effoy~ur.)
e
mot
e
dit
de
venr que le
f.:
u
&
1'
arr font
1'
rtir ,
lo rfq
tirant l'eiTai , on oe le bifle pas rcfroi
1r
i Ít.>nlible·
ment.
(D.
:J. )
VEST
&
O EVE
T,
(
JuriJPrutl. )
e~
l'a
e
par te–
que) le feigoeu r de"mee le vendcur
d
la po!1effi on
qu'il avoit d'un hérit.lge, pour en
rev~rir
1'
a.:quéreur ;
car
vtjl
lignifie
poffiflit~n,
&
áe-:.
e/1.
¿¿pojfr/i101r;
c'cfi
pourqooi
l'on
de \'roit dire
átvt'j1
&
vtjl,
paree que
l'aéte de
dt't~dl
doit précéder.
·crll IJ
m~me
chofe
qoo
d;fizift"nt
6l
foifint.
Oo appelle
coutumts
áe
vtjl
e
dt'v,¡J
cclles
Jan~
tefquell es l'a cquéreur ne peut
prcndre poCI'elfi0n, fans
y
~ere
auronl<!
plr lt! feigne ur
qui luí donne la faifine op poít effion, &. l'mvellit de
la proprit!ré de l'héritage .
1/oyez
les couwmes de Ref'•
be
u,
Chauny, Laon, Ch!lons, R.eims , R ibermont.
Sedan,
-Ao xerre, Cambr3y, Beauquefne
&
ci-de ant:
le
mot
CouTUM.ESo s sArS&Nit.
(A )
VES
TA, f. f. (Myrlolog.
l
une des plus grande•
déeffes du paganifme, fa
m•
pourrant
~tre
trap con–
nue; c'ell
par
ceere raiíoo qu'
O
vide. voulanc la pla–
cer daos fes
falles,
'hli
die: , dée{le, quoiqu'il ne
., foit
pas
permis aux hommes
de
vous connofrre, •
,
il faur
pourt:~nr
que
íe
parle de vous
,
•
CeulC qni out pénécré le plus avant daos la reli·
gioo des philofophes pyrhagoricieos-, prérendenr que
par
Vtflt~
il&
eo~ndotent
l'oolvers,
a
qui ils attri..
buoient une ame,
&
qu'ils
honorolen~
comme l'u.
nique divinicé, tanr6t lous .le nom
d~
.,:
,,;., , qui
fi–
gnifil! ,,
toul,
t_anc8t rous
le .
nom de , .,., ,
c'ell-~·
<Jire
l'unit'.
Tt'lle étoir, difent· il¡, la figniñcJtioo
myflérieufe de
1/#11,
quoique le vulgaire
l'adorar
comme la dée(fe de la rerre
&
du feu.
La
fable reconnoit
d~ux
déeíles du nom 'de
Pt/111 :
l'une mere,
&
l':tutre filie de Saturne . .
La
premierct
éroic
la
Ter re,
&
·fe
nommoit tantO t
Cibtlt,
&
tan–
rOe
fa16s,
&
la feconde étoit le
Peo~.1 ;
é'etl cetre der–
niere qo'Horace appclle
.tltrltn
1/tftt~,
en
l'honneur
de
llq::eile le religien ·• Numa bihir un temple
a
Ro·
me, .& confacra
a
fiul
colte queJques VÍt'rges romaÍ•
nes, pour cntretenir fur fes autels un
fe u
perpétllel
a,.fin, dit Florus,
e¡
t"etre flamme proceéhice de
l'em¡>ire. vcilllt farli celle
a
l'imiratjon eles atlres.
ut 11J
jimtlllterurn
fllld/
it1m fitlt1'11m,
cuPos imp,rii
jl11mm11 •igilare.l.
A
ociennemment ehcz les Grecs
&
le~
Romains,
il
n'y avoir d'aucre imaie ou íymbole de
Vfjl11 ,
que
ce
feo gard&!
fi
religieufement dans
fes
temples;
&
quand
on
lit
depuis des fluues de
Vtf/4,
elles repréfen •
toient
Pt',/1•,
la
Terr~,
plurót que
P'~/111,
te
Fe
u¡
mais il y
a
beaucoup d'epparence qu'on les confondit
en
fui re. Une des manieres ortfinaires de repreíeater
la déeffe étoit ' en habit de inatrone,
teoant de la
main droite
qn
Aambeau ou une lampe,
&
quelque–
fois un
p111111Jit1m
ou .une pctire vitloire. Les titres
qu'on luí donne dant les médailles, & fur les anciens
manumens, font
Ptft•
l'heureufe, la mere, la fainto
l'c!ternelle-,
&e.
Nous avons parlé de fes
temples.
&
nous nous érendrons beaucoup· fur les veftale1, fea
. prl!trefies.
Le colte de
f/,{14
&
du feu fut apporté de Phry..
gí.e en ltalie par
~née
&
les aurre1 tro·ieo• qui y abor–
ilerent. Vir¡ile obferve qu'Eo&!e av1nc que de fortir
du palais de foo pere, avoit retiré le feu da
foyer
fJCré .
\
.
./8ter,tl"'f*' •tlJtis 'ffirt
fmltrt~libul
Í4nt111
•
.J$neid. /.
JI.
Auffi chaque partic
ulier prir-il foin daos la {uire.
d'entretenir le feu de
Ptfl.lli
la porte
de
fa maifon
¡
& e'etl de-la, felon
Ovad<!, qu'efi venu le nom de
'IJ~{Iihll(~.
Quoi qo'il en foir, les Traieos
&:
les Phry.
gien.s eux-mfmes avoient
re~u
le c:ulte do feo
des
~acres
peuples de I'Orient.
Le
0010
de
Y~flll
eft
fyuonym~
a
c:eloi du
(11#
IP–
pellé par les eirecs
we,
11111t11tti tifiir•ti'"'' ;,.
f/,
par
les
Chalct~ens
&
le~
anciens Perfes,
Av,¡/•.
Ceft autli
(aos doate,
fi
nous en croyons le f.¡vant Hyde, ce
qoi eogagea Zoroaftrc de aonner
~
fon fameuz livre
far le calte
du
feu • le nom
d'A•eft••
c:omme qui
.4iro•r,
lii~ITM
t/tJ
f~t~. ~D.
J.)
~
/
l.
·.
















