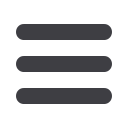
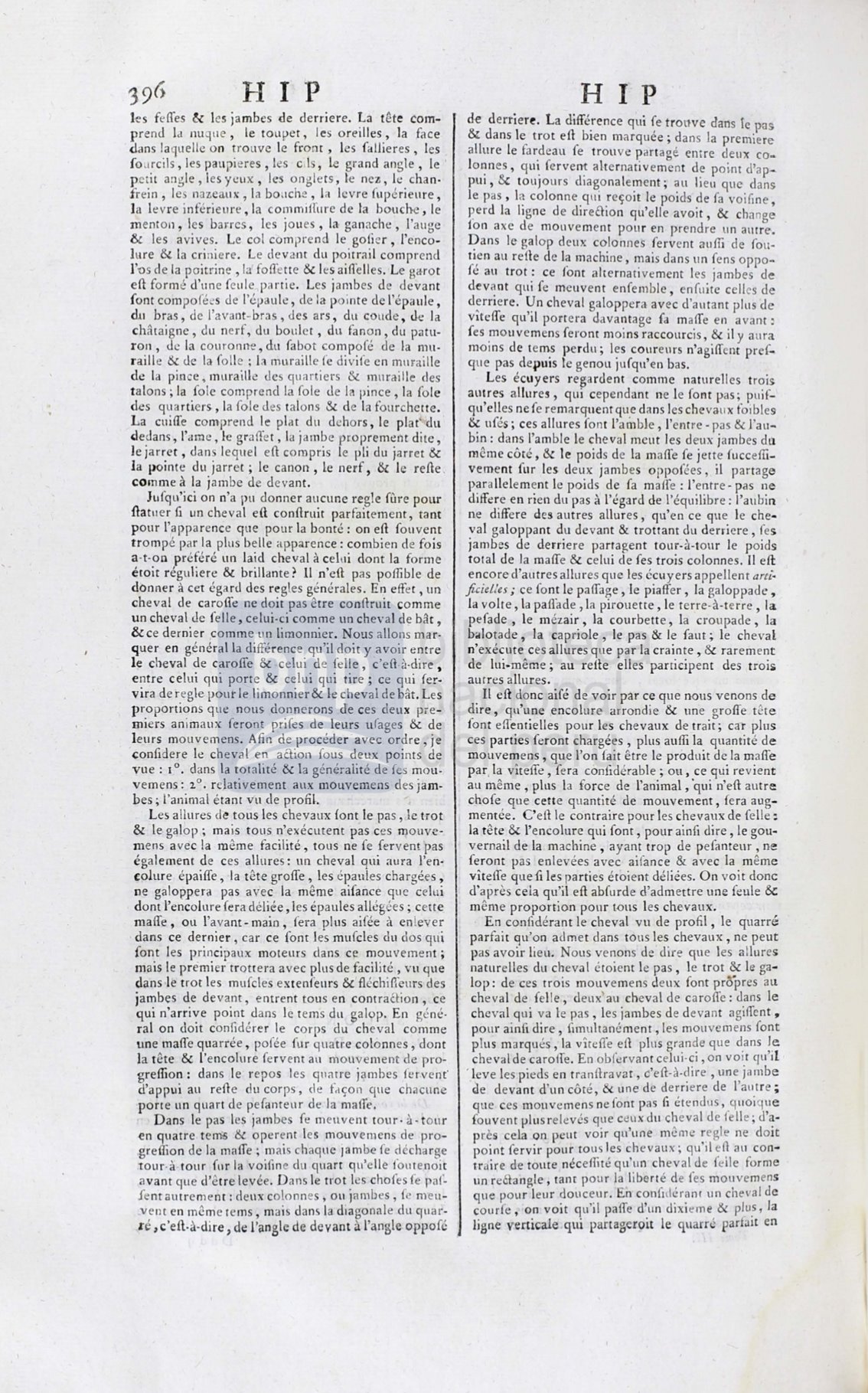
1-I I
P
Jes fe[es
&
les jambes de derriere. La
t &te
com–
prend
Id
nuque ,
le tOL1 pet,
I
es oreilles , la fac e
clans laquelle o n trouve le front , les fallieres, !es
fo
1rcils , Jes paupieres, les
c.ls,
le
grand angle, le '
p eti t angle, les ycux , les onglets, te nez, le chan–
frein , le nazeaux, la bonche , la levre fup e rieure,
l a le vre inferieure , la commi[ure de ta bouche, le
m enton, les barres , !es joues , [a, ganache, l'auge
& Jes avives. Le col comprend le gofi er, l'enco–
lHre
&
Ia cri niere. Le devant du poitrai l comprend
l'us de la poitrine, la fo[ette
&
Jes aiffelles. Le garot
efi fo rme d'une feule pa rti e. Les jamb es de devant
font compofees de l'epaule, de la pointe de l'epaule ,
d.u bras, de !'avant- bras, des ars , du coude, de la
chataigne, du nerf, du boulet, dLi fanon, du p<itu–
rnn, de la couronn-e, du fabot co rnpofe de la mu–
raill e
&
de la Colle ; la murai lle fe divife e n muraille
de la pince, muraille <les quartiers
&
muraille des
t alons; la fo le comprend la fole <le la pince, la Co le
des qua rtiers. , la Cole des talons
&
de la fourchet te.
La cui[e comprend le plat du dchors, le plat' du
d edans, l'arne, le graffet, la jambe pr.oprement dite,
le jarret, clans leque l efi compris le pli du jarret
&
la
J;>Oint e du jarret ; le canon , le nerf ,
&
le refie .
co rnme
a
la jarnbe d devant.
Ju fqu'i ci on n'a pu donne r au cune regle fUre pour
fiatuer
ii
un cheval efi conllruit par fait ement, ta m
pou r l'appa rence que pour la bonte : on ell fouve nt
trompe par la plus belle apparence: combien de fois
a+on prefere un laid cheval
a
celu i dont la forme
ecoit reguliere
&
brillante ? 11 n'efi pas poffible de
don ne r
a
cet ega r<l des regles generales. En effe c, un
cheval de caroffe ne doit pas erre conllruit comme
un cheval de felle, celui-ci comme un cheval de
b~t,
&ce derni er comme un limonnier. Nous allons ma r–
quer en general la difference qu'il doit
y
avoir enc re
le cheval de caroffe
&
celui de felle , c'ell,a·dire ,
e ntre celui qui porte & celui qui tire ; ce qui fe r–
vira de regle pout le limonnier& le cheval de bat. Les
p roportions que nous donnerons de ces deux pie–
rniers an imaux fero nt prifes de leurs u fages & de
leurs mouvemens. Afin de proceder ·avec ordre, je
confidere le ch eva l en action fous deux points de
vu e : 1° . clans la rotalite
&
la generalite de fes mou–
v emens :
2°.
relativement aux mouveme ns des jam.
bes; ['animal etanr v u de
profi~.
Les allures de tous les chevaux font le pas, le trot
&
le galop ; mais tous n'execute nt pas ces mouve·
mens a vec la merne facilite, tous ne fe fervent pas
egalemenc de ces allures : un cheval qui aura l'en·
colure epaiffe' la tete gro[e' les cpaules chargees '
ne galoppera pas avec la meme aifance quc celui
dont l'encolure fera del iee '
Jes
epaules alleg 'es; cett e
maffe,
OU
!'avant- mai o, fera plus aifee
a
en lever
· clans ce dernier, car ce font Jes rnu fcles du dos qui
font !es principaux moteurs clans ce mouvernent;
mais le premier trottera avec plus de facil ite, vu qu e
clans ,)e trot !es mufcles ex tenfeurs & flechiffours des
jamb es de de vant, entrent tous en cont raClion , ce
qui n'arrive point clans le terns du galop. En ge ne–
ral on doit con!iderer le corps du cheval comme
une maffe qua rree , pofee fur quatre wlonn es, dont
la tete
&
l'encolure fe rvent au mouvement de pro–
greffion: clans le repos les quatre jambes fervent"
d'appui au relle du corps , de
fa~on
que chacune
pone un qua rt de pefanteur de la ma<fe.
Dans le pas Jes jambes
fe
meuven t tour - a-tour
en quatre rem;<;
&
operent les mouvemens de pro–
.greffio n de la rnaffe; mais chaque jambe fe decha rge
tour-a-tour fur la voifine du quart qu'elle fourenoi t
avant que d'etre levee. D ans le tro t les chofes fe
pal~
fent autrement: deux colonnes,
0 11
jambes, fe meu–
vent en rneme re ms, mais clans la diagonale du quar–
re
,c'efi- a-dire' de !'angle de devant
a
!'angle oppofe
HIP
d·e derriert. La diffe.rence qui
~e
trollve clans le pes
&
clans le trot ell bi-en marquee; clans la premiere
allu re le fardeau fe trouve part aoe enrre deux
co–
lo~ nes , qu~ ferven~ alternativem~nt
de
po ~nt
d'ap–
pu1,
&
to uiours d1agona lement; au li eu que clans
le pas , la colonne qui
re~oit
le poids de fa voifine
~erd
la ligne de direction qu'elle avoit,
&
cha ng;
Ion axe de mouvemenr pou r en prendre un aurre.
D ans le galop deux colonnes fervent auffi de fou–
tien au relle de la machine, mais clans un fens oppo–
fe au trot: ce
font
alterna tivement Jes jambes de
dev~ or
qui fe meuv enr enfemble , enfuite celles de
dernere. Un cheval galoppera avec d'autant plus de
vite[e qu'i l portera dava ntage
fa
maffe en avant:
fes ,mouvemens feront moins raccourcis, & ii y aura
morns de terns perd u; les coureurs n'agi tfent preC–
que pas depuis le genou jufqu' en bas.
Les ecuyers regarde nt comme nature.lies trais
autres allures , qui cependant ne le font pas; puif–
qu'elles ne fe remarquenr que clans les chevaux foibles
&
ufes; ces allures fon t !'amble, l'entre . pas & l'au–
bin: clans !'ambl e le cheva l meut les deux jambes da
meme cote ' & le poids de la maffe fe jette fucceffi–
veme nt fur les deux jambes oppofees, ii panage
parallelement le poids de fa ma[e: l'entre · pas ne
differe en rien du pas
a
l'egard de l'equilibre: l'aubi n
ne differe des autres allures, qu'en ce que le che–
val galoppant du de vant
&
trottant du derriere, fe s
jambes de derriere partar;ent tour-a-tou r le poids
tor al de la malfe & celu i de fes trois colonnes. II ell:
encore d'autres allures qu e les ccuyers appellent
arti':.
ficielles;
ce fo nt le pa[age, le piaffer, la galoppade ,
la volte, la pa lfa de, la pirouette, le terre-a-terre, la
pefade ' le mezair' la courbette ' la croupade' la
b;ilotade , la capriole, le pas
&
le faut; le chevat
n'execure ces allures que par la crainte,
&
rarement
de lui-meme ; au refte elles participent des troiso
au cres allures.
II eft done aife de voir par ce qu e nous ve nons de
dire, qu'une encolure arrondie
&
une groffe t ' te
font effenti elles pour les chevaux de trait; car plus
ces parties feront chargees, plus auffi la quantite de
mouvemens, que l'on fait etre le prod uit de la maffe
par, la viteffe, fera confiderable; ou , ce qui revient
au meme ' plus la fo rce de !'animal '"qui n'ell aut re
chofe que cette quantite de rn ouvemenr, fera aug–
mentee . C'e!l le contraire pour les chevaux de felle :
la te te
&
l'encolure qui font, pour ainfi dire, le gou–
vernail de la machine , ayant trop de pefa nteur, ne
fe ront pas enlevees avec aifance
&
avec Ia meme
vite[e que files pa rties etoient deliees. On vo it done
d'apres ceia qu'il ell abfurde d'admettre une feule
&
meme proportion pour
l-0115
[es chevaux.
En confiderant le cheval vu de profil , le quarre
parfai t qu'on ad met clans tous !es chevaux, ne peut
pas avoir lieu. Nous venons de dire que Jes allures
natu relles du cheval etoient le pas' le trot
&
le ga–
lop: de ces rro is rnouvemens deux font propres att
cheva l de felle, deux au cheval de caro[e: <lans le
cheval qui va ie pas , !es jambes de devant agiffent,
pour ainfi dire, fimultane ment, les mouvemens font
plus marques, la vite[e ell plus
gr~n~e
que d_ans
!,e
cheval de caro[e. En obferva nr celu1-c1, on volt qu 11
· !eve les pieds en tranllravar,
c'ell:-a -~ire
, une)ambe
'1e deva nt d'un cote
&
une de demere de 1autre ;
que ces mouvemens'ne font pas
fi
etendus, quoiq ue
fou vent plusrelev 's
q~1e
ce,ux du
c~e val
de fe ll e;
d'~pres cela on peut vo1r qu une meme r,egle ne do1t
point fervir pour ton s 1,es
~hevaux;
qu'1l
e~
au con–
traire de route neceffire qu un che val de fetle forme
un retla ngle, tanr pour la libe rt e de fes mouvemens
que pour leur douceur. En conf1dcran1 un cheval de
courfe, on voit qu'il pa[e d'un dixi eme
&
plu_s, la
ligne verticale qui panager9it le quarr ' parfait en
















