
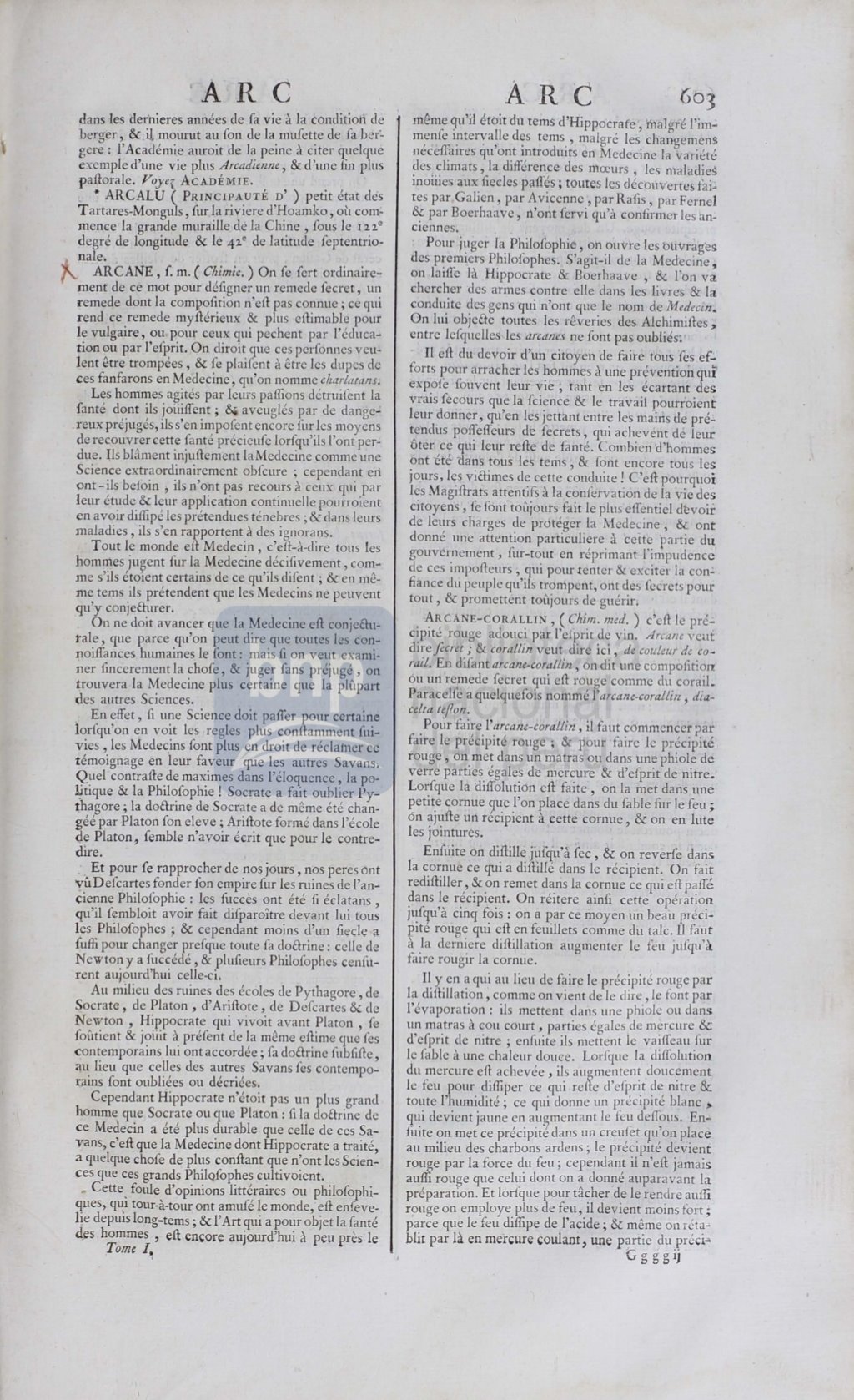
' A
R
e
dans les derhieres années ele [a vie
a
la conelitioh de
berger,
&
iJ.
mourut au (on ele la mu(ette de (a
ber~
ocre: l'Aeadémie auroit de la peine
a
citer quelque
~xemple
d'une
vie
plllS
Arcadienne,
&
d'une fin plus
pafiorale.
.voye{
ACADÉMIE.
.. ARCALU ( PRINCIPAUTÉ D' ) petit état des
T artares-Monguls, (ur
la
riviere d'Hoamko, 0\1 com–
menee la grande muraiUe de la Chine , (ous le
12.2·
degré de longitnde
&
le
41."
de latitude (eptcntrio–
nale.
ARCANE, (. m. (
Chimie.
)
On (e (ert ordinaire–
ment de ce mot pour défigner un remede [ecret, un
i"emede dont la coml?ofition n'efi pas eOnnlle ; ce qui
rend ce remede myfiérieux
&
plus efiimable pour
le vulgaire, Oll pour eeux qui peehent par l'éduea–
tion ou par l'e(prit. On diroit que ces pononnes veu–
Ient &tre trompees,
&
[e plai{ent
a
&tre les dupe de
ces fanfarons en Medecine, qu'on nomme
c/ltlrlatans.
Les hommes agités par leurs pallions détnlilent la
fanté dant
ils
joiiiifent;
~
aveuglés par de dangc–
reux préjugés, ilss'en impo(ent encore (ur les moyens
de recouvrcr cette (anté précieufe lorfqu'ilsl'ont per–
due. Ils
bl~ment
injuíl:ement laMedecine comme une
Science eJ..'traordinairement obfcure ; eependant eIt
ont-ils beioin , ils n'ont pas recours
a
ceux qui par
Ieur étude
&
leur application continuelle pourroient
en avoir dillipé les prétendues ténebres ;
&
dan~
leurs
maladies, ils s'en rapportent
a
des ignorans.
Tout le monde
ea
Medecin , c'eit-a-dire tOllS les
hommes
ju~ent
[ur la Medecine décifivement, com–
me
s'ils
étolent certains de ce qu'ils difent ;
&
en m&–
me tems ils prétendent que les Medecins ne peuvent
qu'y conjefrurer.
On ne doit avancer que la Medecine efi conjeau–
tale, que parce ql.l'on peut dire que toutes les C0n–
noiifances humaines le
iont:
mais fi on veut exami–
ner flllcerement la cho{e,
&
juger fans préjugé> on
trouvera la Meelecine plus certaine c¡ue la plllpart
des autres Sciences.
En effet, fi une Science doit paíl"er pour certaine
Ior{qu'on en voit les regles plus confiamment {ui–
vies, les Medec,ins {ont plus en droit de réelafner ce
témoignage en leur faveur que les autres Savans.
Que! contrafie de maximes dans l'éloquence , la po–
~tique
&
la Philo{ophie
!
Socrate a fait ouhlier Py–
thagore ; la dofuine de Socrate a de m&me été chan–
géé par Platon Con eleve; Ariaote formé dans l'école
de Platon, {emble n'avoir écrit que pour le contre–
dire.
Et pour (e rapproeher de nos jours , nos peres ont
'VuDe{cartes fonder Con empire {ur les mines de l'an·
cienne Philo{ophie : les {ucces ont été fi éclatans ,
qu'il {embloit avoir fait di{paroltre devant lui tous
les Philo{ophes ;
&
cependant moins d'un fieele a
{uffi pour changer pre{c¡ue toute {a dofuine : celle de
Newton ya {uccédé ,
&
plufieurs Philo(ophes cenfu–
rent aujourd'hui ceue-ci.
Au milieu des ruines des écoles de Pythagore , de
Socrate, de Platon , d'Arifiote, de De{cartes
&
de
Newton , Hippocrate qui vlvoit avant Platon , (e
fOlttient
&
joiiit
a
pré{ent de la m&me efiime que {es
rontemporains lui ontaccordée; {a dofuine {ub{¡{le ,
au lieu que celles des autres Savans {es contempo–
rains (ont oubliées ou déeriées.
Cependant Hippoerate n'étoit pas un plus grand
homme que Socrate ou que Platon :
ú
la dofrrine de
ce Medecin a été plus dnrable que celle de ces Sa–
vans, c'efi que la Medecine dont Hippocrate a traité,
a quelque chofe de plus confiant que n'ont lesScien–
ces que ces grands PhilQ[ophes cultivoient.
Cette fonle d'opinions littéraires ou philo(ophi–
ques,
~i
tour-a-tour ont amuré le monde, eíl: en{eve–
líe depuls long-tems ;
&
l'Art qui a pour objet la {anté
des hommes , eJl encore aujourd'hui
a
peu ¡¡res le
Tome
1,
ÁRC
m~me
gu'il étoit du temSd'Hippoerafe, llialgré
l'im~
m;n{e 1.nterva!le d:s tems., malgre les changemen;
neceíl"alres qu ont IIltrodluts en Medeclne la variéte
des elimats , la différence des mreurs ,
les
maladieS
inoiiies aux fieeles paíl"és ; tomes les découVertes tai–
tes par Galien, par Avieenne ,parRafis, par Fernel
&
par Boerhaave, n'ont (ervi qu'a connrmer les an–
ciennes.
Pour juger la Philo(ophie, on ouvre les
btrvrag~s
des premiers Philo[ophes. S'agit-il de la Medecine,
on laiíl"e
h\
Hippocrate
&
Boerhaave ,
&
ron va
ehercher des armes contre elle dans les livres
&
la
conduite des gens qui n'ont que le nom de
Medecin.
On lui objeae toutes les r&veries des Alchimifres,
'entre le{qnelles les
arcams
ne [ont pas oubliés:
Il
efi du devoir
d'1l11
citoyen de fuire tous fes
ef~
fons pour
~rraeher
les hommes
a
une préventionqut
expoie {ouvent ¡eur vie ; tant en les écartant des
vrais {ecours que la {cienee
&
le travai! flourmient
leur donner, qu'en les jettant entre les mains de pré–
tenelus poíl"eíl"eurs de (ecrets, qui acheveht de leur
oter ce qui leur refie de {anté. Combien 'd'hommes
ont été dans tous les tems ,
&
{ont encore tous les
jours, les viilimes de cette conduire! C'eíl: pourquoi
les Mngifirats artentifs
a
la eon{ervation de la vie des
citoyens, {e {ont tolljOUts fait le pluseíl"entiel dt::voir
de leurs charges de protéger la McdeLine,
&
ont
donné une attention particuliere
a
cette partie du
gouverncment,
{ur-tout
en réprimanr l"impudence
de ces impofieurs , qui pOLU tenter
&
excitel la
con~
nance du peuple qu'ils trompent, ont des {ecrets pour
tout,
&
promettent tOlljours de guérir.
ARCANE-CORALLIN, (
Chlm. medo
)
e'efi le
pré~
cipité rouge adouci par l'eiprir de vino
Arcane
veut
dire
¡ecret
;
&
coral/in
veut dire iei,
de couleur de co–
rail.
En di{ant
arcane,.coral/in,
on dit une compofitiofI
OH un remede {eeret qui eíl: rouRe comme du coraiL
Paracel{e a que!quefois nommé
1
arcane-coTaUin
;
dia–
ceita
tif/:Oll.
Pour faire
l'arcane-coraUin,
il faut commencer par
faire le précipiré muge;
&
pour faire le précipité
rouge, on met dans un matras ou dans une phiole de
veLTe parties égales de mcrcure
&
d'e(prit de nitre.
Lor{qüe la diíl"olution efi faite, on la met dans une
petite cornue 9uC l'on place dans du Cable
[ur
le feu ;
ón ajufie un recipient
a
cette cornue,
&
on en lute
les jointlll"éS.
En(uite on dinille ju[qu'a (ec ,
&
on rever[e dans
la cornue ce c¡ui a diO:ilIé dans le récipient. On faie
redifiiller,
&
on remet dans la cornue ce qui eO: paíl"é
dans le récipient. On réitere ainfi cette opérarion
ju[~u'a
cinq fois : on a par ce moyen un beau pnki–
pite rouge qui efi en feuillets comme du talco
II
faut
a
la derniere diíl:illation augmenter le feu ju{qu'a.
faire rougir la cornue.
n
y en a qui au lieu de faire le préeipité muge par
la di!tillarion , comme on vient de le e1ire , le font par
l'évaporation: ils mettent dans une phiole ou dans
un matras
a
cou court, parties égales de
m~rcure
&
d'e(prit ele nitre; enfuite ils mettent le valíl"eau {ur
le Cable
a
une chaleur douee. Lorfque la diíl"olution
du mercure eíl: achevée , ils augmentent doucement
le feu pour dilliper ce qui relle d'e(prit de nitre
&
toute I'hllmidité; ce qui donne un précipité blanc
J>
ql~i
devient jaune er:
a~19mel1tant
le feu deíl"?lls. En–
{¡llte on
m~t
ce précJpne dans un creuíet qu on place
au milieu des charbol1s ardcns ; le précipité devient
rouge par la force dll feu; cependant il n'efi jamais
auffi rouge que celui dont on a dOl1né auparavant la
préparation. Et lonque pour
t~cher
de le rench e auíIi
rouge on employe plus de fen, il devient moins lort ;
parce que le feu dillipe de ,'acide ;
&
meme 011 r
ta–
blit par
la
en mercure coulant,
une
partie du préci"
Gg
ggij
















