
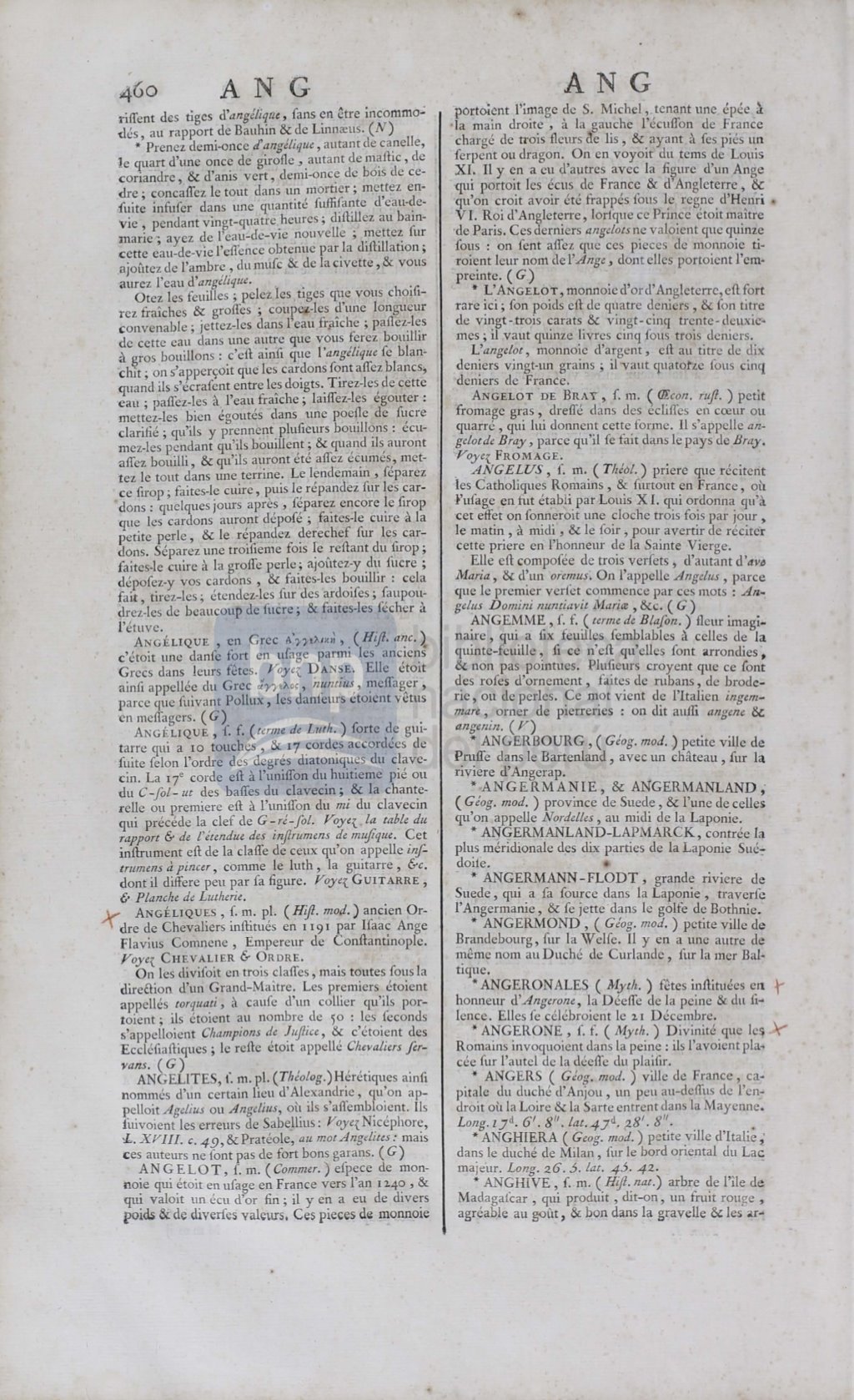
ANG
riíI"ent des riges d'
angéliqtlt,
fans en
~tre
¡ncommo":
~és
au rapport de Bauhin & de Linnreus.
eN)
*'
Prenez demi-once
d'
angJliqlle
,
autanr de ca.nelle,
le 'Iuart d'une once de girofle, .autant de
m~lhc
, de
coriandre, & d'anis vert,
deml-onc~
de bOls de ce–
dre' concaíI"ez le tout dans un moruer; mettez en–
{uit;
infufer dans une quantité
fuRi1¡Il~te d'eau.~e
vie, pendant vingt-quatre .heures; d¡/1:illez au bam–
marie, ayez de l'eau-de-vle nOllvelle ;
~n7tte~
fUI
.cette eau-de-vie l'eíI"ence obtenue par la d¡/1:illauon;
ajoutez de l'ambre , du mtúc
&
de la civette,
&
vous
amez I'eau
d'angélique..
.
Otez les feuilles ; pelez les t1ges que vous chOlft–
rez fralches
&
groíres ;
coup~-Ies
d'une longueur
convenable; jettez-les dans l'eau fr¡¡lche ;
paíI"ez~l~s
de cette eau dans une autre que vous ferez bouillir
a
gros bouillons : .c'eí1: ainft e¡ue
l'angéliqlle
fe blan–
chit; on s'apperC;OIt que les car?ons fc:nt affezblancs;
quand
ils
s'écrafent,entre
l~s
dOlgtS ..
Tlrez-le~
de cette
eau ; paírez-les
a
I eau fraJche; lalírez-les egouter :
mettez-les bien égoutés dans une poe{le de fucre
clariñé ; qu'ils y prennent plufieurs bouillons: écu–
mez-les pendant qu'ils bouillent ; & 'Iuand ils auront
~íI"ez
bouilJi, & e¡u'ils auront été aírez éc.umés,' met–
tez le tout dans une terrine. Le lendemalll , feparez
ce ftrop . faites-Ie cuire, lmis le répandez fur les car–
dons:
e¡~lclques
jours
apre~
,
f~pare~
encore !e ftrop
'Iue les cardons auront depoCe ; faltes-le cUlre
a
la
petite perle, & le répandez derechef fm les car–
dons. Séparez une troifieme fois fe reíl:ant du ftrop;
faites-Ie cuire
a
la groffe perle; ajoútez-y du fucre ;
dépo(ez-y vos cardons , & faires-les
b~:)Uillir
: cela
fait tirez-les; étendez-Ies [ur des ardolfes; faupou–
dre;-Ies de beaucoup de Cucre;
&
faites-les fécher
a
l'étuve.
ANGÉLIQUE , en Grec
A'-r-r.AIX')
, .
(Hijl.
a~c.),
c'étoit une danCe fort en ufage parml les anClens
Grecs dans leurs fétes.
Yoye{
DANSE. Elle étoit
ainíi appellée du Grec
.J./'-r,AO~,
;mnti'as,
meffager ,
parce e¡ue fuivant Pollux , les danCeurs étoient vetuS
en meíragers.
e
G)
.
ANGÉLlQUE,
f.
f.
e
mme de LutIL.
)
forte de gUl–
tarre
e¡ui
a
10
touches,
&
17
cordes accordées de
fuite Celon l'ordre des degrés diatonie¡ues du clave–
cin. La
1
i
cOl·de eíl:
a
l'uniíron du huitieme pié ou
'¿u C
-fol -
lLl
des baíI"es du clavecin; & la chante–
relle ou premiere eíl:
a
l'uniíI"on du
mi
du clavecin
e¡ui précéde la clef de
G
-
ré
-fol. Voye{ la tabte dlt
rapport
&
de t'étendue des injirumens de mujique.
Cet
I
inll:rument eíl: de la claíI"e de ceux e¡u'on appelle
inf–
lrwnens
ti
pine."
comme le luth, la guitarre,
&c.
dont il differe pen par fa figure.
Voye{
GUITARRE,
&
PlancILe de LIIlILerie.
)(' ANGÉLlQUES,
f.
m. pI.
e
Hijl.
modo
)
ancien Or–
dre de Chevaliers inilitués en
1191
par Ifaac Ange
Flavius Comnene, Empereur de Coníl:antinople.
Yoye{
CHEVALIER
&
ORDRE.
On les diviCoit en trois claíI"es,
mais
toutes fous la
rureétion d'un Grand-Maitre. Les premiers étoient
appellés
torquati,
a
cau(e d'un collier qu'ils por–
toient; ils étoient au nombre de
50 :
les feconds
s'appelloient
Clzampiolls de 1ujiiee,
& c'étoient des
Eccléíiaíl:ie¡ues ; le reíl:e étoit appellé
CILeyatiers jer–
yans. (G)
ANGELlTES, l. m. pI.
(Théolog.)
Hérétie¡ues ainft
nornmés d'un certain lien d'Alexandrie, qu'on ap–
pelloitAgelius
ou
Angelius,
011 ils s'airembloient. lis
fnivoient les erreurs de Sabellius:
Voye{
Nicéphore,
-.L.
XVIII. c.
49,
&Prateole,
a/l mOl Angdius:
mais
ces auteurs ne font pas de fort bons garans.
(G)
AN G ELOT,
f.
m.
(Commer.)
e(pece de mon–
noie e¡uí étoit en u(aae en France vers l'an
12.40 ,
&
ql~
valoit
u~
écu dl'or
fin;
il
Y
en a eu de
dive~s
pOlds
&
de dlverfes vale\U"s. Ces pieces de monnOle
ANG
portoient l'image de S. Michel, tenant une épée
~
la main droite,
a
la gauche l'écuíron de France
chargé de !rois f1eurs de lis, & ayant
a
fes piés un
ferpent on dragon. On en voyoit du tems de Lonis
XI. 11 Y
en a eu d'autres ave
e
la
fi~ure
d'un Ange
qui portoit les éClls de France
&
d AngletelTe,
&
qu'on croit avoir été frappés fous le regne d'Heuri .
VI.
Roi d'Angleten'e, lorique ce Prince étoit maitre
'de
Paris.
Ces derniers
angelols
ne valoient e¡ue Cfuinze
fous : on fent aírez e¡ue ces pieces de monnoie ti–
roient leUl' nom
del'Ange,
dont elles portoient I'em–
preinte.
( G)
..
~'.AN
GELO.T , monnoie d'ord'Angleterrc,eíl: fort
Tare
~CI;
fon pOlds eíl: de quatre deruers , & (on titre
de
vll~gt
-trois
~arats.
&
vi~gt-
cine¡ trente- deuxie–
mes; il vaut e¡umze ltvres eme¡ fous trois deniers.
L'
angelol,
monuoie d'argent, efi au titre de dix
deniers vingt-un grains ; il -vallt quatorze Cous cinq
deniers de France.
ANGELOT DE BRAY,
f.
m. \
(JIcon.
rufo.
)
petit
fromage gras, dreffé dans des ecliíles en cceur OH
quarré, qui luí donnent cette forme.
Il
s'appelle
an–
gelotde Bray ,
parce qu'il fe faít dans le pays de
Bmy.
YQye{
FROMAGE.
.
ANGELl1S,
f.
m. (
Tlzéól. )
priere que récitent
les Catholiques Romains,
&
furtout en France on
}'túage en fut établiyar Louís
XI.
qui ordonna qu'a
cet
eff~t
on
fo~erOlt
une
~Ioche
troís fo!s par jonr ,
le matln ,
a
mIdl , & le
fOlr
,
pour avertIr de réciter
celte priere en l'honnem de la Sainte Víerge.
Elle eíl: compo(ée de trois verfets, d'autant d'4Y"
Maria,
& d:llU
oremus.
On l'appelle
AngeltlS,
parce
que le premler ver(et commence par
ces
mot5 :
An–
ge{¡lS Domini nllntiayit Marial
,
&c.
e
G)
ANGEMME, f. f.
(terme de BtaJon.
)
fleur irnagi–
na!re, e¡ui. a íix feuill;s
fem~lables
a
celles de la
e¡umte-feUllle,
Ji
ce n eft e¡u elles font arrondies
& non pas pointues. Pluíieurs croyent que ce fon:
d.esrofes d'ornement, faites de rubans, de brode–
ne, ou de perles. Ce mot vient de l'Italien
ingem–
mare
, .
omer de pierreríes : on dit auiIi
angene
&
angemn. (V)
*
ANGERBOURG, (
Géog. modo
)
petite viUe de
Pruíre dans le Bartenland , avec un chateau [ur la
riviere d'Angerap.
'
*
ANGERMANIE, & ANGERMANLAND '
( Géog. modo
)
province de Suede , & I'une de celle;
qu'on appelle
Nordeltes,
au midi de la Laponie.
*
ANGERMANLAND-LAPMARCK, contrée
la
plus méridionale des dix parties de la Laponie ué–
doite.
*
ANGERMANN-FLODT, grande riviere de
Suede, cmi a fa fource dans la Laponie, traverfe
l'
Angermanie, & fe jette dans le golfe de Bothnie.
*
ANGERMOND,
e
Géog. modo
)
petite ville de
Brandebourg, fur la \Velfe.
Il
y en a une autre de
meme nom au Duché de Curlande, Íllr la mer
Bal·
tique.
*
ANGERONALES (
Myth.
)
f&tes iníl:ituées en
t–
honneur
d'Angerone,
la DéeíI"e de la peine
&
du ft..
lence. Elles fe celébroient le
2.1
Décembre.
*
ANGERONE,
f.
f.
(MytIL.
)
Divinité e¡ue
lc~
\'
Romaills invocluoient dans la peine: ils l'avoient pla.
cée Cur I'autel de la déeíI"e du plaifu.
*
ANGERS (
Géog. modo
)
ville de France, ca–
pitale du duché d'Anjou, un pell au-deffus de l'en–
droit ollla Loire & la Sarte entrent dans la Mayenne.
Long. z,7d.
6'.
8 /1. lal.4,7d.
(2.8'.
8/1.
.
*
ANGHIERA (
Geog. modo
)
petite ville d'Italie ;
dans le duché de Milan , fur le bOTd oriental Ju Lac
majeür.
Long. 26.'s. lat. 4's· 42.
*
ANGHIVE,
f.
m.
e
Hifl· nat.)
arbre de 1'lIe de
Madagalcar , qui produit , dit-on, un frllit rou¡::e ,
agréablc au g<>tlt ,
&
hon dans la gravelle
&
les ar-
















