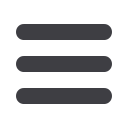
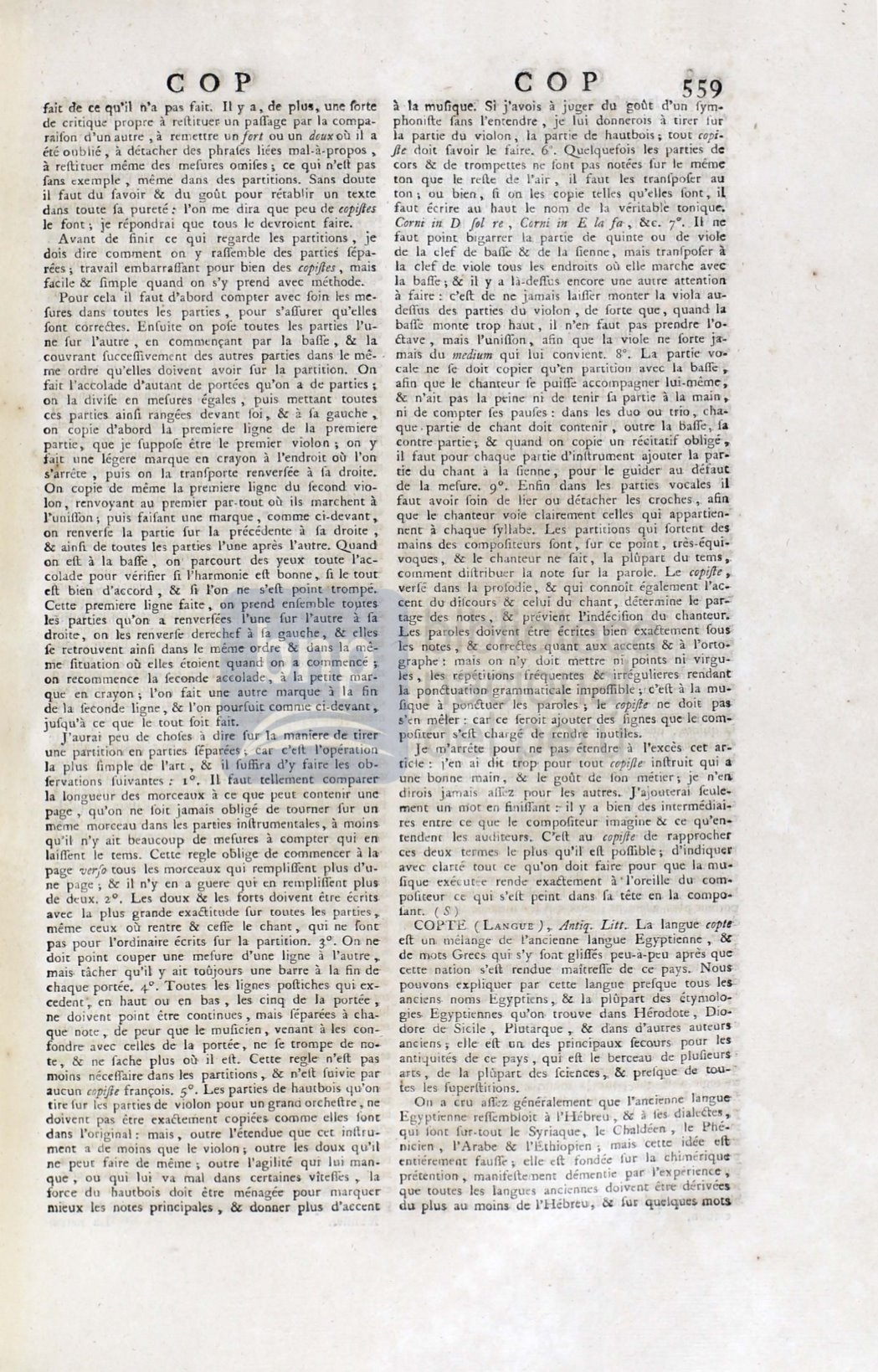
COP
fait de cc
qu'il
n'a pas fa it. 11
y
a,
de plu!,
unc rorte
de critique propre
a
rdlituer. un pa!fage par la compa–
raifon d'un atitre ,
a
remetcre un
forl
ou un
doux
ou ii a
ere onblie ,
a
detacher des phrafes liees mal-a-propos ,
a
reftituer memc: des mefures omifes; ce qui n'ell pas
fans
oxernpk • meme dans des partitions. Sans doute
ii faut du favoir
&
du gout pour rfaablir un texte
dans toute
fa
purete
~
l'on me dira quc: peu
de
copijies,
k
font; je repondrai que tous le devroient faire.
Avant de
finir ce qui
r"garde Jes partitions, je
dois dire comment on
y
raffemble des pan ic$ fepa–
rces ; travail embarra!fant pour bien des
copijles ,
rnais
facile
&
fimple quand on
s'y
prend avec methode.
Pour cela ii faut d'abord compEer avec foin h:s me–
fures clans toutes les parties , pour s'aliurer qu'dles
font corrcCl:es. E n[uite on pofe tomes les parries
J!u–
ne fur
l'autre , en commenyant par
la ba!fe ,
&
la
couvrant fucceaivement des autres parties clans le me- .
me ordre qu'ell"s doivent avoir fur la partition. On
fait l'actolade d'autant de portees q,u'on
a
de:
parties~
on la divife en mefures egales , puis. mettant
toutes
ces p arties ainft rangees devant foi .
&
a
fa gauche •
on copie d'abord la premiere
ligne de la premiere–
p artie , que je fuppofe etre le premier violon; on
y
fait tine legere marque en crayon
a
l'endroi.t 0\1
l'on
s'arrete , puis on la tranfporte rerwerree
a
fa
droite_
On copie de rneme la premiere ligae du fec0ad: vio–
lon-, renvoyant au premier par-tout ou ils marchent
a
l'uniffon; puis faifant une marque , com
me
cr-dev.ant,,
on renverfe
la partie fur la precedence
a
fa
droite ,
&
ainfl de toutes !es parties. l'uae apres. l'amre. Q_uand
on ell:
a
la balfe , on• parcourt des yemc toute l'ac–
col.ade pour verifier
ft
l'harmonie e!l: bonne ,, fi le tour
ell:
bien d'ac;cord ,
&
r~
l'on· ne s-'eft point trompe..
Cette premiere ligne faire-,, on pr.end enfem ble toµies.
les parties. qu'on· a renver.fees
l'une fur l'autre
ii: fa
droi·te' on h:s ren v.erfi:: derechef a·
fa
gauche '
&
elles.
fe
rctrouvent ainfi clans le memc- ordre
&
dans la me–
me-
fituation
OU
elles eroient quand
OD•
a.
cornmence ;,
0 11l
~ecommence
la fecoode ac£olade'
a
la petice· mar–
q,u.c en crayon ; 1'011' fai t une autre marque
i
la fin:
de la feconde ligne,
&
l'on pourfuit comrue ci-devant,,
jufqu'a ce que le tout foit fait.
J'aurai peu de chofes
a
dire fur
la
maniere de tirer
uni: pa-r1itio0< en parties. ff[>ar.ees
~
car c'dl: !'operation
la plus fi mple de !'art,
&
il fufE:ra d'y faire Jes ob–
fervations fuivantes
:
i
0 _
11
fau t telkmenr comparer
la longueu r des morceaulC
a
cc· que peut cootentr une
page , qu.>on ne foit j amais oblige de tourner fur un:
meme morceau clans k s. parnies
inftrumenual~s ,.
a
moins–
qu'il·
n'y
ait beaucoup de mefore'
a
compeer qui en•
lai!fent
le
terns. Cette regle o5lige de: commencer
a
la·
page
vet"f1>
tous Jes morceaux qui remplilfent plus d'u–
ne page;
&
ii n'y en a guerl!' qur en rempli!fent plus•
de dcux.
2
°.
Les doux
&
Jes forts doivent
ecre
ecrits.
avec la plus grande exaCl:irnde fur toutes les parti"s,.
meme ceux ou rentre
&
celfe
le chant, qui nc: Cone
pas pour l'ordinaire ecrits- fu r la
parti~ion_
3°. O :i, ne
doit point coi,iper une mefure d'une ligne
a
l'autre ,.
mais- tacher qu'i1
y
air toojours um: barre
a
la fin de·
chaque portee.
,~
0
•
Toutes- !es- lignes- poftiches qui, ex–
cedenc , en haur ou en bas ,. Jes ciaq· de:
la portee ,
ne doivent point etre continues , mais feparees
a
d1a–
que note , de: pe1Jr' que
le
muficien, veoant
a
les con–
fondn:· avec celles di!'
Ja.
portfr,. ne fe trompe de no•.
te ,
&
ne fache plus oU.
ii
ell:.
Cette regle· n'eft pas
moins necelfaire dans les partitions ,
&
n'c!l fo ivre par
aucun
copijle
franyois.
5°.
Les panies- de haucbois qllo'on
tire fur ks parties de violon pour un grand orcheftre, ne
doivenc pas fare exaClemrnr copiees. comme elles font
d ans !'original: mais , ourre l'etendue que cct infi ru–
ment a de moins que le violon; outre Jes doux q u'rl
ne peur faire de meme ; outre l'agilite qur lui man–
q ue , ou qui lui va mal da
ns certaines vlteffes ,. ·1a
force du hautbois doit etre menag.ee pour marque•
mieux Jes notes principales ,
&doaoer- plus d'aecent:
c
0
p
559
~
b
mulique:·
Si
j'avois
a
juger du gout d'un fym·
phoni!l:e fans l'encendre ' je lui donnerois
a
ti~cr
fu r
la panie du violon, la partie de hautbois ; tout
copi–
j fr
<loit fa voir le faire.
6'.
~dquefois
!es parties de
cors
&
de trompettes ne fon t pas notfes Cur le:
rneme
ton. que le rd le de !'air ,
ii.
faut
les. tranfpofer au
ton ; ou bien ,,
fi.
on les copie 1clles qu'elles font, ii
faut ecrirc: au haut
le nom de
la veritable tonique-.
Cornr in D fol
re
,
Corni
in
E la fa
, &c.
7°.
11 ne
faut point b1garrer la partie de- quiace ou de: viofe
de la ckf de baffe
&
de la flenne ' mais trw fpofer
a
la ckf de viole tous
le~
en<lroits 01'.1 ell.e marche avec
la ba!fe- ;
&
il y
a
la-delfus encore une aucre attention
a
fai re: c'efl de ne j,amais laiffer mooter la viola au–
delfus des, parties du vioton , de forte que, quand la
balfe monte trop haut, ii n'en· faut pas prend.rc- L'o–
Cl:ave , mais l'uni(fon., afin que la viole ne forte
ja-–
mais du.
medium
qur Jui convient.
8' . L a.
par~ie·
vo-–
cale .ne fe- doit copier qu'en par.tition avec la baife-,.
afin que Je Ch'<lnceur
fr
puiffi: accompagnet lui-meme,
&
n'ait pas la peinc nt de tenir·
fa
partie
a
la main ..
ai de compter· fes paufes. : clans les du°' ou• tFio ,, cha–
quc: . partie de chant doit concenir, outre la tialfe,
fa
contn:· partie ;.
&
quand on copie un
re~itatif
oblige·,.
ii faut pour chaque partie d'infirument ajouter la par·
rie du chant
a
la fienne" pour le guider au. defaut.
de la mefure.
9
°.
E nfin clans Jes. parties vocales
ii
faut avoir foin de lier ou• detacher Jes croches.,. afin
que le chanteur v-oie clairement cdles qui appartien–
nent
3-
ch.aque fyllabe. L es partitions qui fortent des
mains. des compoftteurs font ,. fur ce point, trcs-equi–
voq,ues ,,
&
le- chanceur ne fair, la plupart du· terns.,
<Wrnment dillribuer la note for la parole. L e
copijle ,
v-erfe dans la profodie ,
&
qui connoit egalement !'ac–
cent du- difcours
&
celui du chant, determine le par.:.
tage- des. notes ,
&
previent l'indecifion du• cl1anteur.
Les paroles <loivent fare ecrites bien exactemcnt fous
Ies
notes,
&
correch:s quanr aux accents
&
a
l'orto•
graphe : mais on n'y duit metrre oi paints ni v.irgu–
les, !es
r.epetitions. frequentes
&
irregul1ere:. rendant
Ia.
poncluaoioo grammaricale impoffible
;«>'ell:
a
la mu–
fiq
ue
a
pontluer k s paroles, ; le
copijle·
ne
doi~
pas.
s.'cn meler: car ce fcroit ajouter·des fignes q_ue·le aom–
poftteur s'eft charge de rendre inutiles.
Je
m'arrete. pour ne· pas. iitendre
a
l'exces. cer
ar~
tlcle : i'en• ai dit trop· pour tout
copijle·
infiiruit qui
a
une- bon ne main .
&
le- goClt de fon metier; je
n'e~
d irois j,amals affcz pour !es autres. J'ajouterai feule–
ment un· mot en fin ilfant :- ii y a bien des incermediai–
res. enxre· ce quc:-
le cornpoflteur imagine
&
ce qu'en–
tendcnr
k s
auditeurs .. C't!l au
copijle
de rapprocher
ces deux
termes le pl'us qu'il' ell polfi.ble ;
d'indiqu~r
avec
clam~
tout ce qu'on doit faire· pour que la mu–
fique· t"XCLUtee rende ex.atl:ement
a·
J'orei!le du·
COITI'•
pofneu·r ce q ui s'dl: pcint. dans. fa tetc en. la. compO'–
fanr.
( S)
COP.TE.
(. L ANGuc
)',
A"tit[_.
Litr.
La
langue·
coplt·
elt un melange de L'ancienne langue E gy-ptienne ,
&
de mots Grecs qui' s'y font gliJ.les peu-a-pea apn!s que
cctte nation· s'elt rendue maitrelfe de ce pays.. Nous–
pouvons ex.pliquer par cette langue prefquc:
tous les–
anciens. noms Egyptiens ,.
&.
la plupart des etymolo–
gies.
Egyp~icnnc:s
qufon. trouv-e dans H erodore, D io·
dore de Sicile , Plotarq ue ,
&
clans d'aurres autellrS
anciens ; elle- ell an des pcincipauic fecours pour les
antiq uices de- ce pays, qot efi le berceau de pluficurs ·
arts, de la plupart des fciences,.
&
prefque de. tou.- ·
tes les fuperfti tions.
On a cm alf.:z gfoeralemenc que
l'arrc~enn~·
langue–
Egyptienne rdIC:mbloit
a
l'I-I.ebreu,
&
a
1es
drak~es_,.
q ui fon t for-tout le Syriaque, k Clroldiien, .le_Phe–
nicien ,
I'
Arabe
&
l'Clbiopicn ; mais cem: .1dc;C: ell:
emierement faulf( . elle
ell:
fondec for la chtmerrqu1t
pretentioo,. man-if;ftement diimentie .par 1:expfr'.e?
:
,
que toutes Jes
langu~s
anciennes do1vcnt
etre
dfnvees
du plus au moins de- l'Hebreu,
&
fot
quelql:les. mots
















