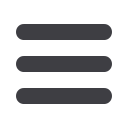
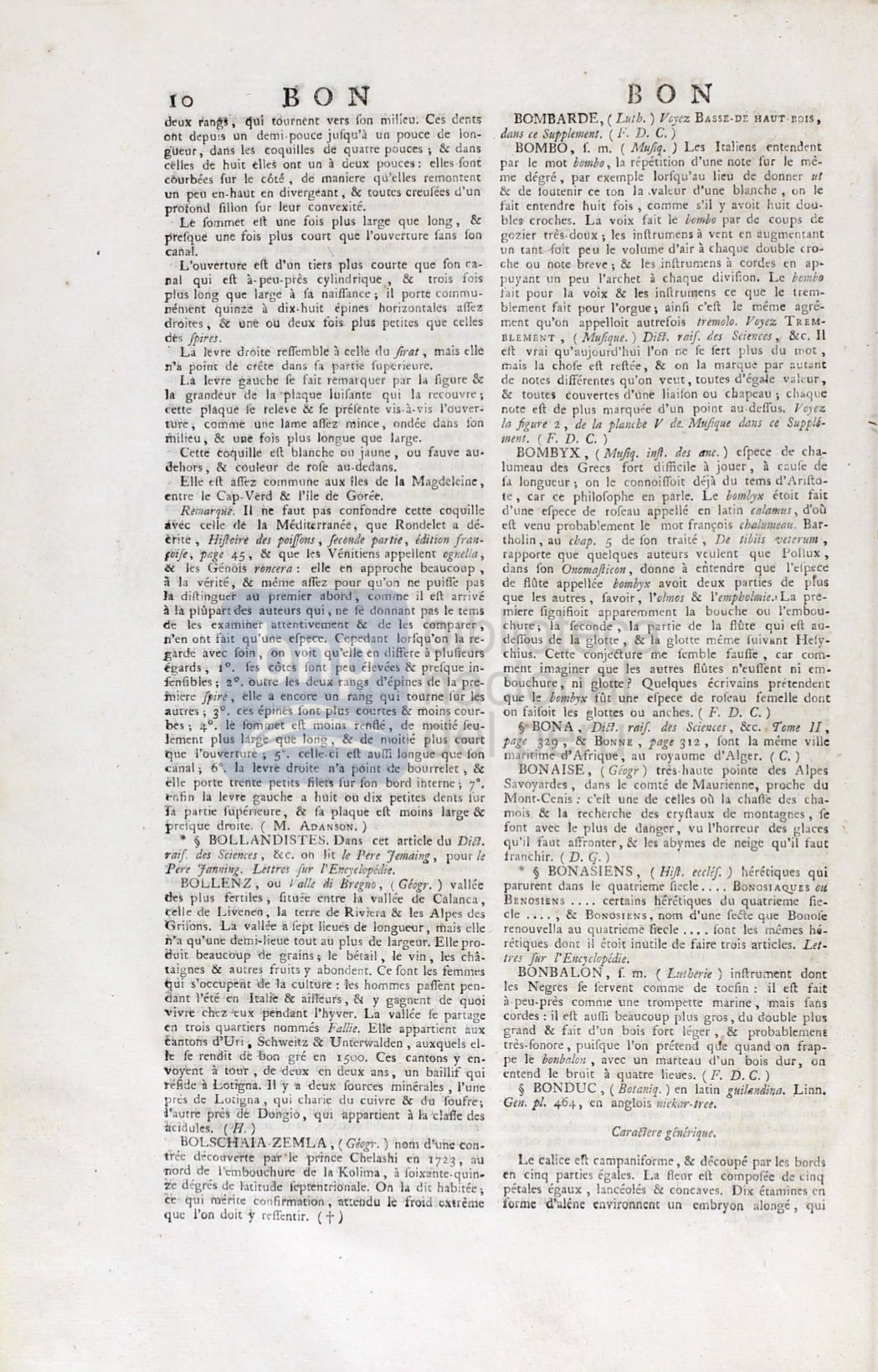
IO
:B ON
deux
ran~~",
11\lt
tournent vers fon milieu. Ces dents
oht depuis on demi- pouce jufqtJ'a un pouce de lon–
glH:ur, darts les coquilles de quarre pouces ;
&
dans
cdles de huit
elle~
one un
a
deux pouces:
elks
font
cburbees fur
le
cote , de maniere qu'elles remonrent
u-n peu c:n-haut en divergeant,
.&,
toutes cretJfees d'un
profond fillon fur leur convex1te.
Le fommet
ell:
une fois plus large que long,
&
prcfque une fois plus court que l'ouvermre fans fon
a6~
,
L'ouverture ell: d'on tiers plus courte que fon ca-
11al qui ell:
a-
peu-pres cylindrique ,
&
rrois fois
plus Jon" q uc large a
fa
nailfance ; il porre commu–
neh1enr
'/iuinz~
a
dix-huit epines horizonrales
affcz
d roites,
llt
une oll deux fois. plus petites que celles
des
fpires.
.
. La levre droire refTemble
a
celle du
jirat,
ma1s elle
n'a point
de
Grete dans
fa
partie foperieure.
L a levre gauche fe fait rema1quer par la figure
&
la grandeur de la ·plaque itJifante qui
la recouvre;
cette plaque
I\:
releve
&
fe prefente vis-a-\•is l'ouver–
t\1re, comme une lame aflez· mince, ondee dans fon
milieu ,
&
m1e fois plus Jongue que large.
Cetre coqu'ille ell: blanche on jaune , ou fauve au–
t'lehors,
&
i:ouleur de
rof~
au-dedans.
Elle
dl:
alfez commune aux iles de la M agdekine,
cncre le Cap -Verd
&
l'ile de Gorte.
Remarqd•.
11 .
nc
faut pas confbndre tette coquille
avec celle de
la
M editcrranee, q ue Rondelet a de–
erite ,
Hi.ftoire
des poi.ffons,
Jew1.departie, Edition Jran-
1oife; page
45 ,
&
q ue Jes Venitiens appellenr
og11ello ,
&
Jes Genciis
rbncera:
elle en approche beaucotip ,
a
la verire ,
&
rneme ·alfez pour qu'on ne puilfe pas
Ia
diftinguet au premier abord , comme il ert arrive
a
la plupart des auteurs q ui' ne
le
donnanr pas
le
terns
de
Jes exarniher atrentivement
&
de les comparer ,
n'en oht fait qu'une efpece. Cepedanr lorfqu'on la re–
.r.;~rde
avec foin, on voit qu'elle en diffcre
a
pluMeurs
egards , 1°,
fes cotes font pee
elevee~
&
prefque in–
fenfibks;
2°.
eutre
les
deux rangs d'ep!ne; de la pre–
fuiere
Jpire ,
el
le a encore un rang qui tourne fur les
a utres; 3" . ces -epihes font pll:ls coerces
&
moins cour–
bes; 4°.
le
fornme't ell: moins rcnfle, de moirie feu–
lemenr plus larg1: que long ,
&
cle moitie plus court
qt1e l'ouverrure ;
5•.
celle-ci ell: ailffi longue que fon
canal;
6°.
la ltvre droite n"a paint 'Cle bollrrelet ,
&
elle porte trenre petits fill!ts fur fon bord inrerne;
7°.
l:n!i n la levre gauche a ht1it on dix petites dents fur
Ta
parcie foper·ieure,
&
fa
plaque ell: moi ns large
&
prefq ue
droi~e.
( M . ADANSON. )
" §
BOLLANDISTES. Dans cet article du
Ditl.
niif des Sciences,
&c. oh lit
le Pere Jemai11g,
pour
le
Pere Janning. Lettre!;
f11r
l'Enc)'clopCdie.
BOLLENZ, ou
t'alle iii Hregnb ,
(
Giogr.
)
vallee
des plus tertiks, fimfr entre
la
vallee de C'<llanca,
t clle de L iv'eneo, la teue de R iviera
&
!es A lpes des
Brifohs. La val.lee
11
fepr lieues de longueur, mais clle
n'a qu'une
d·emi-~ieue
tour au plus de largeur. Elle pro–
tluic beaucoup
de
grains;• le bfaail, ·le vin, ks cha–
taignes
&
autres fruits y abondenr. Ce font !es
femm~s
~ui
s'occupe'ih
.\Ile
la culture: qes hotnmes palfent pen–
aanr l'ete en
'l Mlic
&
aim:urs ,
'&
y gagncnt de quoi
vivre chez 'eux ·pehd11'nt l'hyver. L a vallee fe parrage
en trois quartiers nommes
Fallie.
E ll'e appartient aux
cantons d'l':Jri
0
Schwei't.z
&
Unrerwalden , auxquels el–
te
fe renll-it
de
-hon gre en
i500.
Ces cantons y en–
voy'enc
a
t-o11't ,
de
1
detlx en deux ans, un baillif qt1i
r'efoide
-a
cotlgna.
11
y
'a
deux fources minerales , l'urte
pres de
Lo<igna~
qui charie du cuivre
'&
d·tJ
foufre;
a"autre pres di: Dengio , qui -appartient
a
la
1
claltk des
ciduks.
eFl.)
BOLSCHAIA -Z EMLA ,
(Geog;"}
h0m d'-1.lne·con–
t;ee d-Ccouvf"Tte. par· le lprince Chdashi en
1723 ,
au
nord de l'emeouc!hu\'e de la-Kolima,
a
foixa-nte-quin.
ie
degres de l'atlruck
ft"prehrrlb'n'al'e. On
fa
die habiree;
c'e qui ru1Crire confirmation , ai:tehdu
re
.froid extreme
quc l'on doit
r~lfcntir.
(
t)
BON
IlOMBARDE,
(Luth.) f/cyez
BASSE-DE
0
HAUT·no1s ,
dans ce Supplement.
(
F.
D. C.
)
BOMBO, f. m. (
M11jiq. )
Les I ralien$ en1ende11t
par
le
mot
bombo,
la repetition d'un7 note for le
me–
me degre, par exernple
lorfqu'au lieu de donner
11t
&
de fourenir ce ton la .vakur d'une blaJ1che , on le
fait cntendre huit fois , cornme s'il y ·avoic huic dou–
bles-
croches. La voix fait
le
bombo
par de coups de
gozier tres.doux ; !es infl:rumens
a
vent en augmentant
un cant fuit peu
ie
volume d'air
a
chaque double cro–
che ou note breve;
&
les infl:rumens
a
cord~s
en ap–
puyant un peu l'archet
a
chaque divifion. Le
bombo
fai t pour
la voix
&
k s inftrumens ce que le trem–
b!emenr fair pour l'orgul!! ; ainfi c'efl:
le meme agre–
ment qu'on appelloir autrefois
tremolo.
f/oyez
TREM–
liLEMENT , (
Mujique. ) Ditl. raif des Sciences ,
&c. II
efl: vrai qu'aujourd'lrni l'on ne fe fert plus du mot ,
mais la chofe efl: refl:ee , & on la marque par autant
de notes differentrs qu'o11 veut, toutes d'egak valeur ,
&
toures couvertes d'une liaifon ou chapeau;
ch~ql1e
nute ell: de plus marquee d'un poi nt au-delfus.
flo)e'Z
111
figure
2 ,
de la planche
/I
de. Mrljique da11s ce Supple–
ment.
(
F. D.
C. )
BOMBYX, (
Mr!fiq. inf/. des
t111c.)
efpece de ch'!.–
lumeau des Grecs
fort difficile
a
jouer,
a
cnufe de
ia
longueur; on le connoifToit deja du terns
~'Arifl:~te , car ce philofophe en park. Le
bombyx
etolt fa1t
d'une efpece de rofeau appelle en latin
calam11s,
d'oLI
ell: venu probablement le mot
fran~ois
chalumeau.
Bar–
tholin, au
chap.
5
de fon
rraite ,
De tibiis veterum
,
rapporte que quelques auteurs
v~ulent
ql1e
Pol~ux ,
dans fon
Onomajlicon ,
donne
a
enrendre que
l'dp.tce
de flute appellee
bombyx
avoit deux
pa~ties
de pfus
que les autres, favoir,
l'olmos
&
l'empholmie.•
La pre–
miere fignifioit
apparemmen~
la bouche ou l:embou–
chure; la feconde , la parr1e de
la flute qua efl: ao–
delfous de la gJorre ,
&
la glotte meme foivan t Hefy–
chius. Certe conjeCl:ure me
fernble faulfe , car com–
ment imaginer que les autres flutes n'eulfent ni em–
bouchure, ni gJorte? Quelq ues ecrivains prrtendent
qu.e le
bombyx
flit unr efpece de rofeau femelle dont
on faifoit Jes glorres ou anches. (
F. D. C.
)
§BONA,
Ditl. raif
des
Scimces,
&c.
'l'ome
JI ,
page
329 ,
&
BONNE ,
page
3 12 ,
font la meme ville
maritime d'Afrique , au royaume d'Alger.
(
C.
)
BONAISE, (
Giogr)
tres-haute poinre des Alpes
Savoyardes, dans le comre de M auriennc, proche du
Mont-Cenis
:
c'efl: une de celles ol\ la chaff'e des cha–
mois
&
la recherche des cryfl:aux de montagnes , fe
font
avec le plus de <lahger, vu l'horreur des gbces
'
qu'il faut affronter,
&
le' abymes de neigc qu'il fau t
Jranchir. (
D.
<.;.
)
*
§ BONASIENS,
(Hi.ft.
ecclif. )
heretiques qui
parurent dans
le
quatrie
mr fiecle .. . . BoNOSIAQ..YES
01t
BENOSIENS . ... certains heretiques du quatrieme fie–
cle . . .. , & BoNOSIENS , nom d'une feCl:e que Bonofe
renouvella au quarrieme liecle . . • . font !es memes hti–
reriques done ii etoit inutile de faire rrois articles.
Let–
tm
flu-
!'
Enc;clopidie.
BONBALON, f. m. (
Lutherie)
infl:rument dont
les Negres
fe
fervent comme de tocfin : .jl ell:
fait
a.peu-pres comme une tromperte marine , mais fans
cordes: il efl: aum beaucoup plus gros, du double plus
grand & fair d'un bois fort leger ,
&
probablem,enE
tres-fonore, puifque l'on pretend qtle quand on frap–
pe le
bo11balo11
,
avec un marteau d'un bois dur , on
entend le brnit
a
qmme liel:JCS. (
F.
D.
c.
)
§
BONDUC , (
Bota11iq.
)
en latin
g11il1111dino.
;Linn,
Gen.
pl.
46,~ ,
en anglois
nickar-tree.
Caraflere gcnfriq11e.
Le calice efi campaniforme,
&
decoupe par !es bords
en cinq parties egales. La flem ell: rnmpofee de cinq
petales egaux , lancfoles
&
concaves. Dix eramines en
'forme •d'alene c:nvironnent un embryon alonge, qui
















