
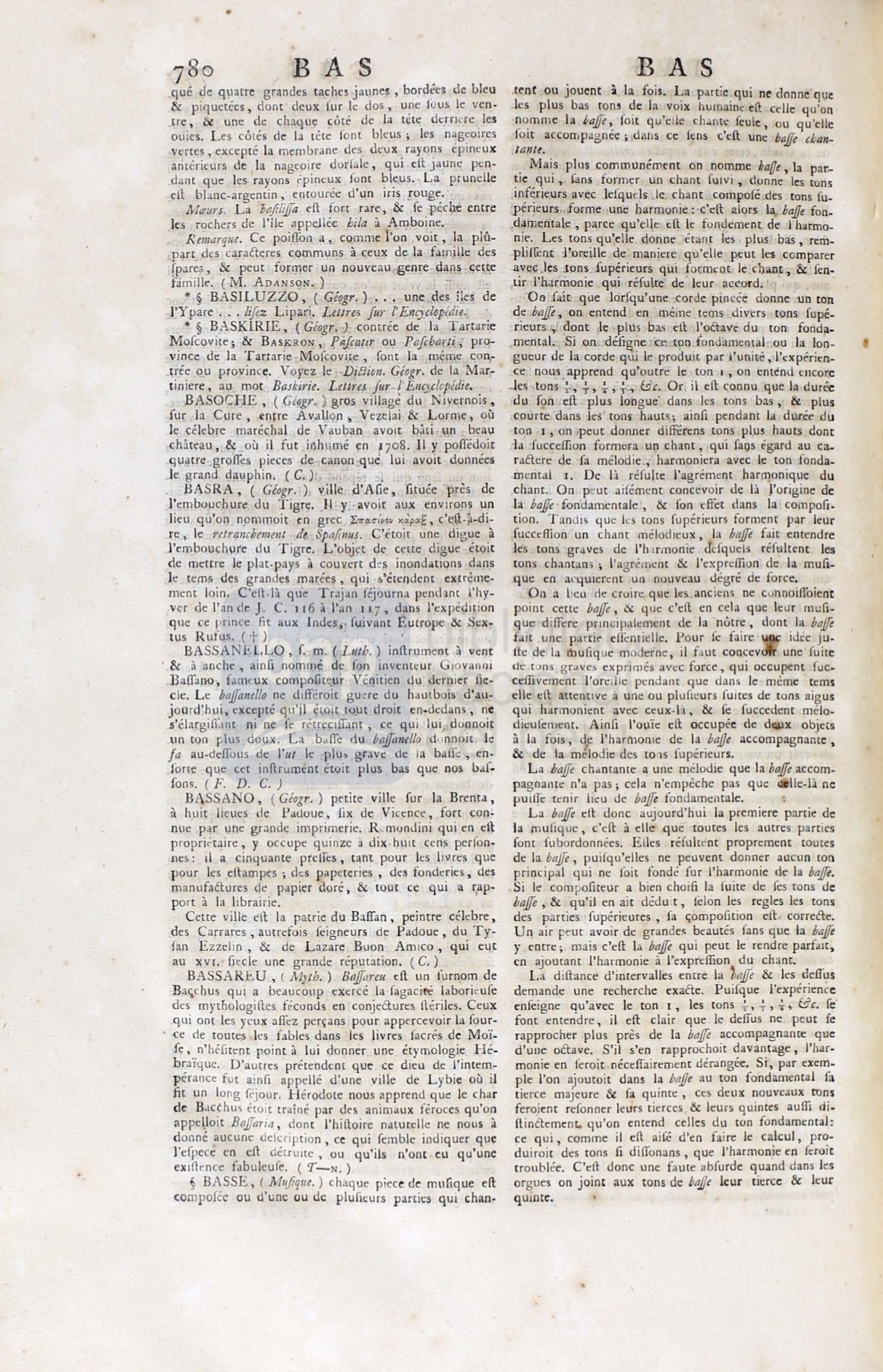
I
1
•
780
B
A
S
qué
de
quatre grandes ta.ches jaunes , borp?es de bleu
&
piquetées, dont deux (ur Je dos ,
u~e
lous
k
ven–
_tre ,
&
une de cha.que
~oré
de la tete deJrlere .les
ouies. Les cotés de la tete font bleus ; les nageo1i:es
verces, excepté la rncmibrane des deux.
rayo~s
épine ux
antérieurs de )a naoeoire dorfale,
<;Jlll
eíl: jaUne pen–
dant que les 'rayons° épineux
fo nr
ble,us. -.
La
prunelle
eíl: blanc-argentin, entourée d' un iris ,r9u,ge. ·
Mmurs.
La
'bajili.f!a
eíl: for.t rare,
&
fe
-p~c!;ie
entre
les rochers de l'ik appellée
hila
a
A.~ boine.
,
·
Re~1arque.
Ce poilfon a , comme l'on voit., la pl·a.–
,p;ir.t_des
caraél:~res
c9¡nmuns a ceux
de.la·famjUe des
fpares,
§e
peut _fonner un
nouveau.gen~e dan~
,qet,t,e
familk. ( M. ADANS91'1· )
.
. , ".
.
~
'i!
§ BASILUZZO , (
Géqgr. )
..•
une ;·
d.es.i.ld
de
J.'.Ypare ...
lifaz
Lip¡tri .
Lettres fur l'Ency_clop(die.;
~
§ B,ASKI
RIE, {
Géogr. )-
.contrée
d~
la Tartaríe
Mofc<;ivice;
&
BAs~RON
,,
.fijcntir,
01¡ -P,a[char1\,
1
prq–
vince de la Tartarie-)Vl,orcovi,r,e, font Ja
._!l}.~[D.t:
_
c;on,–
-~rée
q_u province. Voyez Je
i.Diftion.
Giogr.
de la
"Mu;
.t iniere , au mot _
Baskirie.
L et1reó_
/11r
l'
EncJ¡clopédie.
,
'_ .BASOCljlE,
t
Gégg.r.)
gros vilJ:¡ge du Nivernois ,
fµ~
la Cure , .enrre A.vAl9P
&
.Y
q:elai
&
L Qrme, ou
Je s;élebfe . !J1aréc,hal
1
de ,V.autJan avoi t l:¡ati ,.1¡1,n bea11
.chat~;¡u ,
1
~ ~ou
i! fut
,i.1jh L1m~
\!n
poi! .
Il y polTédoi,t
qu,ª trn"groifes, pieces .de,.
1
ca.B0µ ,que, lui avoít données
Je
gra.ndd¡¡_\jphin. .
(C.
)f, ...
~q-,
,,¡
~ ·
" ,
. ·BASRA , (
Géogr. · ),
vi·lle
~l'A!ie,
Tituée pres de
)'embouc-hute du
Tígr~.
)-1:
y;-avoir au,x ·env1 rpns un
lieu
qu~oo n,ommoí~
t n greo
_'í:tir,,rrfv.,
"~P"~ , c'e:~-~-dí_re, le
retr4ncbement
,d~
Spa/inus.
C'étoit une digue
a
J'embo1;1 cl\µfe du Tigre. L'obj;,t de ceE)'e digue· étoit
.de rnet_rre
l_c;
p!at-pays a cou¡¿ert des inondations dari.s
.Je tems des grandes
.ma~ées ,
qui s'étel)dent eJ¡;treme–
ment loin. C'eíl:-la que Trajan féjourna pendant l"hy–
ver de l'an de
J. c.
1 1
6
a,l'an
1 1
7 '
dahs l'expé9irion
que ce prinee fit aux
·lndi;;;,.
fuivan t
Eu~rope
&
,Sex~
tus Rufos. (
t)
~
•. _ '
BASSANEL.LO,f.;
m ., (
Lu.th.)
infüument
a
'i¡ent
&
a
anche , ainli nommé de fo n invente ur Giovanr¡i
:¡3alTano , fameux compo6t<;J!Í'·:Y¿gicien cjy dt:rnie,r
fie–
cle. L e
balfa11ello
ne différoit guere du hautboís
d"aq~
j oa rd
'h.ui, e¡<cepté qu'jl
é¡oit, J~llt
rjroit en-dedans , ne
s'éla~giflant
n·i ne fe réqeci!Tan¡ , ce qui lui,,.
d cim1oi~
un ton pllls deux. La ,ba!fe
c:\~1
bajfanello
donnoit
'le
fa
au-delfous de
l'ut
le
~r.!4•
grave de la baffo , en–
force _que cet inft rument étoi t plus bas que nos b af–
fons. (
F.
D.
C.
)
BA'SSANO , (
Géogr.)
petíte vil
le
fur la Brenta ,
a
huit lieues de Pauoue, iix de Vicence , fon con–
nue
p~ r
uhe grande imprirnerie. R, monJini qui en efl:
proprie'.taire, y occupe quinze
a
dix-hu it cen.s perfon–
nes: il a cinquante preffes, tanl pou r ks
livre~
que
pour les eftampes ; des papeteries , des fonderies , des
mnnufaél:ures eje papier doré ,
& .
tour ce qui a r
1
ap–
port a la librairie.
Cette ville c'(l: la patrie du
B~lTan,
peintre célebre,
des Carrares , au trefois fei gneurs ·de Padoue , du Ty–
fan E zzel in ,
&
de L azare Buon Amico , qui eljt
au
~vr.
liecle une gra nde réputation.
(C.)
.
BASSAREU, (
M)',th. ) Bajfareu
dl un fornom de
Ba<ochus qui a beaucoup exercé la fagaci!'é laboricufe
des mytlíologiíl:es féconds en conjeél:ures !l:éri les. Ceux
qui om les yeux aifez
per~ans
pqur appercevoi r la fo ur–
ce de tomes .les fables dans les livres facrés de Mo'i–
fe,
n'héfitent poi nt a Jui donnér une écymologie Hé–
'bra'ique. D'autres prétendent que ce dieu de l'intem–
J!lérance fut ainfi appellé d' une ville de L ybie ou i l
fit
un long féjour. H ¿rodote nous ap prend que
Je
char
de
B•c~hus
étoi t trainé par des animaux féroces qu'on
~ppel)o1 t
Bajfaria ,
don t l'hiíl:oire naturdle ne nous a
donné .aucune delcription, ce qui fe,mble indiquer qui:
l'efpece en eft détrui ce , ou qu'ils n'ont cu qu'une
exifl ence fabuleufe. ( 'T-N. ).
~
BASSE, (
M11jiq11e. )
chaque piece de mufique eíl:
cornpofée ou d'une ou de pluiirnrs parties qui chan-
E AS
_tent ou jouent
a
la fois. La parti.e.qui ne donne qvc
.les plus bas tom de la voix humamc
e(l:
celle qu'on
~ornme
la
baj)é,_
foi t qu'eile chan te feulc, ou q u'elle
Jo1t accompagnee; ,dans ce feos c'eft une
baj)é chan–
,ta11te.
. Mai.s plus commu.nérnent on nomme
baffe,
la par–
t1e qui, íans former un chant fy1vi, donne les tons
,infürieurs avc:c le(q uels ,le, cbant corhpofé ,des tons
fu.
:périeurs ,.forme
•Ul'lt!
harownie :·c'"(l: alors la.
ba1Je
fon–
,d..am.~rícale
, .p'l,rce qu'elle eft le ÍOl\dement de ·l'harmo–
nie-. Lts tons
qu~el k
. .donoe étan t
les
ph1s bas, 1rem–
plil!kn;t
~!oneiJle
de maniere qu 'elle peut les comparer
.av~cJes
:tons. fopérie.urs qui
focmco~
le
d¡anc~
& ·
fen–
,Lir ·l'..ha6i;1onie qui réfulté' de ' Jeur ac;,cord. ' ·/
·
-oo íah. que lorfq.u'une. ,carde pi.neée donne ·un ton
d.e
,baJíe~
on entend
M
mo'me t<:>ms divers t©ns fupé–
mmrs11;!cdoot
~e
0
pl\Js
.bai;
ell: l'o&avé du ton fonda–
OJt¡J'jtal.·
Sí
.on;·défi&-ne
1 c..ei :·t\)n .Í.ondament~l
·.ou la lon–
gueur de la carde qiuj
k
produit par l'unite ,,l'expérien–
ce nolls _apprend q u'outre
le
ton
1 ,
on enteml t'ncor.e
..les .tons
~.
+,
~ ,
.;..,
.&c.
Or. il eíl: connu que la duré.e
.dt1 ·
íoiu,eíl: plus lobgue' dans les tons bas,
&
plus
.c_olilrte.'dans
les '
tons hauts; ainli pendant la dur,ée du
ton
1 ,
on :peut donner clifférens .tons
pl.ushaut_s dont
-la ·fucceffion
forme~a
un chant, .qui faos égard au ca.
raél:ere· de
fa
mélodie_, harmoniera avec
le
tiln ·fonda–
in ~rital
1 .
De .
Ja
rffulce l'agrément harJT¡oniq,ue du
,chant. On. peu t ai{émeot. conctivoir de la )'origine de
.Ja
ba.ffe
·
fun'damemale ,
&
fon -effet dans la compoii–
tion. Tandis que les cons fupérieurs fo rmen c par leur
.fu ccdlion un chant mélodieux, la
baj)é
faic cntendre
les tons
~graves
de l'harmonie defquels réfoltent les
tons chantaos ; l'agrément
&
l'exp reffion de
la
muli–
..que en acquierent .un nouveau dégré de force.
. On
a he.o
1de croire
q ~1e l~s. anciens
ne conooi!foient
point cette
baj)é ,
&
que c'efl en cela que leur muii–
quc diffcre pnn cipalement de la notre, done la
baffi
fait une
pacti~
elTentielle. Pour
li:
faire
~
idée j u–
íte de la drnlique moderne , il fam coocevo'lr une fuice
de ,rons graves exprimés avec force, qui occupen t fuc–
cdli vement l'ore11le pendant que dans le meme tems
!!lk eíl: attentive
á
une ou plufü:urs fu ites de tons aigus
qui harmonient avec ceux-Ja ,
&
fe fuccedent mélo–
dieufement. Ainli l'ou'ie ell: occupée de de,¡¡x objets
a la fois ' d,e l'harmonie de la
ba1Je
accompagnance'
&
de la rnélodie des tons fupérieurs.
L a
baj)é
chantante a une mélodie que la
baj)é
accom–
pagnan te n'a pas; cela n'empec he pas que a.lle-la ne
pu ilfe tenir líc u de
baj)é
fondamentale.
· La
baj)é
dl: done aujourd'hui la prerniere panie de
la mu[ique' c'eíl: a elle que toutes les autres parcies
fonc fu bordoanées. Elles réfu ltt'nt proprement tomes
de la
baj)é ,
puifqu'elles ne peuvent donner aucun ton
pri ncipa l qui ne foi t fondé for l'harmonie de la
baj)é.
Si k com pofüeur a bien choili la fuite de fes tons de
baj)é ,
&
qu'il en ai t déduit, fel6n les regles les tons
des parcies fupérieures ,
fa
c;ompo!icion eft, correél:e.
u!\
air peut avoir de
grande~
beaucés fa ns que la
baj)é
y .
enrre ; mais c'eíl: Ja
baj)é
qui peut
le
rendre parfai t,
en ajoucanc l'harmonie
a
l'expreffion du chant.
L a diíl:ance d'iotervalles entre la
~aj)é
&
les deffus
dema nde une recherche exaél:e. Puifque l'expérience
enfeigne qu'avec le ton
1,
les tons
~
• .;- ,
~
..
&c.
fe'
fon t entendre , il eíl: clair que
le
delfus ne . peu t fe
rapprocher plus pres de la
baj)é
accompagnante que
d'une oél:ave. S'il s'en rapprochoit davantage, l'har–
monie en feroit .nécelTai remen t déra ngée. Si, par exem–
ple l'on ajoutoit dans la
ba1le
au ton fondamenta l
fa
tierce majeure
&
fa
qu inte , ces deux nouveaux tons
feroíent refonner leurs tierces
&
kurs quin tes aum di–
íl inc1emcn r.. qu'on entend cellcs du ton fondamenta l:
ce qui , comme il
e~
ail.e d'en faire
le
ca_lcul,
pr~duiroit des tons
fi
d11fonans, que l'harmon1e en frro1t
troublée. C'dt done une fauce abfurde quand daos les
orgues on joínt aux tons de
ba1le
leur tiercc
&
leur
qui.me._
















