
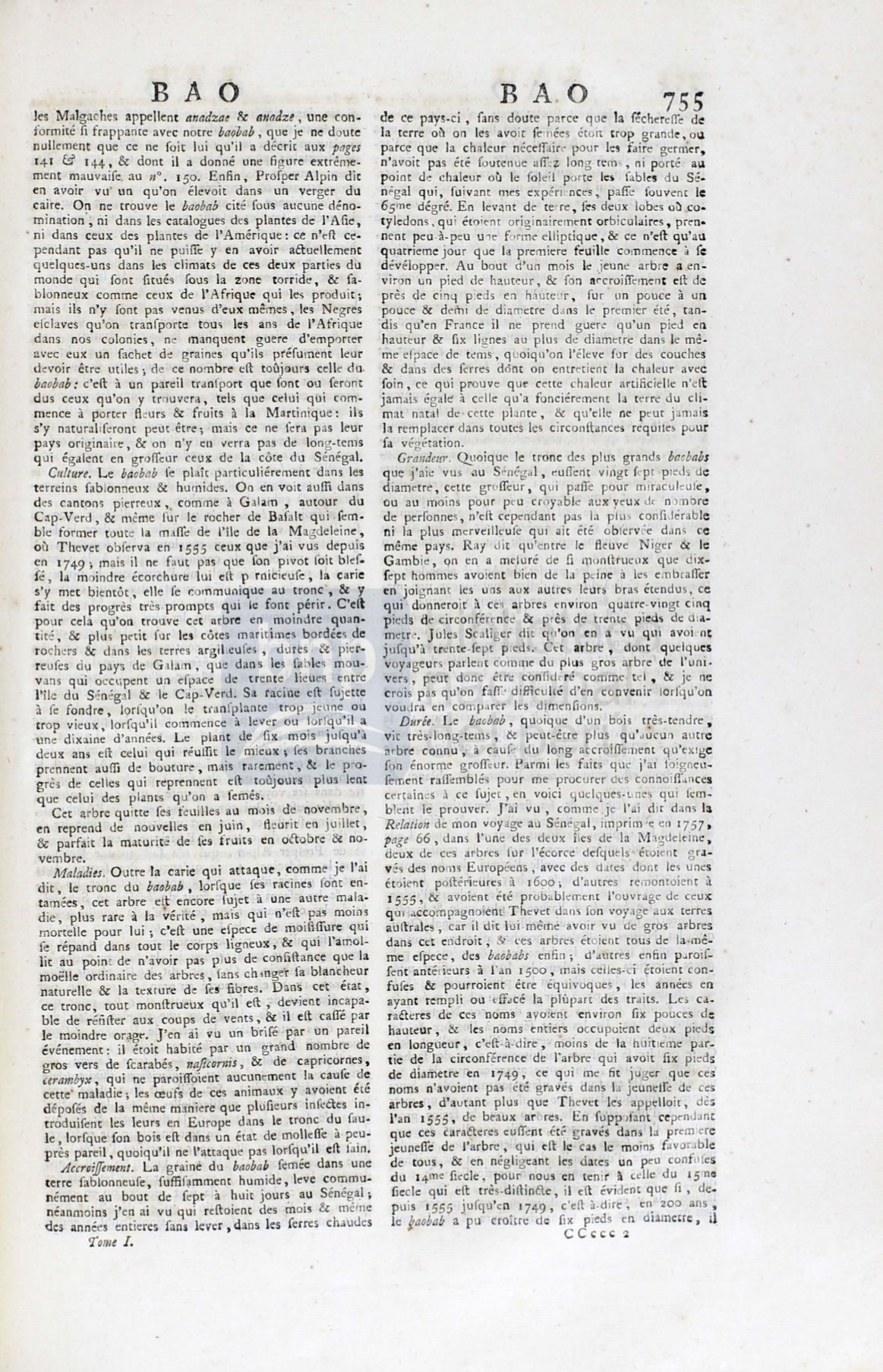
BAO
les
Malgacheg
appellent
an11dzae
&
111111Jze
,
une con–
fo rmíté
fi
frappanre avec nom :
baobab,
que je ne d ute
nullement que ce ne foit luí qu'í l a décrít aux
p11ges
14 1
&
144 ,
&
done il a donné une fi gure extreme–
ment
n~auvaife.
au
nº .
150. En fin, P rofper Alpí n dit
en avo1r vu· un qu'on élevoít dans un verger du
caire. On ne trou ve le
baobab
cit¿ ÍOllS aucune déno–
rnination",ni dans les catalogues des plantes de !'Afie,
· ni dans ceux des plantes de l'Amériq ue : ce n'tíl ce–
pendant pas qu'il ne puiífe
y
en avoir aél:uel lement
quelq ucs-uns dans les cl imats de ces deux p arties du
monde qui
font fitués
fous la zone
torride,
&
fa–
b lonneux comme ceux de l' Afrique qui les produ ít;
mais ils
n'y
font pas venus d'eux memes , les Ncgres
efclaves qu'on
tranfporte
tom
les ans de l' Afriq;.1e
dans nos colonics, n
manquent guere d'empl)rter
avec cux un fach et de graines qu'ils préíument leu r
dcvoi r etre utiles ; de ce nombre e!t tolljaurs celle du.
baobab:
c'e!t
a
un pareil tranfport que fon t ou feront
dus ceux qu'on
y
trouvera, tels que cd ui qui com–
mence
a
porte r fleu rs
&
frui cs
a
la M artinique :
ils
s'y
natural1feront peut
erre;
mais ce ne fera pas leur
p ays originai re,
&
on n' y en verra pas de long-tems
q ui égalent en groffcur ceu x de la coce du Sénégal.
Culture.
Le
baobab
fe plait partic uliérement dans les
terreins fablonnellx
&
hurnides. O o en voit auffi dans
des can tons pierreux ,. comme
a
G al am , autaur du
Cap-V erd,
&
méme fur Je rocher de Bafa lt q ui -fom–
b le former toute la maff<! de l'ile de la Magdeleine,
0!1 Thevet obferva en
1555
ceux que j 'ai vus dep l1is
en 1749; maís il ne
f~ut
pas que fon p ivot foit blef.
fé,
la m indre écorchure lui dt p rnicieufe, la carie
s'y
met bitntót , elle
fe
r.ornmunique au tronc ,
&
y
fait des progres tres-prompts q ui le font . Périr. C'eft
p our cela qu'on trouve cet acbre en mo10dre quan–
tité '
&
pl us
p~tit
fur les cotes maritirnes b ordée' de
rochers
&
dans les terres argiheu fes , durts
&
pier–
reufes du pays de Galam , q ue dan s les fables mou–
vans qui occt-.pent un cfpac<! de trente. lieues
':ntre
l'ile d u Sénégal
&
le Cap-Verd. Sa racrne
e~
fuJette
a
fe fondre, J9rfq u'on !e tmnfp lance
trap
jCllne . OU
trop vieux, lorfqu'il commence
a
k"er ou
!or~qu' 1l .~
une dixaine d'années. L e plant ele
fix mo1s JU fqu J
deux ans eft celui qui réuillt le mieux
¡
fes branches
p ren nent auffi de bournre , mais rarement,
&
le p ro–
gres de celles q ui
reprennent e!t
toiljours plus lcnt
q ue celui des p lants
q ~'o.n
a femés . .
Cct arbre qu itte fes fell! l!e
s aunm1s de oovembre ,
en reprend de
nou.vc;_lles
en
j.ui~,
tleurit en j uillet,
&
parfait la matu n te de fes tr1.11ts en oél:obre
&
no–
vembre.
.
.
Maladies.
O utre la carie qui atraq ue,
~omm~
Je l'a1
d it,
le
tronc du
baobab ,
lorfque fes racmes lont en–
tamées, cet arbre
e~t
encore fuje t
ª.
une
autr~
ma.la–die, plus rare
a
Ja vérité , m:iis qui n'e!t yas
mom~
mortelle pour lui ; c'ell: une
e~pecc
de
mo1fi~fo~e
qui
fe répand dans tour Je corps h gneux,
&
q
lll
1ámol–
lit a:u point de n'avoir pas plus de
con~!hnce
que la
moelle ordinaire des arbrcs, fans ch .nger
fa
blancheur
narnrelle
&
la texrure de fes fibres. D ans cet état,
ce tronc, tout monfl:rueux qu' il eíl: ,
~evient
inc;apa–
ble de réfi!ter aux cou ps de vents ,
&
11
e!t
carre
p~r
le moindre orag.-. J'en ái vu un brifé par · un paml
événement : il étoit habité par un grand
no~bre
de
o ros vers de fcarabés ,
11aflcornis ,
&
de capricornes,
~erambyx ,
qui ne paroi!foient aucunement la c.aufe
,d~
cene· maladie · les ceufs de ces animaux
y
avo1ent ete
dépof~s
de la' méme maniere que plufieurs
i nf~él:es
in –
t rod uifen t les leurs en Europe dans le tronc du fa u–
le, lorfque fon bo is eíl: dans un état de
moll~lfe
a·
?e.u–
p res pareil, q uoiqu'il
n~
l'.attaque pas
Jor-fq~' 1l
ert
farn.
Accroiffemmt.
La grame du
baobab
femee dans une
terre fablonneufe ,
fuffif~mment
humide, leve commu–
nément au bou t de fept
a
huir
jour~ ~u
Séné&a.l ;
néanmoi ns j'en ai vu qui re!toient des mots
&
meme
Qes années entieres fana lever , dans les ferres cha\1cles
<J'ome l.
de
ce plys-ci ,
fans~out~ar?q ue
la
fécher?cr~ ~
la terre oi'l on les avoit fe·nées étoit trop orandc,
0 1,1
parce que la chaleur
nécelfair~
pour ks
fai~e
oermcr,
n'avoit pas été fo uten ue affrz lang· tenh, ni
p~rté
a11
point de i:haleu r ou le foleil porte ks fab lcs du Sé·
n~gal
qu i, fu ivant mes expén cnces, paffc fouvent le:
65me dégré. En levant de terre , fes dcllX lobes oi:l co–
ty ledons, q ui étoitnc origi nai rement orbicu laircs , prrn•
nent peu.a-peu u 1e forme ellipciq ue,
&
ce n'e!t qu'au
qllatrieme jour que la premit:re fru ill<'. e mmence ;, fe
dévélopper. Au bout d'un mois le .jeune arbre a en–
vi ron un pied de hameur,
&
fo n accroiífemenc e!t de
pres de cinq p1ed s en haUCCl!f ,
ÍUr
11 n pouce
a
Ull
pouce
&
demi de diari:etre dans
le
premier été , tan–
q ís q u'en F rance il ne prend guere qu 'un pied en
hauteur
&
fi x lignes au plus de díametre dans le me –
me eí¡>ace de tems , q Doiqu'on l'éleve fo r des couches
&
dans des ferres do(lt on entretiene la chaleur avec
foin, ce qll i prouve q ur cecte cha leu r artificielk n'e íl:
jamais égale'
~
celk qll'a foncié remenc la terre du cl i–
mat natal de cette pl ante ,
&
qll'el lc ne peut jamais
la remplacer dans toutes les circonH:ances reqll! les puur
fa
végétation.
Grandeur.
~1oique
le tronc des phrs grands
baobabs
que j'aie vus au S ' néga l, r.uffent vingt kp t p1ed de
d iamrtre ,cttte groífeur , q ui paire pour m1racu lculé: ,
ou au moins pour
p~u
crnyabk aux yeux
<l<
nombre
de perfon nes, n'eft cependant pas la plll
confiJérable
ni la p lus merveilkufe qui ai t écé oblervée dJns ce
meme pays. R ay dit qu'eotre le
flrnve Niger
&
le
Gambie ,
qn
en a melu ré de
fi
q1nn!t-tuel1X que dix.
fept hommes avoient bien de la pei ne
a
ks embraffer
en joignant les uns aux autreq leurs bra' étendus , ce
qui donneroit
a
ces. arbres rn viron quarre-vingt cinq
p ieds Be circonférenCt"
&
pres de trente pieds de d1a–
me~re.
J ules Scaliger c;lit qn'on en a vu ql1i avoic-nt
j ufqu'il
trente-fept p1eds.
c~c
ar bre '
dont qutlquc:s
voyageurs parlent com 11e du plus gros arbre de l'uni–
vers , peut done
étn:
con fi dc'ré comme td ,
&
je ne
crois pas qu'on
faff~
difficu lré d'en co nven ir lorfqu'on
voudra en cornparer Jt:s dimenlions.
D11rée.
L e
baobab ,
q uoiqlle cl'un bois
t~es-tend re ,
vit tres-long- cems ,
&
peut-étre plus qu'.1urnn alltre
arbre connu,
a
cau f~
du long accroiffemen t qu'ex1ge
fon énorme groff. ur. Parmi k s foi ts que j'at foi gneu–
femen t
rafl~mblés
pou r me proc urer do:s connoilf. nces
cer¡aines
a
ce fuje t , en voici q ud q1Jes. i.,nes qui
!cm~
b wt le prouver. J'ai vu , comme je l'ai d1r dans la
Relation
dt
mo n voy age au Sénégal, imprim ·e en 1757 ,
page
66 , daos l'u ne des deux iles de la M agddeine,
deux de ces arbres fur l'écorce defqllels éroient g ra.
vés des no is EL1ropéens, avec des d<1tes don e le' unes
ét ient po!térieu res
a
1600; d'autres
remontoien r
ii
1555,
&
avoien t écé p robabk ment l'ouvragc de ceux:
q t11 1accompagnoient' Thever dans fo n voyage au" terres
a\Jftra\es, Car il dit lllÍ mertJe aVOÍr
VU
de gros aF bres
dans cet cndroit,
&
ces arbn:s étoient tous de la ·me–
me efpece , des
baobabs
enfin ; d'aucres enfin p•ro1f.
ferit antérieu rs
a
l"an 1500 , mais cdks-ci étoicn c on–
fu fes
&
pourroient etre
équi voq ue~ '
les années en
ayant rempli ou t ffacé la plüpart dts traits. Les ca–
raéteres de ces noms _ayo1ent •enviran
fix pouces de
hautcur,
&
les noms entiers occupuient deux pieds
en longueur, c'efi· a-'dire , moins de la hllit1eme par.
tie de la circonférence de l'arbre qui avoit
fi"
pieds
de diainetre en 1749, ce q ui me
fit
jugt:r q ue ces
noms n'avoient pas été gravés dans la jeuneffe
do:
ces
arbres, d'autant plus que T hevi:t les appt:lloir, des
l'an
1555 ,
de beaux ar.. res. En fuºpp.,fant cepcndant
que ces caraél:eres eulfcnt
ét~
"'ravés dans la prem•ere
jc:uneffc: de l'arbre , qui C"fl: le cas le moins fa vorable
de tous,
&
en négligeant les dates un pcu confo les
d u 14me
fi~cle,
pour nous en tenir
a
cdle du 15me
fiecle q ui e!t tres-di fti nf.l:e, il en évidcnt que fi ' de–
puis
1555
jufqu'en 1749, c'cl1 a-dire , en. 200 ans .•
le
jaobab
a pu croim: de fi x pieds en d1ammc ,
1l
C C 1:cc
2
















