
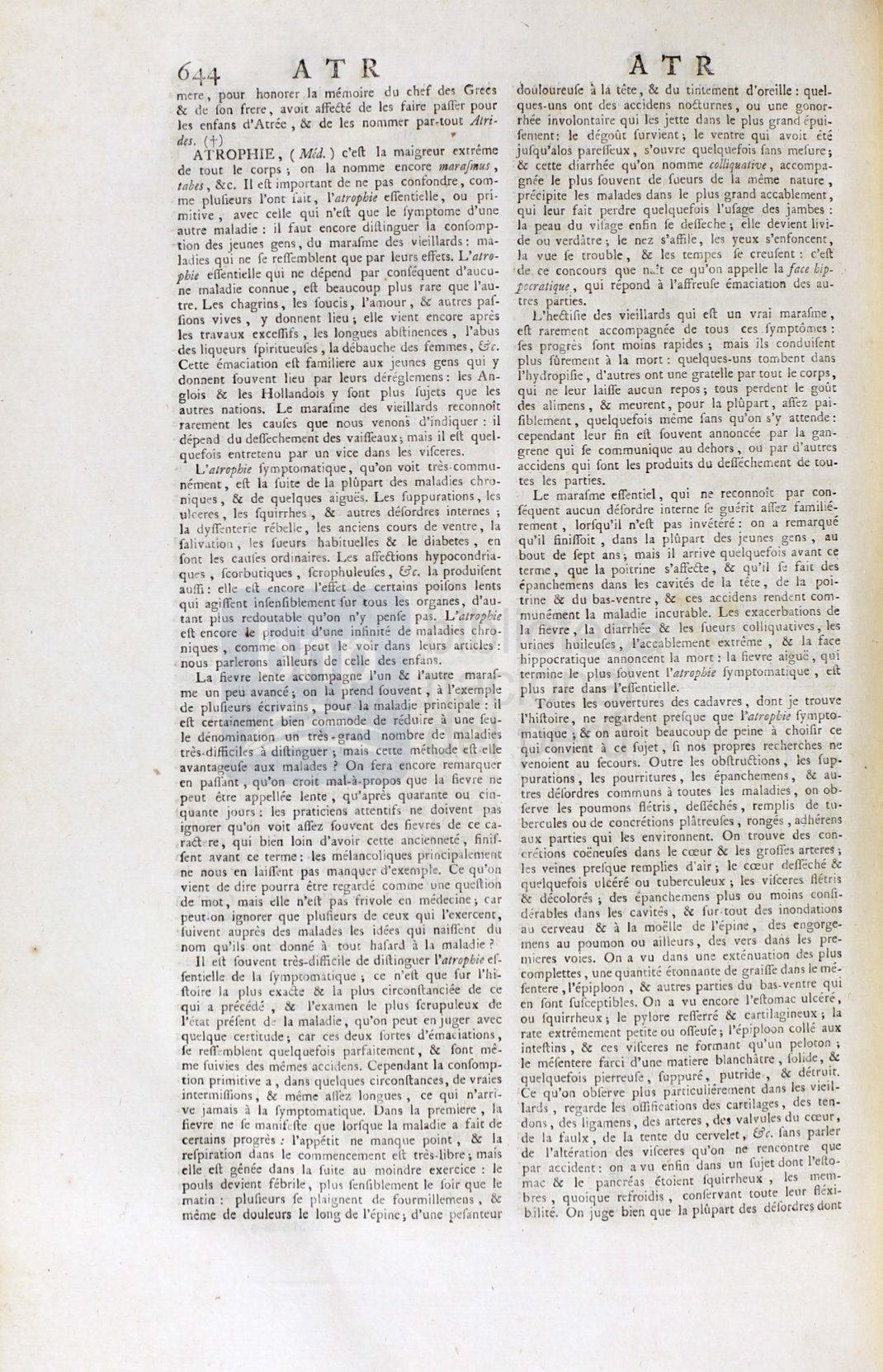
644
A T R
mere , pour honorer la mémoire du chef des G reés
&
de fo n frere , avoic affeété de les fairc pafTer pour
les enfans d'Acrée ,
&
de les nommt r par-tou t
/Ílri-
des.
(t)
•
AT ROPHIE , (
Méd.)
c'eíl:
la maigreur extreme
de tout
le
corps ; on
la nomme encore
inaraf11111s
,
tabes,
&c. II eíl: important de ne pas confond,re , com–
me plufieu rs l'ont foi c,
l'atropbie
e!Tentielle , ou pri–
mitive , avec cclle qui n'eíl: q ue le fymptome d'une
autre maladie : il fau t encore di!ti nguer la coníomp–
t ion des jeunes gens , du marafme des vieillards: ma–
lad ies qu i ne fe refTemblent que par leurs effets.
L'atro–
phie
efTentid le qui ne dépend par .con féquent d'auc u–
ne maladie connue, eíl: beaucoup pl us rare que l'au–
tre, L es chagri ns, les foucis , l'amour ,
&
antres paf–
fion s vives , y donnent lieu; elle vient encore apres
les travaux exceílifs , les longues ablti nences , l'abus
des liqueurs fpiricueufes , la débau che des femmes,
&c.
Cette émac iation d l: familiere aux jeunes gens q ui y
donnent fo uvent lieu par leurs déréglemens : les An–
glois
&
les H ollandois y fon t plus fujm q ue
les
autres nations. Le marafme des vieillards reconnoit
rarement les caufes que nous venons d'indiq uer : il
dépend du defTc:chement des vaiffeaux; mais il eíl: quel–
quefois entrecenu par un vice dans les vifceres.
L'alropbie
fymptomatique , qu'on voit tres -commu–
nément, eíl: la fu ite de la plCí part des maladies chro–
niques ,
&
de quelques aigues. L es fuppurations , les
ulceres , les fqu irrhes ,
&
:llltrcs dffordres internes ;
la dyfTenterie rébelle , les anciens cours de venere , la
fa livacion , les foeurs habicuellcs
&
le diabetes , en
fo nt les cat1fes ordinai res. Les affeétions hypocondria–
q u~s
, fcorbutiques , fcrophukufes ,
&c.
la produifent
auffi : el h: e(l: cncore
l'eff"c:t de certains poifons lents
q ui agi ffrn t infenfiblement fo r wus les organes , d'au.
tant plus redoutable qu'on n'y penfe pas.
L 'atropbie
eíl: encore le produit d' une infi nité de ma ladies chro–
niques , comme on peut le voir dans leurs arcic b
:
no us parlerons ailleurs de celle des enfans.
L a fic vre lente accompagne l'u n
&
l'autre maraf–
me un peu avancé ; on la prend fouvent ,
a
l'exemple
de plufieurs écrivains , pour la maladie principale : il
eíl: certainement bien comcnode de rédu ire
a
une feu–
Je dénorni nation un tres - grand nombre de mal adies
tres-difficil~s
a
diíl:inguer ; mais cecte méthode eíl: el le
avantageufe aux malades
?
On fera encore remarquer
en pa!Tant , qu'on croit mal-a-propos que la fievre ne
peut erre appel lre lente , qu'apres quarante ou. cin–
q uan te j ours : les praticiens attentifs ne doiven t pas·
ignorer qu'on voit afTez fouvent des fi evres de ce ca–
raét"re , .q ui bien loin d'avoir cecte ancienneté , fi ni f–
fen t avant ce terme: les mélancoliques principalemen c
ne no us en lai!Trnt pas manquer d'exemple. Ce qu'on
viene de dire pourra etre re$ardé comme une queíl:ion
de mot , rnais d ie n'eíl: pas fri vole en médecine ;
ca r
pem-on ignorer que plufieurs de ceux qui l'exerccnt,
fuiv ent aupres des malades les
idées qui naifTent du
nom qu'ils ont donné
i\
touc hafa rd
a
la maladie ?
II
elt
fouvent tres-diffic ile de diíl:inguer
l'alropbie
ef–
fen tielle de la fymptomacique ; ce n'eíl: que fu r l'hi–
ftoire la plus exaétt:
&
la
pl u~
ci rconíl:anciée de ce
q ui a précédé ,
&
!'examen le plus fcrupu leu x de
l'état préfe nt d· Ja maladie , qu'on peut en j uger avec
qud que certitude ; car ces deux forces d'émaciations ,
fe reffrmblenc q uelq uefois parfai tement ,
&
fon t me–
~le
fui vies des memes accidens. Cependant la confomp–
~1on
pr_imitive a, da ns quelques circoníl:ances , de vraies
rnce_rm1f1!ons ,
&
meme alfez longues , ce qui n'arri–
ve pma1s
a
la fymptomatique. Dans la premiere , la
fiev re ne fe manifd1:e que lorfque la malad ie a fai t de
cerc~111s.
progres
:
l'appétit ne manque point ,
&
la .
refp1rat1on daos le commencemen t elt tres-libre · mais
,elle eíl: génée daos la fu ite au moi ndre exercic'e : Je
pou)s deviene fébrile , P!t1s fenli blement le foi r que le
mat111 : pl ufleurs fe pla1gnent de fou rmillemens ,
&
méme de douleurs le long de l'épine ; d'u ne pefa nteur
AT R
douloureufe
~
la tete ,
&
du tiritement d'oreille : quel–
qu~s- ~ns
ont
~es •
ac~iden_s
noéh1rnes , ou une gonor–
rhee
1nvolon t~1re_q u1
les_JCtte dans le plus grand épui–
[emenr: le degout fu rv1ent; le ventre qui avoi c été
JUfq u'alos pareffeux , s'ouvre quelquefois fan s mefure ;
&
cette diarrhée qu'on nomrne
colliquative,
accompa–
gnée
le
plus fo uven t de Íüeu rs de la merne nature
précipite les rnalades dans
le
plus grand accablement '
qui lcur fa it perd re quelquefoi s l'ufage des j ambes ;
la pea u du vifage enfin fe de!Teche ; elle devient livi–
de ou verdatre; le nez s'affi le , les yeux s'enfoncenr ,
la vue fe trouble,
&
les tempes
fe
creufent : c'eíl:
·de ce concou rs que
n~:c
ce qu'on appelle la
Jace hip–
p ocralique ,
q ui répond
a
l'affreuft: émaciatton des au–
tres parties.
L'heétifie eles vieillards qui ell: un vrai marafme ,
ell: rarement accompagnée de tous
ces .fymptómes :
frs progri:s
font moi ns rapides ; mais ils conduifent
plus fUrement
a
la mort: quelques-u ns tom benc dans
J' hyd ropifie , d'autres ont une gracelle par touc
Je
corps,
q ui ne leur laifTe aucun repos ; tous perdent le gout
des alimens , & meurent, pour la plupart , a!fez pai –
fi blement, quelq uefois meme fans qu'on s'y attende :
cependant leu r fi n eíl fo uvent annoncée par la gan–
grene q ui fe communique au dehors , ou par d'aucres
accidens q ui font les produits du delféchement de tou–
tes les parties.
L e marafme e!Tentiel, q ui ne reconnoit par con–
féquent aucun défordre interne
fe
guérit alT"ez fami lié–
rement , lorfqu 'i l n'eíl: pas in vétéré : on a remarqué
qu'i l finilfoit , dans la pl i1part des jeunes gens , au
bouc de fept ans ; mais il arrive quelquefois avant ce
rerme , que la poitrine s'affeéte ,
&
qu'iJ fu fa ic des
épanchemens dans les cavicés de la tece , de la poi–
trine
&
du bas-ventre ,
&
ces accidens renden t com–
munément la maladie incu rable. L es exacerbations de
Ja fievre, la diarrhét:
&
les fueurs colliq11acives , les
urines huileu fes , l'accablement extreme ,
&
la face
hippocratiq ue an noncent la more: la fievre aigue , qui
term ine Je pl us fo uvent
l'alropbie
fymptomatique , eíl:
plus rare dans l'efTcnti elle.
Toutes les ouvertures des cadavres, don t je trouve
l' hiíl:oire , ne regardent prefque q ue
l'alropbie
fympto–
matique ;
&
on auroit beaucoup de peine
a
choifir ce
qui conviene
a
ce fujet , fi nos propres recherches ne
venoient au fecou rs. Outre les obíl:ruétions, les fup –
purations , les pourritures, les épanchemens ,
&
au–
tres défordres communs
a
toutes les maladies , on ob–
ferve les poumons flétris , de!lechés , remplis de
tu –
berc ules ou de concrétions plátreufes , rongés , ag hérens
aux parties qui les environnent. On trouve des con–
critions coeneufes dans le cceu r
&
les grolfes arteres;
les vei nes prefq ue remplies d'air; le cceur defTéché &
quelq uefois ulcéré ou t ubercu leux ; les vifceres. fltt ris
&
décolorés ; des epanchemens plus ou moi ns confi –
dérables dans les cavi tés ,
&
fur-tout des inondations
au cerveau
&
a
Ja moelle de l'épine , des engorge–
mens au poumon ou ai lleurs , des vers dans les pre–
mieres voies. On a vu dans une exténuation des plus
complettes, une quantité étonnante de grai lfe dans le mé:
fentere, l'épiploon ,
&
autres
parci~s
du bas-wntre
_q~1
en font fu fceptibles. On a vu encore l'eíl:omac ulcere ,
ou fquirrheux ; le pylore re!Terré
&
carti lagi nrnx ; la
rare extremement perite ou o!Teufe; l'épiploon collé aux
intefti ns ,
&
ces viíceres ne fo rmanc qu'u n peloton ;
Je méfentere farc i d'u ne matiere blanch átre , fo lide ,
&quelq uefois pierreu fe , fu ppuré , pmride ,
&
déc~
u.ir.Ce qu'on obferve plus particuliérement dans les v1e1 l–
lards , regarde les oíli fications des carrilages , des ten–
dons , des ligamens , des arteres , dc5 val vules du cceur ,
de la fa ulx
de la tence du cervelet,
&c.
fan s parler
de
l'al térati~n
des vifct:res qu'on ne
rencontre que
par acciden t : on a vu enfi n dans un fujet done l'clto–
mac
&
le
pancréas étoient fqu irrheux ,
les
m~n~b res
quoique refro idis
confervant route leur flex1-
b ilirJ. On juge bien qu; Ja plúpart
d~s déford re~
dont
















