
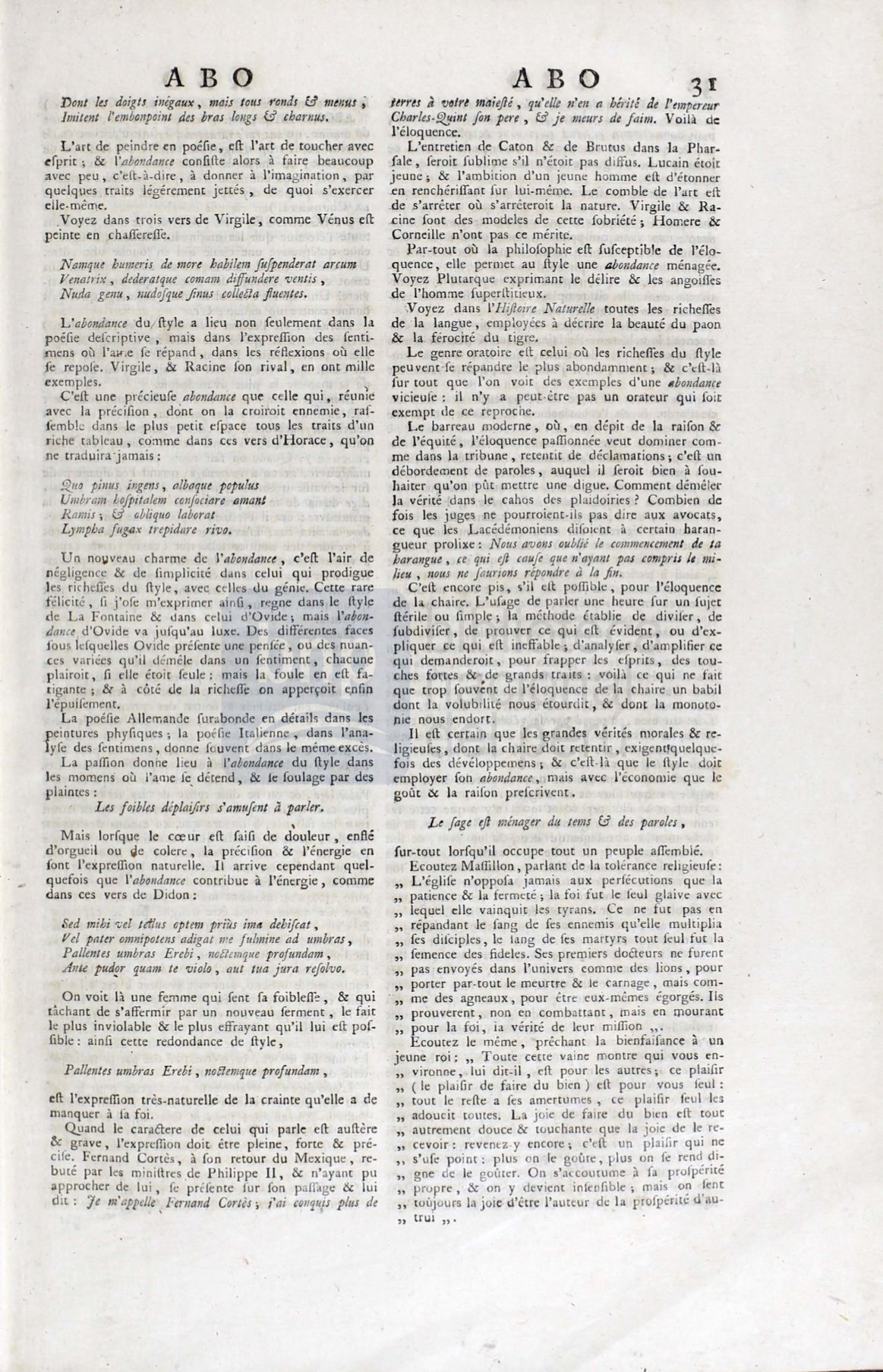
ABO
Dont les doigts i11égaux
,
mai; to111 1'onds
&
11w1u1
;
Jmite11t l'embo11point .des /;ras /ongs
&
charnus.
L'art de peindre en poélie, eíl: l'¡¡rt de toucher avec
~fprit
;
&
l'abondance
confiíl:e alors
a
faire beaucoup
avec peu, c'eíl:- a-dire,
a
donner
a
l'imagination , par
quelques rraits légérement j ettés , de quoi s'exercer
elle-mem.~.
.
.Voyez dans trois vers de Virgi le, comme Vénus
!!íl:
p einte en chaífereífe.
·
Namque humeris de more ha/;ilem fufpenderat arcum
//
enatrix
,
dederatque comam diffundere vmtis
,
Nuda gmu , nudofque jinus cotloBa fluentes.
L'abo11dance
·du/ íl:yle a lieu non feulement dans la
poélie defcriptive , mais dans l'exprdiion des fenti–
mens ou l'aH".e fe répand , dans les réllexions
0\1
elle
fe
repole. V.irgile ,
&
Rac ine fon rival, en ont mille
cxemples.
C'eft une précieufe
abondance
que celle qui, réun1é
avec la préc ilion, dont on la croiroit ennernie, raf–
frmblc dans le plus petit efpace taus les traits d'un
riche tableau, có:nme dans ces vers d'Horace, qu'on
ne rrad uira·jamais:
~10
pimts ingens , a/baque populus
Umbram hofpitalem confaciare amant
R amis
;
&
obliquo laboral
L)'mpha
fuga.~
trepidare rivo.
Un noyveau ch arme de l'
abondance
,
c'eíl: l'air de
négligence
&
de Jimpliciré dans celui qui prodigue
les ri cheífes du íl:yle, avec celles Ju génie. Cette rare
félicité ,
Íl
j'ofe m'exprirner ainfi, regne dans
Je
ftyl¡:
de
La Foncaine
&
dans cduj d'Ovjde; mais
l'abon–
dance ,
d'O vide va jufqu'au luxe. Des diJfére;1tes faces
fous kíq uelles Ovide préfente une penfée , ou des nuan–
.ces vari ées qu'il démek dans un fenriment, chacun¡:
pl airoit,
fi
elle éroi t feu le: mais la foule en ell: fa–
tigan te ;
&
a
cóté
de
la richeífe on
apper~oit
e,nfiP.
l'épuiíement.
,
L a poélie A llemande furabonde en
d~tails
dans les
_peintures phyliques; la pot' (ie l talienne , dans l'ana–
lyfe des feotimens, donne fo u vent dans
le
méme exces.
La paffion donhe lieu
a
l'abondance
du ll:yle dans
les .momens ou !'ame le, détend,
&
lt:
foulage par des
plainres :
Les foibles déplaijirs s'am11fent
¡¡
parler,
Mais lorfqu e le
c~u r
eíl: faií1 de
d~uleur,
enflé
d'orgueil ou
~e colen~,
la préci (ion
&
l'énergie en
font l'expreOion naturdle.
ll
arri ve cependant quel–
quefois q ue
l'abondance
conrribue
a
l'énergie , comme
dans ces vers de D idon:
.'led mihi -ve/ teftus optem prius im11. dehifcat,
fl
el pater onmipotens adigat me fulmine ad umbras,
Pal/entes umbras Erebi, noftemque proftmdam,
Ante
pud~r
quam le violo
,
aut tua jura refalvo.
On voit la une femme qui fent fa foib leífe ,
&
qui
tachant de s'affermir par un nouveau ferment , le fait
le plus inv iolable
&
le plus effrayan t qu'il lui ell: pof–
fible: ainli
c~tte
redondance de íl:ylc,
Pallen/es umbras Erebi , no&lemque profundam,
dl: l'expreffion tres-naturelle de la·¡:rainte qu'elle a de
manquer
a
fa
foi.
~iand
le
caraél:ere de celui qui parle efl: auíl:ere
~ . grave ,
l'expreffion doir étre pleine, forte
&
pré–
c1le .• Fernand Cortes,
a
fon retour d u Mexique , re–
b ute par
le~
min i!lres ,de Philippe
Il,
&
n'ayant pu
a ~procher
de lui, fe préfente fur fon palfage
&
lui
d1t :
Je m'appelle Fernand Cortes; i'ni co11q11is
plru
de
'
. .
ABO
31
Jtrns
ii
v~tn
mniefté
,
qu'elle
11'
en a hérité de !'empereur
Charles-f!¿tJinl fon pere,
&
je meurs .de faim.
Voila de
l'éloquence.
L'entreticn de Catan
&
de Bnm1s dans la Ph ar–
fale, frroit fublio1c: 'il n'étoit pas diJfus. Lucain éro¡t
j eune;
&
l'ambirion d'un jeunc homme
e(l:
d'étonner
.en renchériífan t fur lui-méme. Le comble de l'art ell:
de· s'arréter ou s'arréreroit la nature. Virgile
&
Ra–
.cine font des modeles de cette fobrié té ; Homere
&
Corneille n'ont pas ce mérite.
P ar-tout ou la philofophie ell: fufceptible
de
l'élo–
quence, elle pero1et au íl:yle une
abonda11ce
ménagée.
Voyez Plurarque exprimant le délire
&
les anooiífes
de l'homme fuperll:i tieµx .
P
;V
oyez rl ans l'
Hijloire Naturelle
toutes les ri cheífes
.de ·la fangue, employées
a
décrire la beauté du p aon
&
la: ffrociré du tigre.
Le genre oratoire
e!l:
celui ou les richelfes du ílyle
peu vent· fe
r~pandre
le ¡ilus abondamment;
&
c'cll:-la
fur tout qoe l'on voit des exemples d'une
1tbondanfe
vicieuie : il n'.y a peut -étre pas un ora¡eur qui foic
exempt
tle
ce reproche.
Le
b~rre¡¡u
mpderne, ou, en d épi t de la raifon
&
de l'équiré, l'éloquence paffionnée ,veut dominer com –
me
dans la tril;>une, rere11tir de déclamations; c'eíl: un
d ébordement de paroles, auquel il fero it bien
a
fou–
h aiter qu'on put meme une <l igue. Comment déméler
Ja
vériré dans le cahos des plaidoiries
?
Combien de
fois les juges ne pourroien t- ils pas dire aux avocats ,
ce que k s
La~édémoniens
difoienr
a
cen ain haran–
g ueur prolixe :
Nous avons oublié le commmcement de ta
harangue, 1e ·q11i eft caufa que n'a)'ant pas compris lt mi–
Jieu
,
llOllS /IC
faurions répondre
a
fa
ji11.
C'eíl: .:ncore pis , s'il
dl:
poffible , pour l'éloquencc
de la chaire. L' ufage de parler une heure fur un foj et
ll:érile ou
fimpl~;
la méthode itablie de divifer, de
fubdivifer, de prouver ce qui ell: évident, ou d'ex–
pl iquer ce qui eíl: ineffable ; d'analyfer, d'ampl ifier ce
.qui demanderoit, pour frapper les efprits , des tou–
ches
fo~res
&
de grand s era irs : vóíla ce qui ne Jaic
que trop fouvént de l'éloquence de la chai re un babil
dont la volubdité noi¡s_ érou rdi t,
&
doM la monoro-
11ie nous endorr.
,
Il
efl: cercain que les gra ndes vérítés morales
&
re–
ligieufe~ ,
dont la ch aire doit retentir, exige ntfquelque–
fois des dévéloppemens ;
&
c'eíl:-la que le ll:y le doit
employer fon
abo11dance ,
mais avec l'économie que le
~out ~
la raifon prefcrivent.
:Le Jage
efl
ménager du tems
&
des pnroles
,
fur-tollt lorfqu'il occupe tout un peuple alfembíé.
Ecoutez M affillqn, p arlan t de la rolérance religieu fe:
,, L'éolife n'oppofa jamais au x perfécmions que la
,,
pari~nce
&
la fermeré ; la foi fu t
le
feu l glaive avec
,, lequel elle vainquit les tyrans. Ce ne for pas en
,, repandan t .Je fang de fes ennemis qu'elle mu ltiplia
,, fes diíci ples , le tang de fes marryrs rom fcul
fue
la .·
,, fernen ce des fideles . Ses premiers doéteurs ne forent
,, pas envoyés dans l'univers comrne des lions , pour
,, porter par-rout le meurrre
&
le
carnage , mais com–
" me des agneaux, pom ttrt eux-mémes égorgés. lis
,, prouveren c, non en combattant , rnais en rnourant
,, pour la foi , ia vérité de kur miffion ,, .
Ecoutez
le
meme , prechanr la bienfa ifance
a
un
jeune roí; ,, To ute cette vaine mon tre qui vous
~n" vi ron ne , luí dit-i l , eíl: pour les autres ; ce pla1fir
,, ( le plaifir de fai re du bien ) cíl: pour vous feul :
,, tom le rdl:e a fes arnertumes , ce plailir feul les
,, adoucit tomes.
La
joie de faire du bien eíl: rout
,, autrement douce
&
touchante que la joie de
le
re–
" ce voir: revenez-y encare; c'eíl: un plaifir qui
~e
,, s' ufe point : plus on le goCi re, plus on fe rend. ?1:
one de
le
goúrer. On s'accomu rne
a
fa
profpcme
,, propre,
&
on
y
deviene infenlible ; mais
.º?
fent
roújou rs la joie d'étre l'auteur de la profpénce d'au–
"
trui
,, .
















