
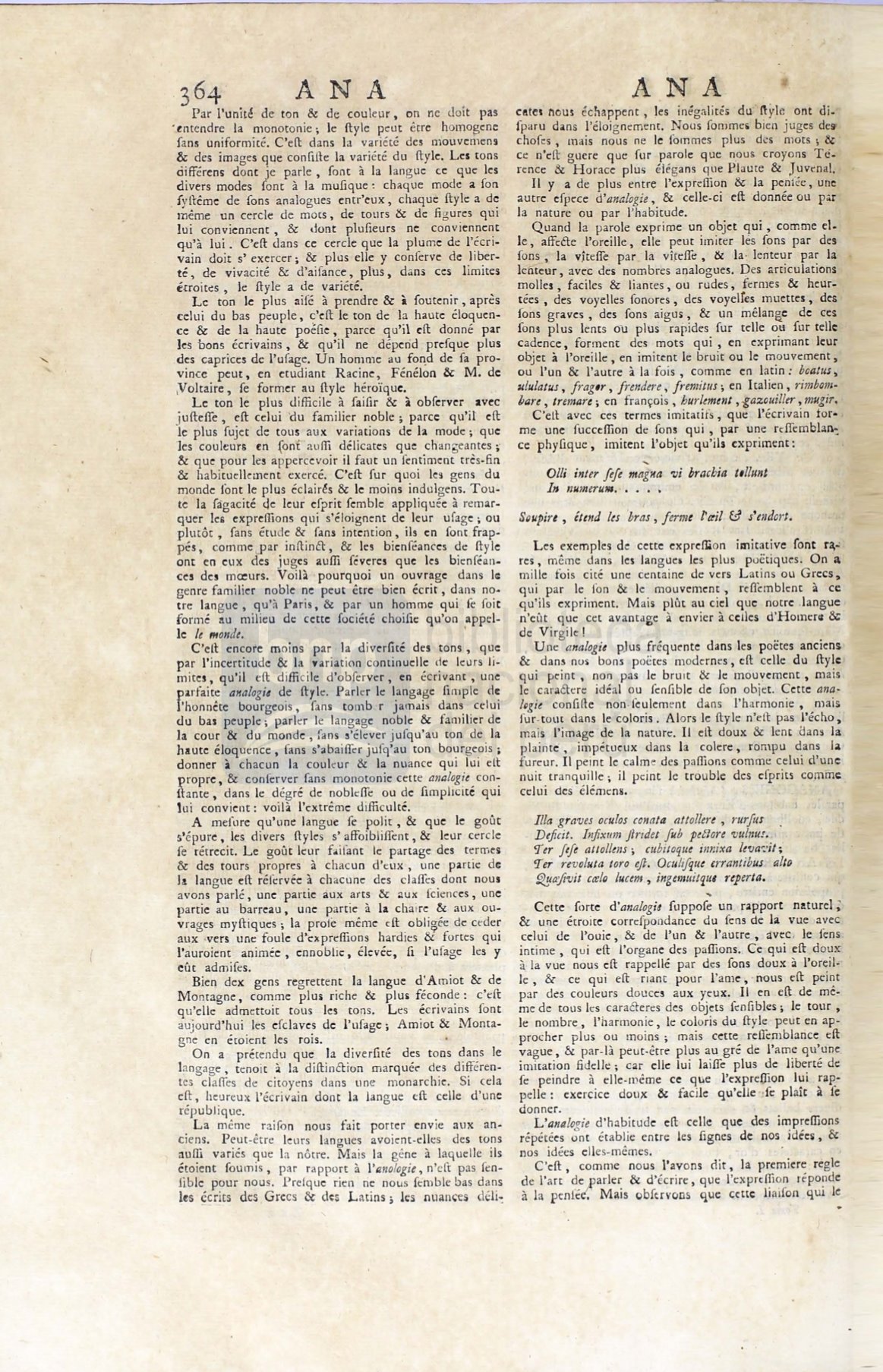
364
ANA
Par l'unité de ton
&
de cou\eur, on ne doit pas
. rntendre la monotonie; le ftyle peut erre
homo~ene
fans uniformicé. C'eíl: dans la variété des mouvemcms
&
des images que confilte la variété du íl:yle. Les tons
ciifférens dont je parle ' font a la tang ue ce que les
divers modes font a la mufique: chaque mode a fon
fylteme de fons an alogues encr'eux, chaque íl:yle a de
méme un cercle de mocs, de coms
&
de fi gures qui
Jui conviennenc,
&
Jont plufieurs ne conv iennent
q.u'a Jui. C'eft daos ce ccrcle que la plume de J'écr i–
vain doit s' exercer;
&
plus elle y conferve de liber–
té,
de viva{;icé
&
d'aifance, plus, daos ces
limites
iuoices, Je
íl:yle a de variété.
Le ton le plus :iifé a prendre
&
a
foutenir, apres
cdui du bas peuple, <;:'eíl: le ton de la haute éloquen–
ce
&
de Ja haute poéfie, parce qu'il cíl: donné par
les bons écrivains ,
&
qu'il ne déperid prefque plus
des caprices de l'ufage. Un homme au
fo~d
de fa pro–
vince peut, en ctudiant Racine , Fénélon
&
M. de
;voltaire, fe former au íl:yk hérolque.
Le ton Je plus <lifficile
a
faifir
&
a
obferver avec
j uíl:elfe, dl: celui 'du familier noble; parce qu'it eíl:
le
plus fujet de tous au x variations de
la
mode; que
les couleurs rn {onf au ffi délicates que chan¡;eames ;·
&
que pour les appcrcevoir il faut un fentimrnc tres-fin
&
habicudlcment exercé. C'efl: fur quoi ks gens du
monde font le plus éclairés
&
le moins indulgens. T ou–
te la fagacité de kur ef¡:irit femble appliquée
a
remar–
quer les expreflions qui s'éloignent de leur ufage; ou
plutór , fans étude
&
fans intention, ils en fonc frap–
pés, comme ._par iníl:iné1:,
&
les bicnf¿ances de íl:yle
ont en eux des j ugcs auffi féveres que les bienféan–
ces des mceurs. Voila pourquoi un ouvrage dans
l~
genre fa milier noble ne peut etre bien écrit' dans no–
tre lan gue , qu'a París ,
&
par un homme qui fe foit
formé au milieu de cette fociété choifie qu'on appel-
k
k
mMh
'
C'cíl: encare moins par la d iverlicé des tons , que
par l'incertitude
&
la nriation continuclle cie kurs li–
mites, qu'il eft d itficile d'obferver, en écrivanr , une
f.
arfaite
a11alogi4
de íl:y le. Parkr le langage fimple dt:
honncte bourgeois ,
fans comb r
jamais dans cclui
<lu bas peuple; parler le langage noble
&
familier de
la cour
&
du monde, fa ns s'ékver j ufqu'au con
de
la
haute éloquence, fans s'abaiffcr jufq'au ton bourgeois ;
donner
a
chacun la coukur
&
la nuance qu i lui d t
propre,
&
conferver fans monotonie cecee
analogie
con–
il:ante, daos
le
dégré de noblcffc ou de fimphc ité qui
lu i conviene: voila !'extreme d ifficulté.
A mefore qu'uoe laog ue fe polir,
&
que le gout
s'épu re, les divers
ítyles s' affoiblilfeot,
&
lcur cercle
fe rétrecit. Le goui: kur faifant
le
partage des
termes
&
des tours propres
a
chac un d'cux ' une partie de
la lang ue eíl: réli:rvée
a
ch acune des cl alfcs done nous
avons parlé , une partie aux ares
&
au x fcienccs, une
p arcie au barreau, une partie a la cha1re
&
aL1 x ou–
v rages myftiques; la prole meme cíl:
obl i~ée
de ceder
aux •vers une foulc d'txpreff10n s hardics
&
fortcs qui
l'auroienc animéc , ennoblic, élcvée, fi
l'u fage
les y
eut admifts.
Bien dex gens reg rettent la langue d'A miot
&
de
Montagne , comme plus riche
&
plus féconde : c'd l:
q u'elle adm<ttoir
ta us
les
tons. L es éc rivains foot
aujourd'hui les efcl aves de l'ufage; Amiot
&
Moota–
gne en érn ient les
rois.
O n a
prétendu que
la diverliré des tons dans le
laogage , cenoic
a
la diíl:iné1:ion
marqué~
des différen–
tcs claffes de citoyens daos une mooa rchie. Si cela
d t , heurcux l'écrivai n dont Ja lang ue eíl: celle d'uoe
républ ique.
L a meme
rai ío n nous fai t porter eo vie aux an–
ciens. Peut-etre lcurs
lao"ues avoient-el k s des coos
aum variés que
'ª
neme. 'Mais 1a gene
a.
1aque11e ils
étoient foumis ' par rapporc
a
l'1mo!ogie,
o'cft pas fen–
fible pour nous. Prelq ue rien ne nous fcmb le bas dans
l!s
~~rits
des G recs
&
d~s
L atins ; k s
m1ani;es
déli:
ANA
catet nous écñappent, les inégalités du llyle ont di–
fparu dans l'éloig nemenc, Nous
fomme~
bien juges de9
chofrs , mais nous ne le fommes plus
d~s
mots
1
&
ce n'eíl: gucre que fur parole que o.ous croyoos Té–
rence
&
Horace plus &légans que Plaute
&
Juvenal.
11
y
a de plus entre l'c:
xpreílion&
la penf<'e , une
autre efpece
d'analogíe ,
&
cclJe.cidl: donnée ou par
la nature ou par l' habitude.
Quand la parole exprime un objet qui, comme
el–
le,
affeé1:e l'oreille , elle peut im iccr les fons par des
fons , la virelfe par la v1¡elfe,
&
la· lenteur par la
leiíteur, avec des nombres ar¡alog ues, Des articulations
molles , faciles
&
liances , ou rudes, ftrmes
&
heur–
tées , des voyelles fonores , des voyelfes muettes , des
fons g raves , des fo ns aigm ,
&
un
mélao~e
de ces
fons pi us lenes o-U plus rapides fur tdle oll for telle
cadence, forment des mots qui , en exprimant Jcur
objet
a
l'oreillc, en imitent
Je
bru it ou
le
mouvement,
ou !'un
&
l'autre
a
la fois , comme en latín:
boatus,
u!ulatus, f rag1r, f rendere , fremitus;
en ltal ien,
rimbom–
bare, tremare;
en
fra n~ois
,
hurlemrnt, .gazouiller, mugir,
C'elt avec ces termes imitatifs, qm: l'écri vaio for–
me une fuccdlion de fons qui , par une rdfemblan:
ce phyfique, imitent l'objet qu'ils cxpriment:
'
01/i ínter fa/e 111ag11a
'llÍ
bracbia 11/lunt
In numerum•
••••
Squpire
,
étmd
les bras, f erme l'ail
&
s'endorJ.
Les
exemple~
de cette expreltion
imitative font
f:\~
res, méme dans les
lang ue~
les plus poeriques. On a
mi lle fois cicé une cencaine de vers L atins o u Grecs,
qui par
le
fo n
&
le
mouvemcnc, rdlcmbknt
a
ce
q u'ils exprimcnt. Mais plut au cid que nocre .laogue
n'etit que cet av antage
a
cnvier
a
cc1les d'Homrn:
&
de V irgik
!
U ne
analogie
pJus
fréqu~nte
dans les poetes anciens
&
dan• nos bons poeccs modcrnes, eíl: cdle du íl:yk
qui pei ne , non pas
le
bru 1t
&
Je mouvemenc, mais
le caraé1:crc
idéal ou fcnlible de fo n objet. Cecee
ana–
l~gie
coofiíle non. feulement dans
l'harmonie , mais
fur-tout dans le colorís . Alors
le
íl:yle n'eft pas l'écho,
mais l'image de la oaturc. ll ell: doux
&
lent élaos la
plaiote ,
impétueux dans la colere, rompu daos
la
fu reur. 11 peine
le
ca lme des paffions comme celui d'une
nuit tranqu ille ; il pcint
le
trouble des efprits co]Timc:
cclui des élémens.
Jlla graves oculos co1Mta attollere
,
rur/ur
Difícit.
l njixum
Jlndet
/ ub peélore v11/rz11!.
<fer fa/e allol!em
;
cubiloque i11nixa
lrna~·it;
'J'er revoluta toro
cft.
Omlifi¡ue crrantibus a/Jo
f?<t!afzvil c111!0 !ucem
,
ingem11itq111 reperla.
Cette fo rte
d'analogit
fuppofe un rapport naturel ;
&
une écroi te corrcfpondaoce d u fens de la vue avec
celui <le
l'ouie,
&
de l'un
&
l'aucre , avec .
Je
fen s
intime , q ui eíl:
l'orgaoe des paffions. Ce qui eíl: d oux
a
la vue nous eíl: rappd lé par des fons d oux
~
l'oreil–
le ,
&
ce qu i efl:
riant pour !'ame, nous eíl: pei ne
par des couleu rs douccs aux yeux. 11 en eíl: de mc–
me de tous les caraé\-crcs des objets fr ofibles; le tour ,
le nombre , l'harrnon ie ,
le
colorís du fiyle peut en ap–
prochcr plus ou moins ; mais cecee refü:mblance dl:
vague,
&
par-la peuc-etre plus au gré de !'ame q u'uoe
im itacion fide lle ; car elle lu i lailfe plus de liberté de
fe
peind re
a
elle-meme ce que
l'cxprelflon lui rap–
pelle: exercice doux
&
fac ile qu'clle
.fe
plait
a
fe
dooner.
L'a111tlogie
d'habitude eft celle que des impreffions
répécées on c établ ie entre les fignes de nos idée$,
&
nos idées elles-memes.
C'eíl:, comme nous l'avons clit, la premiere regle
de \'are
~-e parle~
&
d'écrire , q ue l'cxprd!ion réponde
a
la penké.. M a1s obftrvons que cctte lia1fon qui
le
















