
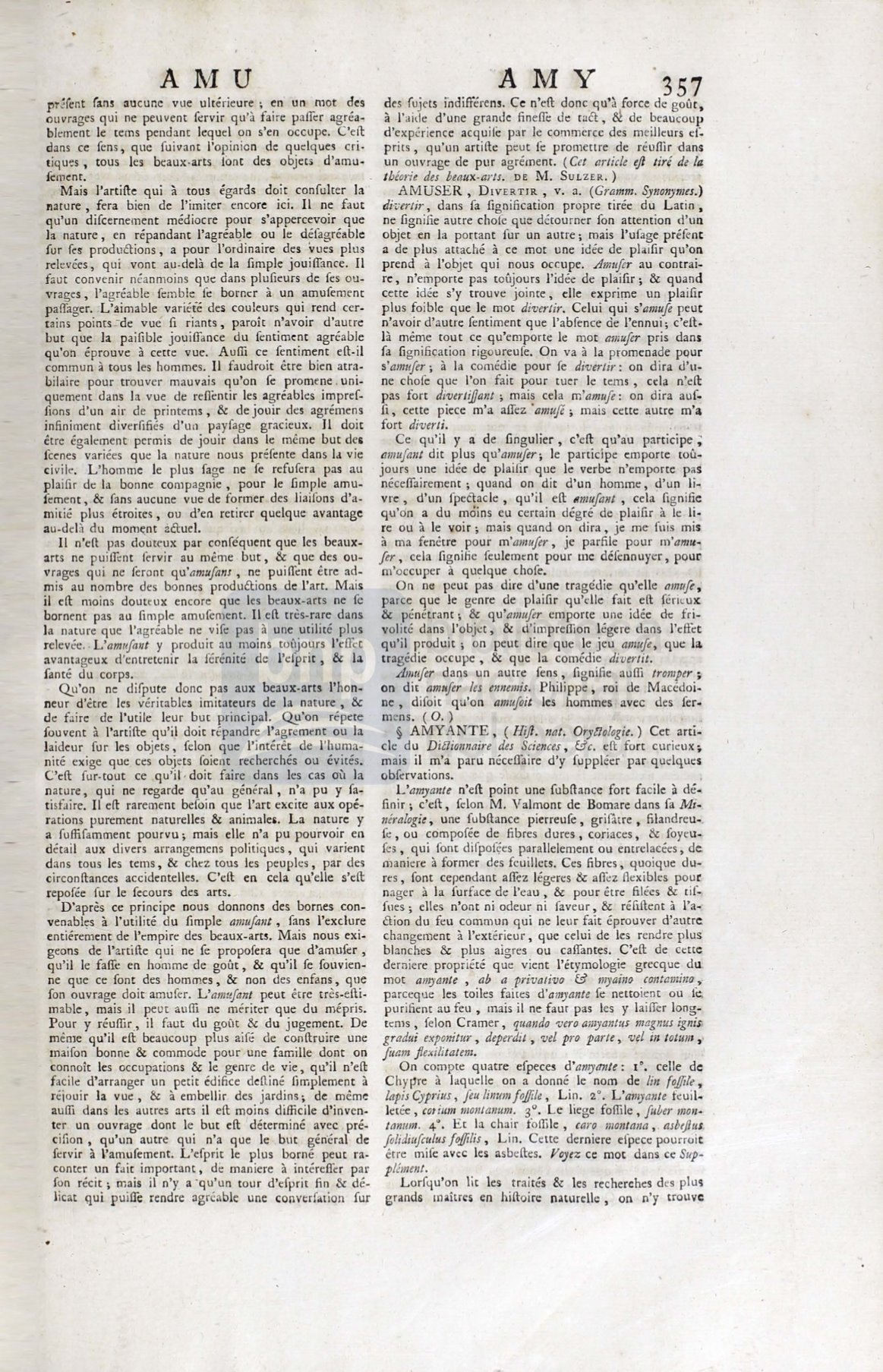
AMU
préíent fans aucune vue ultérieure ; en un mot des
ouvrages qui ne peuvent f.:rvir qu'a faire palfer agréa–
blement le cems pendant Jeque! on s'en occupe. C'eíl:
Elans ce fens
1
que fuivant l'opinic n de qudques cri·
t iques, tous les beaux-arts font des objecs d'amu–
fc:ment.
Mais l'artiíl:e qui
a
tous égards doit confulter la
nature , fera bien de l'imi cer encore ici.
11
ne faut
qu'un difcernement médiocre pour s'appercevoir que
Ja nature, en répandant l'agréaqle ou
le
défagréable
fur
fr~
produél:ions , a pour l'ordinaire des vues plus
rckvées, qui vont au-deE1 de la fimple joui!fance.
Il
faut convenir néanmoins que dans plufieurs de fes ou–
vrages, l'agréable femble ft: borntr
a
un amufement
pa!fager. L'aimable variffé des couleurs qui rend ccr–
tains points.· de vue fi riants, paroit n'avoir d'aum:
bue que la paifible jouilfance du frntimcnt agréable
qu'on éprouve
a
cene vue. Aufli ce fentiment eíl:-il
commun
a
tous les hommes.
Il
faudroit etre bien atra–
bilaire pour trouver mauvais qu'on fe promene . uni–
quemen t dans la vue de relfentir les ag réables· impref–
fions d'un air de printems,
&
de jouir des agrémens
infiniment diverfifiés d'un payfage gracieux.
JI
doit
etre également· permis de jouir dans le meme but de'
fcenes variées que la nature nous préíente dans la vie
ci vile. L 'homme le plus fage ne fe refufera pas au
plailir de la bonne compagnie , pour le !imple amu–
frment
,.&
fans aucune vue de former des liaifons d'a–
mitié plus étroites, ou d'en retirer quelque avantage
au-dela du momi;:nt aél:uel.
11
n'eíl: pas
dou~ux
par conféquent que les beaux–
arts ne puilfent fervir. au merne but,
&
que des
Oll–
vrages qui ne feront
qu'amufan_s
,
ne puiífont etre ad–
mis au nombre des bonnes produé\:ions de l'art. M ais
íl
eíl: moins douteux encorc que les beaux-arrs ne fe
bornent pas au fimple amufement.
11
ell tres-rare dans
la nature que l'agréable ne vife pas
a
une utilicé plus
relevée. .
L'am1ifa11t
y produit au moins tofijours l'effct
avantageux d'entretenir la férénité de l'dprit ,
&
la
fanté du corps.
Qi'on ne difpute done pas aux beaux-arts l'hon–
neur d'etre les vérirnbks imitateurs de la nature ,
&
de foire de l'utile leur but principal.
~·on
répete
fouvent
a
l'artifte qu'il doit répandre l'agrément ou la
laideur fu r les objets, felon que l'i ntérec de l'huma–
nité exige que. ces objets íoient recherchés ou évités.
C'eíl: íur-tout ce qu'il·, doit faire dans les cas o\) la
nature, qui ne regarde qu'au gé néral, n'a pu y fa–
tisfaire. 11 eíl: rarement befoin que l'art excite aux opé–
rations purement
n~rnrelles
&
anímale¡, La nature y
a fuffifamment pourvu; mais elle n'a pu pou-rvoir en
détail aux divers arrangemcns politiques, qui varient
daos tous les tems ,
&
chez tous les peuples, par des
circon íl:ances accidentelles. C'cít en cela qu'elle s'eít
repofée fur le fecours des arts.
D'apres ce príncipe nous donnons des bornes con–
venablc::s
a
l'utilité du fimple
amufa11t
,
fans l'exclure
entiérement de l'empire des beaux-am. Mais nous exi–
geons de !'artille qui ne
fe
propofera que d'amufer,
qu'il le fa{fe en homme de gout,
&
qu'il fe fouvien–
ne que ce font des hommes,
&
non des enfans, que
fon ouvrage doit amufer.
L'amiefant
peut etre tres-eíl:i–
mable, mais il peut auffi ne mériter que du mépris.
P our y réuffir_, il faut du gout
&
du jugement. De
meme qu'il eíl: beaucoup plus aifé de coníl:ruire une
maifon bonne
&
cornmode pour une famille dont on
connoit les occupations
&
le genre de vie, qu'il n'efb
facile d'arranger un petit édifice delliné fimplement
a
réjoui r la vue,
&
a
embellir des jardins; de meme
auffi dans les autres arts il eíl: moins difficile d'inven–
ter un ouvrage dont le but eít déterminé avec pré–
cifion , qu'un autre qui n'a que le bm gén'éral de
frrvir
a
l'amufement. L'efprit
le
plus borné peut ra–
conter un fait important ' de man iere
a
intéreffer par
fon récit; r.r.ais il n'y_ a ·qu'un tou r d'efprit fin
&
dé–
licat qui puilfe rendre agréable une converíarion fur
A M
y
357
des fujets i'ndifférens. Ce n'eít done qu'a force de goC1t,
a
l'aide d'une grande finelfe de . raé\:,
&
de beaucoup
d'expérience acquife par le commerce des meilleurs ef.
prits, qu'un artiíl:e pt:u t
fi:
promectre de réullir {)ans
un ouvrage de pur agrémenr. (
Cet article
e.fttiré de la
1béo1ie des beaux-arts.
DE
M.
SuLZER. )
AMUSER,
D1vERT JR, v. a.
(Gramm. Synonymes.)
dh;ertir ,
dans
fa
fignification propre tiré.: du Latin,
ne fign ifie autre chofe que détourner fon attention cl'un
objet en la portant fur un amre ; mais l' ufage préfent
a
de plus attaché
a
ce mor une idée de plaifir qu'on
prend
a
l'objet qui nous occupe.
Amufar
au contrai–
re,
n'emporte pas toujours l'idée de plaifir;
&
quand
cette idée s'y trouve joinre , elle expri¡ne un plaifir
plus foible que le rnot
divertir.
Celui qui
s'amufa
peut
n'avoir d'autre fentiment que l'abfence de l'ennui; c'eft.
Ja
meme tout ce qu'emporte le mot
amufar
p ris dans
fa
fi gn ifioation rigou reufe. On va
a
la promeaade pour
s'amufar;
a
la comédie pour fe
divertir:
on dira d'u–
ne chofe que l'on fait pour tuer le tems , cela n'.eít
pas fort
divertijjant
;
rnais cela
m'amufe:
on dira auf.
fi, cette piece m'a affez
'amuft;
mais cette autre m'a
fort
diverti.
Ce qu'il y a de fingulier, c'eít qu'au participe;
amufa11t
dit plus
qu'amufer ;
le participe
~porte
toú–
jours une idée de plaifir que le verbt: n'emporte pas
nécelfairernent ; quand on dit d'un homrne, d'un li–
vre, d'un fpetl:acle, qu'il eít
tmiufant
,
cela fignifie
qu'dn a du mciins eu certai n dégré de plailir
a
le
li–
re ou
a
le voir; mais quand on dira, je me fois mis
a
rna frnetre pour
m'amufar,
je parfile pour
m'amu–
fer ,
cela fignifie feulemtnt pour me défennuyer, pour
m'occuper
a
quelque chofe.
On ne peut pas dire d'une tragédie qu'elle
amuje;
parce que le genre de plaifir qu'elle fait eíl: férirnic
&
pénétrant;
&
qu'amufer
emporte une idée
de
fri–
vol ité dans l'obj.:.:t,
&
d'impreffion légere dans l'dfet
qu'il produit ; on peut dire que le jeu
amuje ,
que la
tragédie occupe,
&
que la comédie
di'uertit.
Am11far
dans un autre fens , fignifie auffi
tromper;
on dit
amufar les ennemis.
Philippe , roi de Macédoi–
ne , difoit qu'on
amufoit
les hommes avec des fer–
mcns.
(O.)
§
AMYANTE, (
Hi.ft.nat. OryBologie. )
Cet
arti–
cle du
Diélionnaire des Sciences , &c.
eíl:
fort
curicux;
mais il m'a paru nécelfaire d'y fuppléer par qudques
obfcrvations.
,
L'amya11te
n'eít point une fubllance fort facile
a
dé-.
finir; c'eít, felon M . Valmont de Bomare dans fa
Mi–
néra!ogie ,
une íubtlance pierreufe, grifatre , filandreu-.
fe , ou cómpofée de fibres dures, coriaces ,
&
foyeu-.
fes , qui font
difpof~es
parallelement ou entrelaeées, de.
maniere
a
former des fcuillets. Ces fibres, quoique du–
res, font cependant alfez légeres
&
alf~z
flexibles pou r
nagcr
a
la furface de 'l'eau,
&
pour étre filées
&
tif–
foes ; elles n'ont ni odeur ni faveur,.
&
réfülent
a
l'a–
él:ion du feu commun qui ne leur fait éprouver d'autre.
changen)ent
a
l'extérieur, que celui de les rendre plus
blanches
&
plus aigres
QU
calfantes. C'eít de cene
derniere propriété que vient l'étymolugie grecque du.
mo.t
amya11te
,
ab a privativo
&
myaino co11tami110
,–
parceque les toiles
fa
ices d'
amyante
fe nettoient ou
tt:,
purifient au feu , mais il ne faur pas les y lailfer long–
tcms ,
fe
Ion C ramer,
qua11do vero a1nya11111s magmts ignis.
gradui expomtur
,
deperdil
,.
wl
pro parte,
wt
in
10111111
,.
J11am flexilitatem.
1
On compte quatre efpeces
d'amymzte :
1º.
celle de
Chypre
a
laquelle on a donné le nom de
/in fojjife
•
lapis CJ•pri1 s, fau linum fojjile ,
Lin.
2 °.
L'
anryante
frui l–
lerée,
corium montanum.
3º. Le liege follile,
f11ber mon–
tanum.
4°. E t la chair foffi le ,
caro montana,. asbej111s.
f olidiufculus fof!ilis ,
Lin. Cette derniere efpece pourroit
erre mife avcc les asbefres.
/loyez
ce moc dans ce
Sup–
p!ément.
L orfqu'on lit les traités
&
les recherches des plug
grands maitres en hiíl:oire naturelle , on n'y trouvc
















