
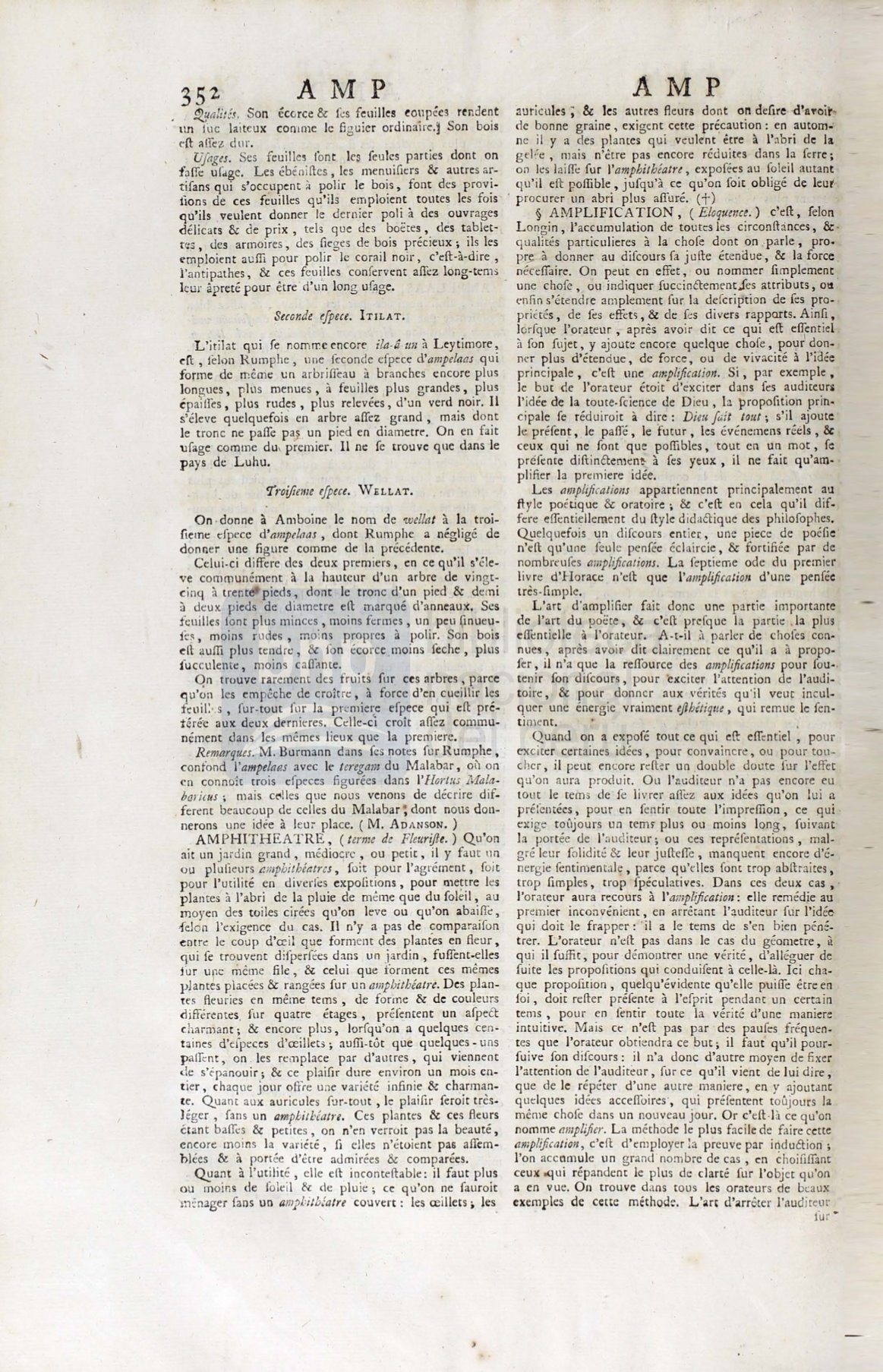
352
A M P
!!¿ualités.
Son écorce
&
fes fellilles eoupées rendent
un foc
laiteux con1me
le
figuicr
ordinaírc.~
Son bois
dl a!fr·i dur.
Ufnges.
Ses feuilles fon t
ks
feulcs parties dont on
falfr
uí.igc. Les ébéniíl:es , les menuifiers
&
autrcs
ª'.–
tifans qui s'occupent
a
polir
Je
bois, font des prov!–
tions de ces fcuilks qu'ils emploient tomes les fo1s
qu'ils veulent donner le dernier poli
a
des ouvragcs
délicars
&
de prix , tels que <les boetes, des tablet–
r~s
, <les armoires , des lieges de bois précieux; ils les
~mploient
auffi pnur pol ir le corail noir, c'dl:-a-dire ,
l'antipathes,
&
ces fcuiHcs confervent
allá
long-tenH
Icur apreté pour etre d'\in long ufage.
Stconde
e/pece.
h1LAT.
L'itilat qui fe nomrr.c encare
ila-li
1111
a
Leytimore,
dl,
felon Rumphe , une fcconde efpece
d'ampelaas
qui
forme de mcme un arbriffeau
a
branches cncore plus
longues, ph1s menues,
a
feuilles plus grandes, plus
é¡;ailfes, plus
ru?~s,
plus rdevées, d'un verd .no!r.
11
s'eleve quelquefo1s en arbre atrez grand , ma1s dont
le tronc ne paffe par un pied en diametre. On en fait
ufage comme du, prernier.
11
ne
fe
rrouve que dans le
pays de Luhu.
<Iroijie111e efpece.
WELLAT.
On -donne
a
Amboine le nom de
wellnt
a
la
troi–
fiemt: cfpece
d'mnpelaas,
dont Rumpbe a négligé de
doni;¡er une figure comme de la précédente.
Ctlui-ci differe des deux premiers, en ce qu'il s'éle–
ve communément
a
la hamcur d'un arbre de vingt–
cinq
a
trent picds' dont le tronc d'un pied
&
demi
3
deux pieds de diametre eíl: marqué d'anne-aux, Ses
feuilles font plus minces , moins fermes , un peu (inueu–
fr>,
rnoins rndes , moins proprcs
a
polir. Son bois
eíl: auffi plus tend rc:,
&
fo n écorce .moins feche , plus
focculente, rnoins ca{fante.
Qn trouve rarement des frnits for ces arbres, parce
qu'oa les empcche de cro1tre ,
a
force d'en cueillir les
fruil'.-.s , fur-tout for la
pr~miere
efpece qui eíl: pré–
féré·e aux deux dern ieres. Cdle-cl croit atrez commu–
nément dans les memes lieux que la prerniere.
R emarques.
M.
Burmann dans fes notes fur Rumpl1e,
confond
l'ampelaas
avec le
teregam
du Malabar, oi\ on
en connoit rrois efpeces ligurées <lans
l'Hartus lvlala–
baricus;
mais cc<lles que nous venons de décrire dif–
ferent beaucoup de celles du
Malabar~
dont nous don–
nerons 4ne idée
a
leur place. (
M.
AOANSON. )
AMPHITHEATRE, (
terme de
Fleurifle.)
Qu'on
ait un ja;din grand, médioGrc , ou petit, il
y
fam un
ou plutieurs
emphithéatres,
fo:t pour l'agrérncnt, foi t
pour !'utilicé en diverlt:s cxpolitions, pour
01e~rre
les
plantes
a
l'abri de la pluie de meme que du foleil' au
moyen des toiles cirées qu'on leve ou qu'on abaiffe,
1clc n l'exigencc du cas.
Il
n'y
a
pas de
~omparaifon
entre:
le
coup d'cei l que forment des plantes en fleur ,
qui
fe
trouvent difperfées dans un jardín , fuffent-elles
for u
ie
ri1eme file,
&
celui que formen t ces mernes
}'lances placées
&
rangées fur un
amphithéatre.
Des plan–
tes
fleuries en meme tems ' <le forme
&
de couleurs
différentes. fur q uatre étages , préfrntent un afpeél:
charmant;
&
encare: plus , lor(qu'on a quelques cen–
t aines d'efpeccs d'cx:illets; auffi-tot que quelques - uns
paffcnt, on les remplace par d'amres, qui viennent
de
s'~panouir;
&
ce plaifir dure enviran un mois cn–
t ier, chaque jom offre une variété infinie
&
charman–
te. Quant aux auricules fur-cout, le plaifir feroit tres–
l égcr , fans un
ampbitbéatre.
Ces plantes
&
ces fleurs
étant batres
&
perites, on n'en verroit pas la beauté ,
encore moi ns la vari¿té, li elles n'étoient pas affem–
blées
&
a
portée d'etre admirées
&
comparées.
~ant
a
l'urilité ' elle eíl: inconteíl:able: il faut plus
ou rnoins
de
foleil
&
de plu ie; ce qu'on ne fauroir
!n:'nager fans un
amphitbiatre
couvert : les ceillets; )es
AMP
auricules ;
&
les autres Aeurs dont
on
deúre
·d'a,.oir·
ele
bonne graine, exigcnt cene
pr~caution:
en autom_.
ne il y a des plantes qui veultnt étre
a
l'abri de la
gel •e , mais n'etre pas encare réduites daos la ferre;
on ks lailfe fur
l'amphithéatre,
expofécs
au foleil aurant
qu'il eft poffible, jufqu'a ce qu'on foit obli.gé de
lcul'
procurcr un abri plus affur.é.
(t)
§
AMPLIFICATION, (
Eloqumce.)
c'd1:, felon
Longin, l'acc umulation de toutes les circonílctnces,
&
qualirés parriculieres
a
la chofe dont on .parle. pro.
pre
a
donAer au difcours
fa
jufl:e étenaue,
&
Ja force
néceffaire. On peut en effet, ou nommer limplement
une chofe, ou indiquer fuccinél:ement.Ses attributs,
011
enfin s'étendre amplement fur la defcription de fes pro–
priétés, de fes
effet~,
&
de . f.:s divc:rs rapparts. Ainfi,
lorfque l'orateur , apres avoir dit ce qui eíl: elrentiel
a
fon fujet,
y
ajoute encore quelque chofe,
pou~
don–
nrr plus d'étendue . de force' ou de vivacité
a
l'idée
principale , c'cíl: une
ampli}ication.
Si , par exemple ,
le
bue de l'orateur étoit d'exciter dans fes auditeur¡
l'idée de la toute-fcience de D ieu,
la
¡iropo!ition prin–
cipale fe rédu iroit
a
dirc :
Dim fait
tout;
s'il ajoutc
le
préfent, le palfé, le t'urur, les évi:nernens réels,
&
ceux qui ne font que polribles, ·rout en un mor, fe
préfenre
di frinél:emen~
a
fes yeux • il ne fait qu'am–
plifier la prcmiere idée.
Les
amplijications
appartiennent principalement au
fiyle poétique
&
oratoire;
&
c'dl: en cela qu'il dif–
fcre eífentiellement du íl:yle didaél:iqt1e des philofophes.
Qgelqt1efois un difcours enrie,, une piece de poélie
n'cíl: qu'une feule penfée éclaircie ,
&
fortifiée par de
nombreufes
amplijicat!ons.
La feptieme ode du premier
livre d'.Horace n'eft que
l'amplijicalio11
d'une penféc
tres-limpie.
L'art d'ampl ifier fait done une partie importante
de l'art du poete ,
&
c'eíl: · prefq ue la partie
la pl us
elrentielle
a
l'orateur. A-t-il
a
parler de chofes con–
nt1es, aprcs avoir dit clairement ce qu'il
a
a
propo–
fer, il n'a que la retrource des
amplijications
pour
fou- .
tenir fon di(cours, pour exciter l'attenrion de l'audi–
toirc,
&
pour donncr aux vérités qu "i l veut incul–
quer une énergie vraiment
eflhitiq11e ,
qui remt1e
le
fen-
ti ment.
·
,
Quand on a expofé tout ce qui eft elfcntiel , pour
exciter cerraines idées , pour convai ncre, ou pour tou–
chcr , il peut encare: rcíler un double doute fur l'e!fet
qu'on at1ra produit. Ou l'nt:direur n'a pas encore eu
tout
le
cems de · fe livrer alfoz aux idécs qu'on luí a
préfcn¡ées, pour en fen tir toute l'impreffion, ce qui
exige tol'1jours un rems plus ou moins long, fuivant
la porrée de l'auditeur; ou ces Tepréfentations, mal–
gré leur folidité
&
leur juíl:effe , manquent encore d'é–
nergie fentimentale , parce qu'dles font trap abíl:raites,
trop limpies, rrop fpéculatives. D ans ces dcux cas ,
l'orateur aura recours
a
l'a111plijicatio11:
elle remédie au
prcmier inconvénient' en arretanr l'auditeur Íllr l'idfo
qui doit le frapper: il a le tems de s'en bien péné–
trer. L'orateur n'cíl: pas dans le cas du géometre ,
ii
qt1 i il fu ffi c, pour démontrer une vérité , d'alléguer de
fu ite les propolirions qui conduifent
a
celle-la. Ici cha–
que propofuion, quelqu'évidente qu'tlle puiffe étre en
foi' doit reíl:er préfente
a
l'efprit pendan¡ un cerra in
tems , pour en fentir
toute la vérité d'unc maniere
intuitive. Ma is ce n'eíl: pas par des paufes fréquen–
tcs que l'orateur obtiendra ce but; il faut qu'il pom–
fuive fon difcours: il n'a done d'autre mayen de 6xer
l'atten tion de l'audiceur, fu r ce qu'il viene de lui dire ,
que de le répéter d' une autre maniere, en
y
ajoutJnt
quelq ues
idées acceffoires·, qui préfentent toujours la
meme chofe dans un nouveau jour. Or c'ell:-la ce qu'on
nomme
nmplifier.
L a méthode le plus facile de fai re cette
nmplijication,
c'e!t d'eniployer !a preuve par ÍC)duél:ion;
l'on accL1mule un grand nombre de cas , en choi!ilfant
ceux .qui répandenr
le
plus de clareé fur l'objct qu'on
a en vue. On trouve dans mus les orateurs de beaux
cxemples
de cene
méthode. L'art d'arr6ter l'audireur
fo r •
















