
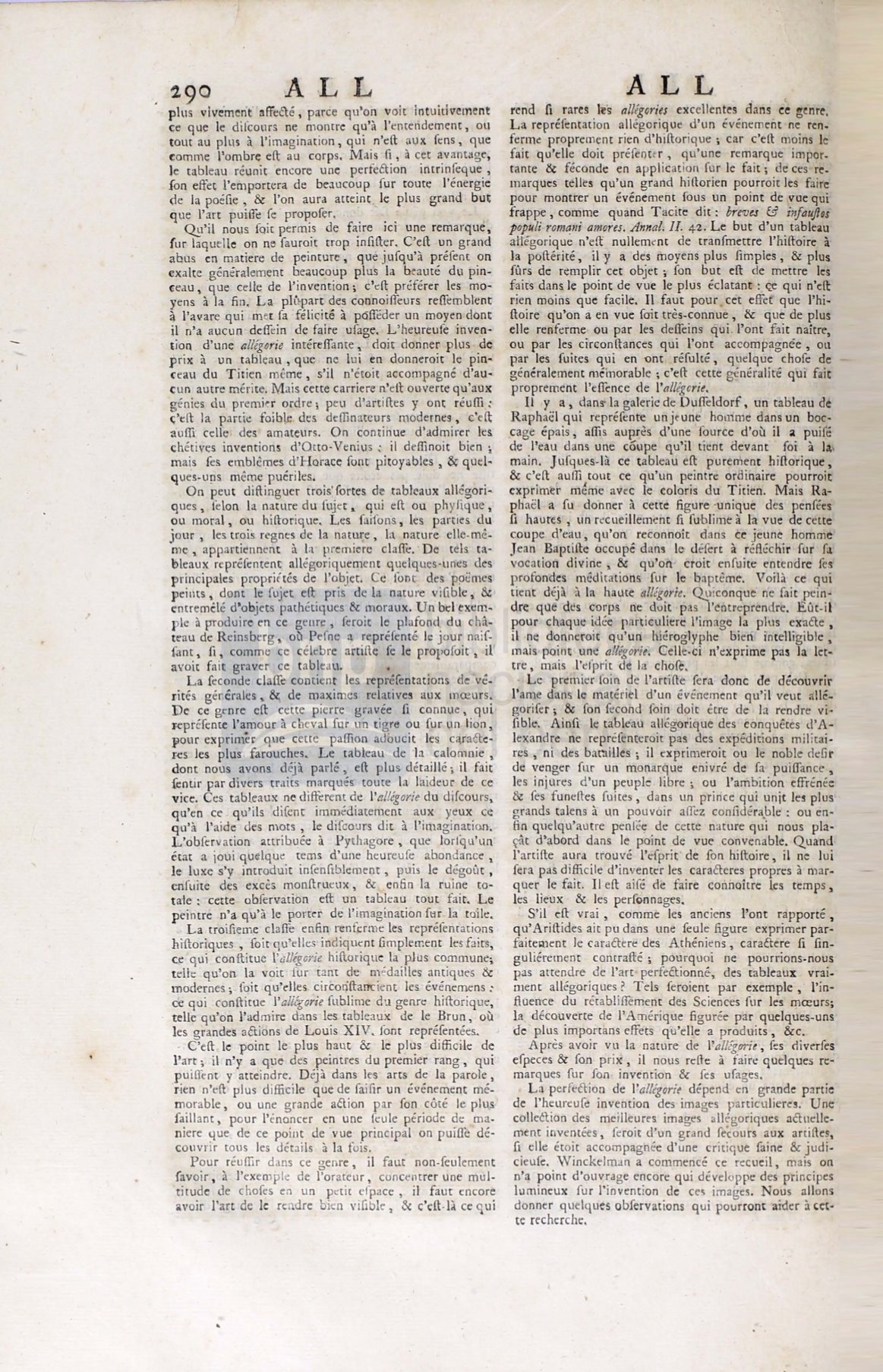
i9o
A L L
ph1s vivement aff'efté , parce qu'on voit iotuitivement
ce qus: le difcoms oe moncre qu'a l'e11 te1idement, ou
tout au pl us a l'imaginaüon, qui n'dl: al) )( frns, que
eomme l'ombre e!t au corps. M ais !i ,
a
cet avantage,
Je
tableau réunit encore une perfeét ion i,ntrinfeq ue ,
fon eft'et l'emportera de beaucoup fur toute l'énergie
de la poéíle ,
&
l'on aura atteint
le
plus grand but
q ue l'art puifo fe propofer.
Q.l,t'il nous foir permis de fai re ici une remarque,
fur laquelle on ne fauroit tro p in!iíl:er. C'eíl: un grand
abas en matiere de peinture , que jufqu'a préfent on
exalte généralement beaucoup plus la beauté d\t pin–
~eau,
que celle de l'i nvention; c'cft préférer les mo•
yens
a
la fi n, La
pl~part
des connoi!feurs reífemblent
a
l'avare qui met
fa
fül id té
a
póíféder un moyen dont
il o'a aucun deffein de faíre ufage. L ' heureufe inven·
tion d'une
'1llégorie
in téreífante, doit donner plus de
prix
a
un tableau 'que ne luí en donneroit le pin–
ceau du T itien meme, s'il n'étoit accompagné d'au–
c; un autre mérite. M
a.iscette carriere n'eil: ou.vene qu'aux
génies du
p remi~r
ordre
¡
prn d'artiftes
y
ont réuffi ;
c;'eft la panie foib!J;, des deffin atcurs modernes , c'eíl;
a u(fi' celle des amatem s. O n continue d'adm irer les
c;hétives inventlons d'Qno-Ve ni\15 ; il delli noit bien ;
mais fes emblernes d'H orace fon t p itoyables ,
&
quel–
q ues- u¡is méme ·puériles.
On peuc dif\-i nguer trols' fortes de tableaux allégori –
q ues , felon la narnre du. fu.jet. qui eft ou ph y/lque '·
ou moral, ou hiltoriq ne. L es fai foos , les parties du
jour , les trais. regnes de la
na tu~e,
la nature elle-me–
me , appartiennent
a
la prerniere claífe. · D e tels ta·
bleaux repréfenteni; allégoriq uement q uelques-unes des
principales propriétés de l'objet. Ce fon t des p!Jiimes
peines, dont le fujet efr pris de la natu re viúble ,
&
entremclé d'objets pathétiques·
&
rnoraux. Un bd exem–
ple
a
¡rroduire en ce genre , feroit le plafoo d du cha–
reau de R einsberg , ou Pefne a repréfenté
le
jour naif–
fan t,
[¡
,
comrne ce célebre artiíle fe
le
propofoit , il
avoit fa it graver ce tablern.
.
L a fe conde clalfe contient les repréfentations de vé•.
rités générales ,
&.
de maximes relaLives aux mre.urs.
De ce g.rnre d l: cette p ierre gra1<ée
ü
connue , qui
r.epréfente l'amour
a
cbeval fu r un tigr6· ou fur un lion,
p.our exprimér que cette pafüon adbucit les ca.raftc–
res les plus farouches. L e cableau de
·Ja
calomnie •·
dont nous avons déja parlé, eft plus déraillé ;
il
fa it
fen úr par divers traits marqués toute la laideur de ce
vice. Ces tableaux ne diffrrent de
l'al!égorie
du difcou1,s,
qu'en ce . q u'ils difent irnmédiatement aux yeux ce
qu'a l'aide des mots ' le difcours dit
a
l' irnagi nation.
1.'obfe rvation amibuée a Pythagore, que lorlg u' un
état a joui qud que tecns d' une beureufe abonda nce
1
le
luxe
s'y
introduit infen fi lllement , puis
le
dégout ,
enfuice des exoes monftr ueux , & enfi n la ruine to–
t a'le
~
cette uhfenzation eíl: un tableau tou r fait. Le
p ei'ncre n'a qu'a le portcr de l' imagination für la to'ile.
La rroifieme clalfe enfi n nmferme les repréfentations
h iftoriques , fo it qu'elles indiq uent fi mplement les fa irs,
ce q ui confti tue
l'<1llégorie
hi!loriquc la µJu s commune;
tellc qu'on la
voit
for
tant
de médailles antiques
&
modernes ; foit qu'dles circoriftarrc ient les événemens :
ce qui conftirue
l'aliégorie
fublime du genn: hiftori que,
telle qu'on l'admin:: daos les tableauic de le Brun , ou
les grandes aélions de L ouis X IV. fon t repréfentées.
· C'eft le point le plus haut
&
le
pl us diffi cilc de
l' art ; il n' y a que des peintres d u premier rang , qu i
pu i!fent
y
atteindre. Déja dans les arts de la parole ,
r.jen n'eft plus diffici le q ue de fai!ir un événement mé–
morable , ou une gra nde aélion p ar fon coté le pl us·
faillant, pour l'énoncer en une feu le période de ma–
n iere que de ce poin t de ·vue principal on puifü: dé–
couvrir tous les <létails
a
la fois.
Pou r réufii r daos ce genre, il faut non-feulement
favoi r ,
a
l'exemple de l'orateur , concentrer une mu l–
ti rude de chofes en un pctit efpace , il faut encore
avoir J'art de
le
re dre bien vilible,
&
c'
efr.Jace q ui
ALL
rend
fi
rares
res
allégories
excellentes cians ce gcnre,
La repréfenration allégorique d' un événemeiit ne ren–
ferme propremen t rien d'hiil:orique ; car c'eft moins
le
fait qu'clle doit préfentt r, qu' une remarque impar.
tanre
&
féconde en appl ication fo r le fa it ·; de ces re.
marques telles qu'un grand hiílorien pourroit les faire
pour montrer un événement fous un point de vue qui
frappe, comme quand T acire dit :
breveJ
&
infauflos
poputi roma_11i amorN. .!1nn'1/; JI.
42.
Le but d'un cableau
attégorique n'eff nullem<nt de tranfmettre l'hiftoire
a
la poftérité, il
y
a des moyens plus !imples, & plus
fUrs de remplir cet objet ; fon but eft de mettre les
f.a its dans le point de vue le plus éclatant :
~e
qui n'eíl:
rien moins que facile. Il faut pour cet etfet que l'hi–
ftoire qu'on a en vue faic tres-connue,
&
que de plus
elle renferme ou par les deífeins qui. l'ont fai t naitre,
ou par les circonftances qui l'ont accompagnée , on
par les fuites qui en -ont réfulté, quelque chofe de
généralement mélnorable ; c'eíl: cette généralité qui fait
propreruent l'e!fence de
l'allégcrie.
11
y
a, danS' la ga.lerie de Ouffeldorf, un taDleau de
R aphael qui repréfente unjeun_e homme dans un boc–
cage épais , ams auµres d'une fource d'ou il a puifé
de l'eau dans une cóupe qu'il tit:nt élevant foi
a
la
main. Jufques-la ce tableau eíl: puren\ent hiftorique,
&
C'eft aum tQUt Ce qu'un peintre oriJinaÍre pourroit
expritu'er méme av-ec
le
eoloris du T itien. Mais Ra–
phael a
fu
do'nner a cene figure -unique des penfées
fi
haures , un recueillement
[¡
fub lime a la vue de cette
coupe d'eau, qu'on reeonnoit daos ce jeune homme
Jean Baptiíl:e occupé clans le défert
a
réfiéchir fur
fa
vocatioñ div ine ,
&
qo'on croit enfüite entendre fes
p rofondes méditations fur le bapteme. Voila ce qui
üent déja a la ha1,1te
altégorie.
Q uiconque ne fa it pein–
dre qlle des corps. ne duit pas l'entreprendre,
EU-t-i~
pour ci:laque idée par);ieuliere l'image la plus exaéte ,
il ne donnmiit Q\J'Un hiérnglyphe eieri lntelligible,
mais·
po~nt
une
allégorie:
<i::ellt:-ci 1úxprime pas la lec–
tre , ma1s l'éfpm de la: ehoíe.
· L e
pr~mier
foin de l'arri'íle (era done de áécouvrir
l'ame dans
le
inarériel d'un événement qu'il vem allé–
gorifet; & fon fecond foi n doit erre de la rendre
vi–
fible, Ainü
le
tabléau aHégoriq ue des eonquetes d'A–
lexandre ne repréfenteroit pas des expéditions mi litai–
rcs , ni des
baniHle~;
il exprimeroit ou l'e noble ddi r
de venger for un monaré¡ ue enivré de fa pui(fance ,
les injures d'un peuple li bre ; ou l'ambition effrénéc
&
fes funeftes fuites , dans un prince qui unir les plus
grands talens a un pouvóir a!fez coníid&ra,ble : ou en–
fi n quelqu'autre penle<; de cette nature qui nous pla–
~t
d'abord daos le point de vue convena ble. Quand
l'arciíle au ra trollllé l'e{prit' de fon hiíl:oire, il ne luí
fera pas difficile d'inventer les carafteres propres
a
mar–
q uer le fai t. II eft aifé
de
fai re conho1tre les temps ,
les lieux
&
les perfonn ages.
S'il c:ft vrai , corilme les anciens l'ont rapporté ,
qu' A riílides ai t pu daos une feule figure exprimer par–
fü itrn1ent le caraélére des Athéniens , caraél:ere
[¡
fin–
guliéremen t contrafté ; pourq uoi ne pourrions-nous
pas attendre de l'art
perfeél:ionn~,
des tableaux vrai–
ment allégm iques? Tels feroient par exemplc , l'in–
fluence d u rérabli!fement des Sciences fllr les íJlreurs;
la ,décou.verte .de l'Amérique figurée par quelques-uns
de plus 1mportans elfets q u'elle a produi ts, &c.
A pres avoir vu la narnre de
l'allégwie ,
fes cliverfes
efpeces
&
fon p ri x , il nous reíle
a
fai n: quelques re–
marq ues fur Ion invéntion
&
fe s ufages.
L a perftél:ion de
l'allégorie
dépend en g rande partie
de l'heureufe invemion des images particulieres. U ne
colleél::on des meilléures images allégoriques aftnelle–
ment inventées , feroit d'1m grand fecou rs aux
arciíle~,
f¡
elle éroit accompag'née d' une critiq ue fai ne
&
judi–
cieufe. W inckelman a commencé ce recueil , mais on
n'¡¡ point d'ouvrage encore qui développe des príncipes
lumineux fu r l' in vention de ces images. Nous allons
donner quelques obfervacions q ui pourront arder
a
cet–
te recherche,
















