
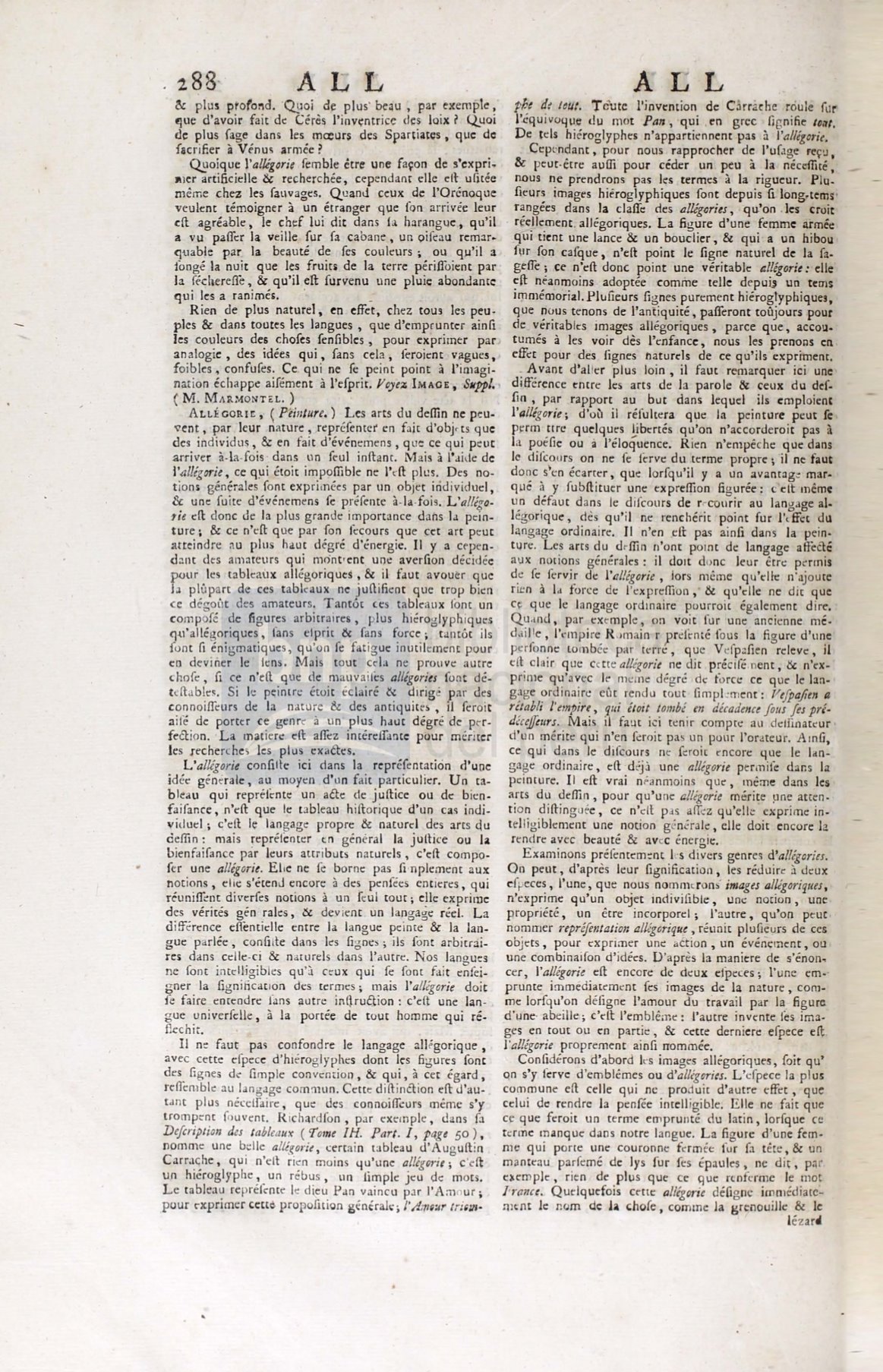
188·
ALL
&
plus ptofo"d.
·~oi
de plus· beau , par exemple,
fJUe d'avoir fait de Cérc!s l'invc:ntrice des loix ? Quoi
de
plus fage <lans les rnceur$ des Spartiates, que de
facrifier
a
V
énus armée?
~1oique
l'alligorie
femble ctre une
fa~on
de s'cxpri.
1'Jtr artificielle
&
recherchée, cependanr elle
eft
u(icée
meme
chez les fauvages. Quand ceux de l'Orénoque
veulent témoigner
a
un étranger que fon arrivée leur
c!l agréable, le
ch~f
luí dit dans
la
harango;¡e, qu'il
a
vu paffer la veille fur
fa
cabane, un oikau rernar–
quable par la beauté de
fes coukurs ; ou qu'il
a
fon gé la nuit que les fruir& de la rerre péri!foitnt par
Ja ffrl1ereíle,
&
qu'il e!l: furvenu une pluie abondancc:
qui les a ranimés.
·
_
Ríen de plus naturel, en
cffh,
chez tous les peu–
ples
&
da11s toutes les langues , que d'emprunter ainfi
les couleurs des chofes fenfiblcs , pour cxprimer par
an alogic , des idées qui, fans cela , íeroient vagues,
foib les, confufes. Ce qui ne fe peint point
a
l'imagi–
narion échappc aifément
a
l'efprir.
/loye;r.
lMAGE,
S11ppl•.
( M.
M ARMONTEL. )
ALLÉ G01t1~,
(
P'elnture.)
Les arts du deffin ne peu–
vent, par leur nature, repréfentct en fair d'obj<ts que:
des individus ,
&
en fait d'événemens, q rn: ce q ui peut
a.rriver 3-la-fo is· dans un frul iníl:ant. Mais
a
l'aide de
l'alligorie,
ce qµi étoit impoffible ne l'dl pks. Des no–
t ion> générales font expri.nées par un objet iridivid ud,
&
une: íuire d'événemens fe préfente 3-la-fois.
L'a//(go·
1'ie
di:
done de la plus grande: importance dañs la ptin–
ture;
&
ce n'cíl: q ue par fon t<:cours que cer art pt ut
.aueind re
~u
plus haut dégré d'énergie.
11
y
a cepen–
<l~nt
des amateurs qui mont•enc une averfion décidée
pour les tabkaúx allégoriques,
&
il faut
avou~r
que
fa plupart de ces tablcaux ne juíl:ifient que trop bien
ce
dégoút des amateurs. Tantóc
ces
tableaux fo nc un
compofé de figures arbicrai res, plus hiérogly phiques
q~1'allégoriques,
fan s elprir
&
fans force;
tantót ils
fo nt
{i
énigmatiques, qu'on fe fati g ue
i nucilemc:n~
pour
eo deviñer le kns. Mais tout
cda
ne prouve autre
chofe ,
fi
ce n'dl que ele mai1vaifes
allégories
fo nt dé–
tdra bles. Si le peintre étoit éclairé
&
dirigé par des
connoiffeurs de la nature
&
des anciquice> , il íeroit
ai!e de pomr ce genrr
a
un plus hdut dégré de per–
feél:ion. ·La macien: dl affez inrérdfamc: puur mériter
les ¡echerches les plus ex aél:es.
L'allégorie
confilte ici dans la
repréíentación d'uoe
idée générale, au muyen d'un fa it parciculia. Un ta–
bleau qui repréfrnte un aél:e de jurtice ou de bien–
fai fance, n'eíl: que le tableau hiíl:orique d'un cas indi–
vidue[; c'dl le langage propre
&
naturcl des arts cju
deffin:
rnais
reprélcnter
rn
géneral la jufüce ou la
bien fai fance pár leurs atcributs naturcls , c'dl compo–
íer une
allégorie.
El1e ne fe borne pas fi·nplemenc aux
notions, el le s'écenJ encere
a
des penfées entieres , qui
réuniífent di\•erfrs notions
il
un íeul tour; elle exp rime
des vérités gén rales ,
&
dcv;ent un langage réel. La
différence eílentidle entre la langue peinte
&
la lan–
g ue parlée, con !ilte daos
ks
fi;,;nes ; ils font arbicrai–
res dans cd k -ci
&
narurels dans l'autre. Nos langues
ne íont in tc:lligi bles qu'a cru" q ui
fe fo nt fait eníei–
gner la fignifi car1on des cermes ; mais
l'a/f¿gorie
doit
fo
fai re encendre fan s autrc in
O
ruél:ion : c'dt une lan–
g ue un iverfdle '
a
la portée de tout homme qui ré–
flechi t.
11
ne faut pas confondre le
langage allégorique,
avec cette efpece d'h1éroglyphes done les fig ures íonc
des lignes
d~
limpie convcnrio1 ,
&
qui,
a
cec égard ,
rdfemb lc au langage commun . Cecee dift inc1ion eíl: <l'au–
tdn t plus nécclfai re , que <les connoiffeurs rnerne
s'y
trompent fo uvent. R ichardfon, par exemple , <lans
fa
Defcrip1ion des tablea11x ( Tome l
H.
Par
f .
I, pqge
50 ) ,
nommc une bd le
alligorfr ,
certai n 1ablea u
<l'
Auguíl:!n
Carrache , qu t n'ell ricn moins 4u'une
allégorie;
c'eft
un hiéroglyphe , un rébus , un
limpk jeu
de
mocs.
Le tableau repréfrnte
le
d~e u
P4n vaincu par l'Amour ;
pour c-xprimer
cctr<)
propofition générak;
l'dm~ur
tri,111-
ALL
pP~ d~
totlt.
Tcutc l'invention de Carril.c he róule fur
l'.i!qu ivo4ue clu mot
Pan,
qui en grcc
fi gnifie
IDilf.
De fels hiéroglyphes n'appartiennent pas
a
l'allégorie.
Ceprndant, pour nous rapprocher de l'ufage re1=u,
&
peut-erre auffi pour céder un peu
a
la néceflicé'
nous ne prendrons pas les termes
a
la rigueur. Plu.
fieurs imagcs hiéroglyphiques íont depuis
li
long.tcms ·
rangées dans
la
clalfc: des
allégories,
qu'on
.)es
croit
riellcrnent. allégoriques. La figure d'une femme arméc:
qui tient une lance
&
un bouclier,
&
qui a un hibou
f11r fon cafque, n'e(l point
le
figne naturel de la
fa.
geffe ;
ce
n'c:íl: done point une véritablc
allégorie:
elle
~ll:
neanmoins adoptée comme
telle depuiJ un tcms
H)1mémorial. Pluíieurs fignes purement hiéroglyphiques,
que nous tenons de l'antiquité, pafferont tofljours pour
de vérirablcs images allégoriques, parce que, accou–
tumés
a
les voir des l'enfancc, nous les prenons c:n
dfet pour des lignes naturcls de ce qu'ils cxprimenc.
- Avant d'al ler 'plus loin, il faut remarquer ici une:
différence cncre les ares de
Ja
parole
&
CCllX
du deí–
fin , par rapport au but dans Jeque!
ils cmploient
l'ailigorie;
d'ou ii réfultera q\]e
la peincure peut fe
p~rm
ttrc:
quelqucs libertés qu'on n'accorderoic pas
a
la poélie ou
a
l'éloquence. Rien n'empéche que dans
le difcours on ne fe frrve du terme proprc; il ne faut
done s'c::n écarcer, que loríqu'il y a un avantag: mar–
q pé
a
y
fubíl:itucr une txpreffion figuréc:
e
di:
memc
un défaut dans le difcoms de r.-courir au langage al–
légorique, des qu'il ne rencbérit point fur l'dfh du
1<1ngage ordinaire.
Jl
n'eo eíl: pas ainfi dans
la pein.
ture. Les ares du ddiin n'ont po1nt de langage affeété
au x nocions généralcs: il do1t done
leur erre perrnis
d.e
fe
fervir de
l'ol!igorie
'
iors meme qu'tlle n·ajou te
rn:n
a
1.
force de l'expreffi'on'
&
qu'clle ne dit que
e~
que le langage ord1naire pourroic également dire.
Qu and, par excmple , on voit fur ·une ancienne mé–
d.iille , l'cmpire R.imain r ,Prefrn;é fous la figure d'unc
perfonne tombée par cnre, que Vd pzfien releve,
il
d l_clai r q ue cecee
allégorie
ne di t préc1 fé.nent,
&
n'ex–
pnme qu'avec le me
ne
dégré de fo rce ce q ue le lan–
gage ordinain: eut rendo tout limpbnent:
Vefpajien
a
ritabli
l'
empire, qui étoit tombé
m
décadence faus fes pri·
d(cejfa11rs.
Mais il faut i.::i tenir compre au ddfinateur
d'un mérite qui n'en feroit pa · un puur l'orateur. A tn!i,
ce qu i dans
le
difcours
ne
fcroit m eare 4ue le lan–
gage ord inaire, eíl: -d¿j :i une
allégorie
perm ife dans la
pc:i nture.
11
eft vrai
n~a n moi ns
q ue' meme dans
ks
arts du deffin, pour qu'u nc
alligorie
rnérite µn e atcen–
tion diíl:ing uée , ce n'dt pas affez qu'el k exprime in–
teliigiblernent une notion génfrak, elle doit encere la
rendre
avec
beauté
&
avrc énergie.
Examinons
prélenccrn~nt
L·s
divers genres
d'a/légories.
On
peut, d'apres leur fign ificac ion, les ré<luire
a
deux
efpc:ces, l'une, que nous nommcrons'
images alllgoriq11es,
n'exprime qu'un objet tndivilible, une nocion, une
propriété ' un etre
incorporel ;
l'autre' qu'on peut
nommcr
repréfentation allégorique,
réu ni t plulieurs de ce&
objc:rs , pour cxpri mer une aétion , un événement, ou
une cornbinai íon d'idécs. D'aprtls la maniere de s'énon.
cer,
l'allégorie
eíl: encore de deux efpeces ; !' une em–
prunce imrnediaremcnt fes
images de la naturc , com–
me loríq u'on déligne l'amour du travai l par la fi gure
d \ rne· abeille ; c'dl: l'emblcme : l'autre invente tes ima–
ges en
couc
ou en partie ,
&
cetce dernier<! efpece eft
l'al/igorie
prop remenc ai nfi nommée.
Confidfro ns d'abord
les
images allrgoriq ues , foit qu'
on s'y fi:rve d'emblémes ou
d'al!t'gorfrs.
L 'efpece la pl us
cornmune ell celle qui ne produir d'aurre d fe t, que
cd ui
do
rendre la pentee incell igible. E lle ne fair que
e~
que frroit un terme e1npru 11 té clu larin, lorfque
ce
tcrme manque dans notre langue. L a figure d'u ne frm·
me
q ui pone une couronne fermée fu r
fa
teet: ,
&
un
manteau parfemé de lys for fes épaules , ne die , pllí
ncmple , rien de plus que ce que rrnfermc
le mot
l ·rai1a.
Q utlqucfois cene
alléggrie
défigne irnmédiace–
mcnt le
nom
de la
chofe , comme la grencuille
&
le
lézm l
















