
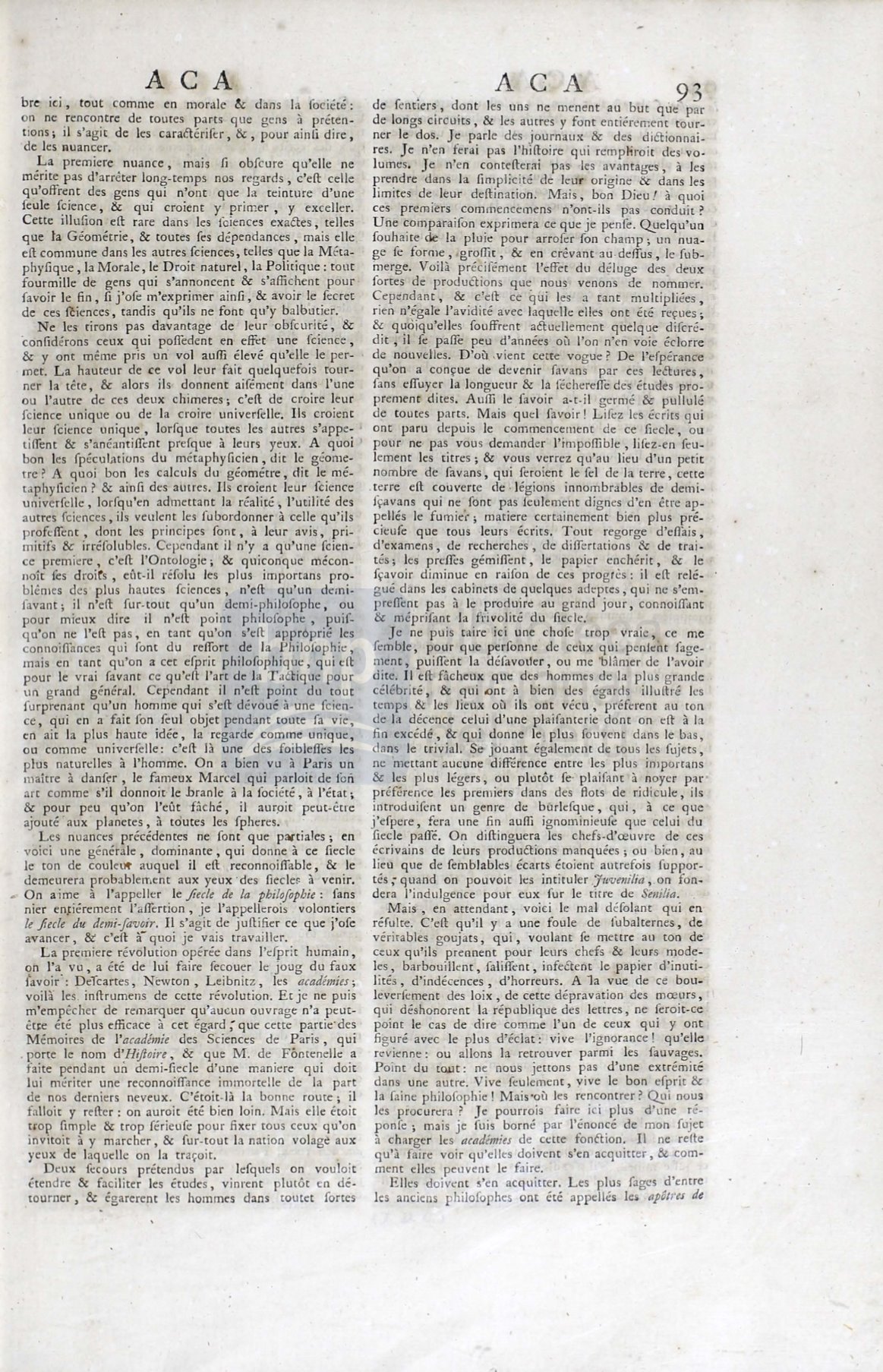
ACA
bre ici , tout comme en morale
&
dans la fociété :
o_n ne _renconcre de tomes parts q lle gens
a
préten–
t10ns ; 11 s'ag1t de les caraétérifer ,
& ,
pour ain li dire,
de les nuancer.
La premiere nuance, mais fi obfcure qu'elle ne
mérite pas d'arreter long-temps nos regards, c'eft celle
qu'olfrent des gens qui n'ont que la teinture d'une
feule
f~ience,
&
qui croicnt
y
primer ,
y
exceller.
Cette 11Jufion
eíl:
rare dans les foiences exaétes, telks
que la Géométrie,
&
toutes fes dépendances , mais elle
eft commune dans les autres fciences, telles que la M éta–
phyfique , la Mora
le ,
le D roit naturel, la Politiq lle: tollt
fo urmille de gens qui s'an·noncent
&
s'affichent pour
favoi r le fin, fi j'ofe m'exprimer ain fi,
&
avoi r le fecret
de ces íCienccs, candis qu'ils ne
fon~
qu'y balbutier.
Ne les ri rons pas davanrage de Jeur obícurité,
&
·confidérons ceux qui poífedent en effet une fcience ,
&
y ont méme pris un
vol
auffi élevé qll'elle le per–
met. La hauteur de ce
vol
leur fait quelquefois rour–
ner la tete,
&
alors iJs, donnent aifément dans l'une
ou l'autre de ces deux chimeres; c'eíl: de croíre leur
fcíence uniq ue ou de la croire uníverfelle. lis croien t
leur fcience unique, lorfq ue toutes les autres s'appe- '
t iffent
&
s'anéantiífent prefque
a
leu rs yeux. A quoi
bon les ípécul.ations du métaphyficien, dit le géome–
rre? A quoi bon les calculs du géométre, dit
le
mé–
taphyfiden?
&
ainíi des alllres. lis croient leur fc ience
univerfelle, lorfqu'en admettant la réalité , l'utilité des
autres fciences, ils veulent les fubordonner a celle qu'ils
p rofrffen t ' dont les principes fo nt' a leur av is , pri–
m itifs
&
irrffolubles. Cep.endant iJ n'y a qLJ'u ne fcien-·
ce premiere , c'efl: l'Ontologie;
&
quiconq ue mécon–
noit fes droirs, eut-il réfolu les plus irnporrans pro–
blemes des plus haLJtes fciences, n'eíl: qu'un dem i–
favant; il n'eíl: fur-tout qu'un _demi-philofophe, ou
poa r rnieux dire il n'dl: point philofophe , puif–
q a'on ne l'eíl: pas , en tant q u'on s'eíl: app róprié les
connoiífances qui font du reífort de la Ph ilofophie,
mais en tant qu'on a cet efpri t philofophic;¡ue, qui eíl:
pour le
vrai
fava nt ce qu'eíl: l'a rc de la Taél:ique pou r
u n grand général. Cependant il n'eft poinc du tout
furprenan t qu'un homme qlli s'eíl: dévoLJé
a
une fcien–
ce, qui en a fait fon fe ul objet pendanr toute
fa
vie,
en ait la pllls haute idée, la regarde comme un ique,
ocr comme univcrfelle: c'eíl:
la
une des foibloffes les
plus natu relles
a
l'homme. On a bien vu
a
P aris un
maitre
a
danf\:r, le fameux M arce! qui parloit de
fo ñ
art comme s'il donnoir· le bran le
a
la foci écé,
a
l'état;
&
pour peu qu'on l'eut fac hé, il aurpit peut-fare
ajoucé ·aux planetes,
a
tdutes ]es fpheres.
·
L es nuanct:s précédentes ne font que
p~tiales ;
en
· voici une générale , dom inante , qui don ne a ce fiecle
Je ron de cou
leu~·
auq uel
il
eíl: reconn oiffable,
&
le
demeurera probablement aux yeux ·des fiecler-
a
venir.
• On a ime
a
l'appeller
le
jiecle de la philofophie :
fans
nier
eniiéreme.ntl'affertion , je l'appelkrois volontiers
le jiecle du demi-favoir .
11 s'ag it de jufl:ifier
ce
que j'ofe
avancer'
&
c'eíl:
a
quoi je vais rravai lkr.
La premiere révolurion opérée dans l'efpric bumain,
on l'a vu , a été de lui fa ire fecouer le j oug du faux
lavoir· : DeTcarces , Newton, Leibn itz , les
académies ;
voila· les. iníl:rumens de cette révolu tion . Et j e ne puis
rn'empec her de remarquer qu'aucun ou vrage n'a peut–
et~e
été plus efficace
a
cet égard ; que cette partie·des
M émoires de
l'académie
des Sciences de Paris , qui
. porte le nom
d'Hijloire ,
&
que M . de F óntenelk a
fai te pend ant un demi-fiecle d'une maniere qui doit
Jui mériter une reconnoiffance immortelle de la part
de nos derniers neveux. C'étoit-la la bonne rouce ; il
falloit y reíl:er : on auroit été bien loin. M ais elle étoit
trop fimple
&
crop férieufe pour fi xer tous ceux qu'on
invitoic
a
y marcher,
&
fur-tollt la nation volage aux
yeux de laq udle on la trai;oi c.
D eux fecours prétendus par lefquels on vouloit
étendrt:
&
faciliter les études , v inrent plutót en dé–
courner,
&
égarerent les hommes dans routet forces
ACA
d
{i •
d
1
•
93
e
ent1er~,
_on t es uns ne menent au but qúe par
de longs c1rcu1ts,
&
les aucres
y
font en tiérement tour–
ner le dos. Je parle des journaux
&
des diétlonnai–
res. Je fl'eA fera i pas l'hiíl:oi re qLJi remp liroit des vo–
lurnes. J e n'en con teíl:enri pas les avantages,
a
les
prendre dans la fi mplic ité de leu r oria ine
&
daos les
limites de__leu r deíl:ination. Mais ,
bo~
Dieu
!
a quoi
ces prem1ers commencemens n'ont-ils pas conduit?
Une compara ifon exprirnera ce que je peníe. Q_uelqu'un
fou hai ce de !a pluie pour arrofer fon cb amp; un nua–
ge fe forme , groffit '
&
en crevan t au-deffus , le fob–
rnerge. Voila préc ifémcnt l'cffet du déluge des deux
fortes de produét ions que nous venons de nommer.
Cepend ant ,
&
c'eíl: ce q ui les a rant mu ltip liées ,
rien n'.égale l'avidiré avec laquelle elles ont été
re~l1es ;
&
qt.1oiqu'elles fouffrent aétuel lement q uelque difcré–
d1t ,
JI
fe
paffe peu d'aónées
oi\
l'on n'rn voie éclorre
de nou velles. D 'ou.,vient cette vog ue? De l'efpérance
qu'on a con\:Oe <le devenir favans par ces Jeéhires ,
fans effuyer la .long ueur
&
la féchereífe des études pro–
prement di tes. Aulli
le .
favoi r a-t- il germé
&
pullulé
de touces parts. Mais que! favo ir
!
Li fc:z les écrits qui
ont paru depuis le commencement de ce íiecle, ou
pour ne· pas vou s demaoder l'impoffible , lifez-en feu–
lement les titres ;
&
vous verrez q u'a u lieu d'un peti r
nombre de fav ans , qui feroient le fel de la terre, cetre
.terre eíl: couverte de -légions innombrables de demi–
f~avans
qui ne fo>nt pas feulement dignes d 'en étre ap–
pellés le fumiú; matiere certainement bien plus pré–
cieu fe que tous leurs écrics. Tout regorge d'effais ,
d'examens, de recherches, de differcacions
&
de trai –
tés; les prcífes gémiífent , le papier enchérit,
&
le
fpvoir diminue en raifon de ces progres : il eíl: relé–
g ué daos les
cabin~ts
de quelques adeptes , qui ne s'em–
prelfenr pas
a
le produi re au grand jour, connoiffanr
&
méprifant la frivolité du fiecle.
Je ne pu is ta,ire ici une chofe trop vraie , ce me
femble , pour que perfonnc:· de cebx qui penkn t fage–
ment , puiffent la défavotler, ou me "b!amer de l'avoir
dice.
11
eíl: facheux que des hommes <le la plus grande .
célébrité '
&
qui .ont a bien des égards illuíl:ré les
remps
&
les Jie\!lx
oi\
ils oot vécu, préfrrent au ton
de la décence celui d'une plaifanterie dont on
e{l:
a la
fi n excédé ,
&
qui donne le . plus fouvent dans le bas ,
dans le trivi al. Se jou:mt égalemen t de rous h!s fujets ,
ne mettant aucune d ilférence entre les plus importans
&
lt:s plus Jégers,
OU
plUtÓt fe-· plaifant a noyer par •
p référence les p rem iers dans des flots de ridicule, ils
. introduifent un genre de b ürlefque ' qtii'
a
ce que
j'efpere , fera une fin auffi ignominieufe que celui du
.fiecle pairé. On diíl:inguera les chefs-d'reuvre de ces
é~rivains
de leurs prod uétions manquées ; ou bien , .au
Jieu que de femblables écarts étoient autrefois fuppor–
tés; quand on pouvoit les intitu ler
.']t111Jeni/ia
, .on fon.
dera l'indulgence pour eux fur Je titre de
Sé11i!ia.
Mais , en actendanc , voici le mal défolanc qui en
réfulte. C'eíl: qu'il y a une fou le de fubalcernes , de
vérirables gouj ats, qui , vm1lant fe mettre au ton de
ceux qu'ils prennent pour leurs chefs
&
leurs mode–
les, barbouillent, falilfen t, infeEtent Je papier d'inuti–
lités , d'indécences , d'horreurs. A la vue de ce bou–
leverfemenc des loix, de cette dépravation des marnrs ,
qlii
dé~honorent
la république des lettres , ne feroi c-ce
peine le cas de dire comme l' un de ceux qui y ont
fi guré avec Je plus d
1
éclat:
vive
l'ignorance
!
qu'elle
rctv ienne : ou allons la retrouver parmi
les
fauvages.
P oi nt <lu
ro.ut: ne nous jettons pas d'une excrémité
dans une autre. Vive feulement, yive le bon eípric
&
la faine philofophie ! M ai s·ou les rencontrer ? Q.9i nous
les procurera ? Je pourrois faire ici pl us d'une ré–
p onfe ; mais je fui s borné par l'énoncé de mon fujet
a
charger les
académies
de cetce fonél:ion. 11 ne reíte
q u'a fai re voir q u'elles doi vent s'en acquircer ,
&
com–
ment elles peuvent
le
faire.
Elles doivent s'en acq uitter. L es plus fages d'entre
les anciens philofophes ont été appellés les
ap&tres de
















