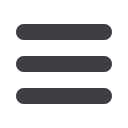
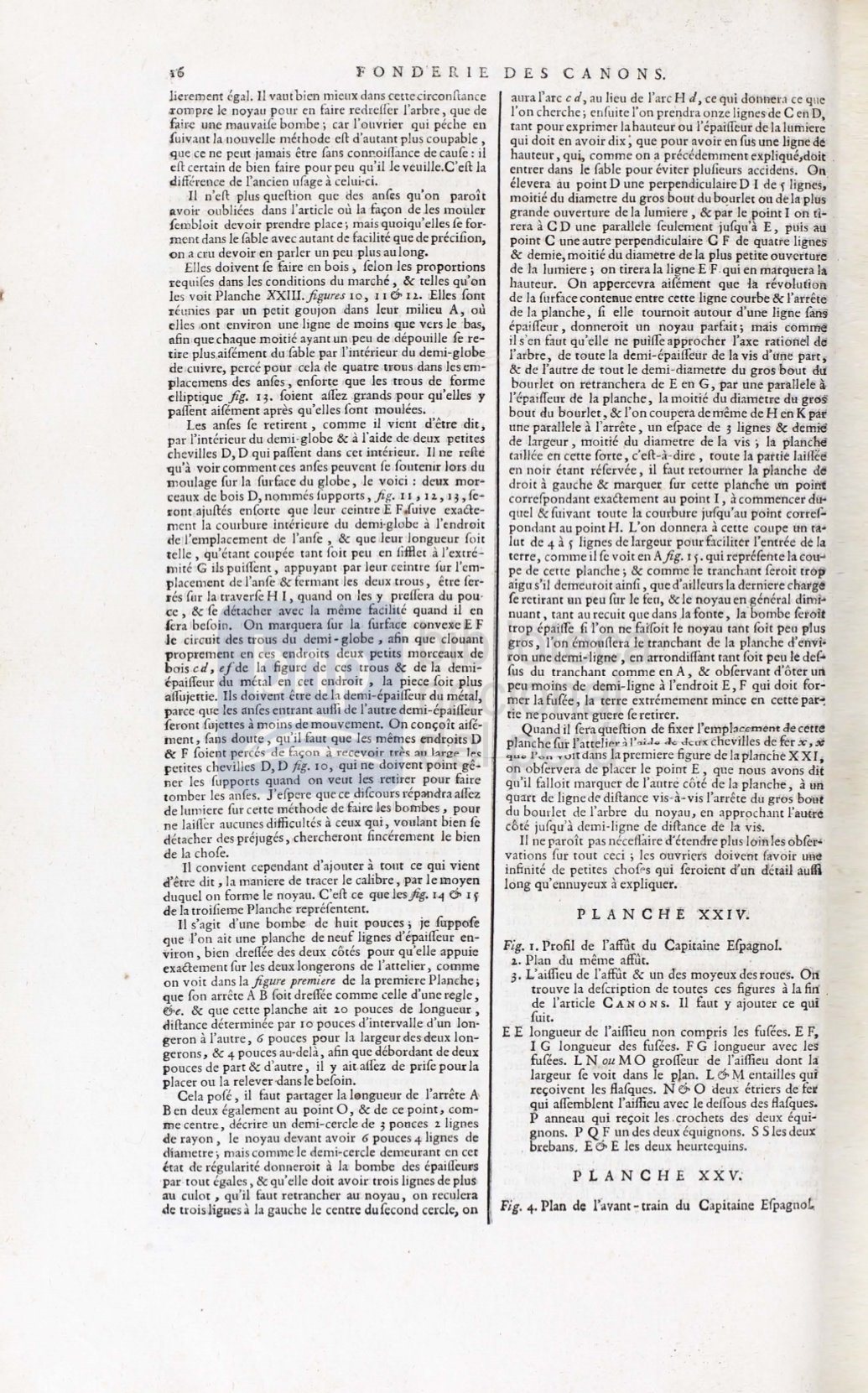
f '
ú
N D ' E R l E D E
S
C
A
N O N S.
Jierernem égal . JI vaut b ien mieux dans cettecirconíl:ance
.rompre le noyau pom en faire redreífor J'arbre, que de
faii'C une mauvaife bombe; car l'ouvrier qui pécbe en
f uivant la nouvelle méibode eíl: d'autant plus coupable,
q ue ce ne peut jamais ctre fans connoiffance de cau(e : il
eíl: cercain de bien faire pour peu qu'il Je veuille.C'eíl: Ja
c:lifférence de l'ancieo ufage
a
celui·ci.
.¡¡
n'eíl: plus queíl:ion que des
aoí~s
qu'on paro!t
o.voi·r oubliées dans l'article ou la
fa~oo
de.les mouler
{embloit dcvoir prendre place; mais quoiqu'elles fe for–
ment dans le Cable avec autant de facilité que de précifion,
<Jn a cuu devoir en parler un peu ph1s au long.
Elles doivent fe faire en bois; felon les proportions
~equiíes
dans les conditions du marché,
&
telles qu:on
]es voit Planche
XXIII.figures
10,
11
&
12.
'Elles font
r éunies par un
pe~it
goujon dans leur milieu
A,
ou
elles •Ont environ une ligne de moins que vers le has,
afin quechaque moitié ayant un .peu de dépouille
fe
re–
ti<e plus,aiíément du Cable par !'iiuérieur du demi-globe
de cuivre, percé pour cela de quatrc nous dans les em–
placemens des anfes , enforte que les trous de forme
elliptique
fig.
13.
foient affez grands pour qu'elles
y
paffent ai(ément apres qu'elles font moulées. "
.
aura !'are
e
d,
au lieu de !'are
H
d,
ce qui donnera ce
que
J'
on cherche; enÍllite
l'
on prendra onze ligneS'a e C en
D,
rant polir exprimer la hauteur ou
!'
épalffcur
de
la lumiere
qui doit en avoir dix; que pour avoir en
(us
une ligne
dé'
hauceur, qui, comme on a précédemment expliqué,dbit
entrer dans le Cable pour éviter plufieurs accidens.
On.
élevera :ill point
D
une perpendiculaire
D 1
de
í
lignes,
moicié du diametre du gros bouc du bourlet ou dé la-plus
grande ouverture de la lumiere , &t>ár le poim
1
on
el•
rern a CD une parallele íeulement jufqu'ii E, pliis au
point C une autre perpendiculaire
G F
de quatre lignes
&
demie, moitié du diametre de la plus petite ouvcrture
de la lumiere ; on tirerala ligneE
1
F.quienmatquera la
haureur. On appercevra ai(ément q>te
la
révolution
de la forface contenue entre cetre ligne courbe
&
l'arrere
de la planche, fi elle 10urnoit autour d'une ligne far'l§
épai ffeur, donneroir un noyau parfair; mais comme
il s'en fallt qu'elle ne pullfe approcher l'axe rariortel de
J'arbre, de touce la demi-épaiffellr de la vis d'!tne pan,
&
de l'amre de
tOut
le demi-diametre du gros beut di!
bo urlcr on retranchera de E en
G,
par une parallele
i\.
l'
épaiffeur de la planche, la moitié dll diametre du gró§
bom du bourler ,
&
l'on couperadenreme de
H
en
K
pái!
une parallele
a
l'arrete' un e(pace de
3
lignes
&
demié'
de largc;ur, moirié ,du diametre de la vis ; lá planc'l1é
raiJ.lée en cette forre, e'eíl:
-a-dire , route la patrié lailfée
en noir étant réíervée, il fat.it rerounier la p>lanche
d~
droit
a
gauche
&
marquer fur cette planche u'n p'oi!if
corrc(pondant exall:ement au point
I,
a
corumencer dú•
que!
&
Cuivant toute la coarbure ju{qu'au p>olnt
carre(~
pondant au point
H.
L'on donne,ra
a
cene coupe un ra•
lut de
4
a
í
lignes de largeur pourfacilit,cr l'entrée de la
rerre, comme il
fe
voit en
Afig.
1
f.
qui repréfente
laeou~
pe de ce11e planéhe;
&
commde tranchant feroit tréjJ
aigll s'il lfcnreutoit ain'Ít, que d'a>llenrs la derniere charge
fe retirant un peu Car le fen,
&
le noyau en:général díml•
nuant, tant au recuit que daos Jafonte, Ja bombe ferol!
trop épallfe
¡¡
r
<In
ne
fa~(ort
le tloj'au tan¡ folt peu p'lus
gro's ,
l'on
érrrauflera le tranchant lle la planche d'e:ñvl•
ron une demi-ligne, en arrondiffall'I rant foit peu
le
de(•
fus du tranchant comme en
A,
&
obfervant d'oter un
peu moil1s de demi-ligne
a
l'endroit
E,
F
qui doic for"
mer la fufée, la rerre extrémement mince en cette pa·r"'.
tie ne pouvant guere fe retirer.
Les aníes fe retirent , con¡me
il
v1ent d etre d1t,
par l'intérieurdu demi: gl obe
&
a
J'ai~e .de
deux pe1i1es
chevilles
D, D
qui paffenr dans cet 1meneur.
II
ne rdl:e
<¡u'a voircommentces anfes peuvcnt fe foutenir lots du
n1oulage fur la forface du globe, ,Je v01C1 : deux mor•
ceaux de bois
D,
nommés fopp on s ,
fig.
11 , 1 2,
1
3, fe–
ront ajuíl:és en(one que leur ceintre•E F.(uive exaéle–
rnent la courbure inrérieure du demi·globe a
1'
rndrnit
tle
J:empl~cement
de l'anfe ,
&
que leur longueur foit
telle , qu'étant coupée tant foit peu en fiffiet a l'ei;cré–
rnité
G
ils puiffent, appuyant par leur ocmtre
(~ir
1
cm–
placen1eot de l'an(e
&
fermant les deux trous,
et
re
fer–
rés
li1r
la traver(e
H 1,
quand on les y preffera du pou·
ce ,
&
fe
détacher avec la meme facilité quand il en
fera befo in. On maFqucra für la furface convex·e
E
'F
.Je cirauit des rrous du dmni - globe ,
:rfin
que clouant
t>roprement en ces endroits deux petits morceaux de
b ois
cd, efde
la
figure de ces trous
&
de
la
dmii–
lépaiffeur du métal en cet endrnit , Ja p·iece foic plus
a!ffu¡ertie. lis
doiv~nt
ctre de la derni-épaiffeur du métal,
pa•ce que les an(es entraot auffi de l'auuedemi-épaiffeur
'
fern1H fojctres a moins de mouvement. On
COll~o1t
aifé–
n1e111, f.ins dome, qu'il fam que les memes endr9its
D
&
f
foient percés de foc;on
a
rec~voir t~~s
:\11
b~e('>
'~-~
r ecites chevilles
D, D
fig.
10,
qut ne do'.vent pomt ge–
ner les fupports quand on vetrt les reurer pour fa1re
10mber les an(es.
]'
e(pere que ce di(cour.s répandra affez
1
de lumiere fi1r cette méthode de faite les bo1nbes, poor
ne laifler aucunes difficulcés
a
ceux qoi, v011lant bien
fe
détacher eles préjugés , chercheront fincérement le bien
de la chofe.
Quand il fera qaeftion de fixer l'emplo.cement
de
cene
planche fifr l'artelie··-•
r~;.1. J~dcú'JC'éhev1'Jles
de fer
x ,x
"fUO
l'~n ~<J)fdans
la
premiere figure de la planche
x xr'
, on obíervera de placer le p'oim
E,
que n.ous avons di!
qo'il falloit marquer de J'atme coté de
la
planche,
a
un
qoa:n de lignede diíl:ance vis-a- vis l'arrete du gros
bout
du bourlet de l'arbre du noyau, en appr9ch3nt l'auwé
c6 cé ju(qu'a dcmi-ligne de difiance de la vis.
Il
convient cependant d'ajouter
a
ront ce qui vient
d'e~re
dit, la maniere de tracer le calibre, ,p·ar le moyen
duque! on forme le noyau. C'eíl: ce
qtre
Ies jig.
1.4
&
r
·5'
ile
la
troiíieme Planche r.epré(ement.
Jl
s'agir d'une bombe de huit .p0uces.
¡
je Ít1pp0fe
que
,J'
on ait une
~!.anche
de
ne,~1~
ltgnes d
e~a1lfeur
en–
viran bien dreffee des dellXCotes polir qu elle appme
exall:;ment for les deux longerons de
l'
attelier, comme
on voic dans la
figure premiere
de la premiere Plap€he;
qlle Con arrcte
AB
Coit drelfée comme celle d'une regle ,
& <.
&
que cette planche ait
1 0
pouces de Jonguellr.,
diíl:ance déterminée par
1
o pouces d'intervalle d'un lon–
geron
a
l'autre ,
6
pouces pour
la
largeurdes deux lon–
gerons,
&
4
pouces au-dela , afin que débordant de deux
pouces de parr
&
d'autre, il y aic affez de prife pour la
placer ou la relevcr ·dans le befoin.
Cela pofé , il faut partager la l@ngueur de l'arrete
A•
B en deux également au point O,
&
de ce point, oom–
me centre, décrire un demi-cercle de
3
ponces
1
!tgne.s
d·e rayon , le noyall devant avoir
6
pouces
4
lignes de
dlamecre ; maiscomme
le
<lemi-cercle demeurant en cer
état de réglllarité dotmeroit a la bomhe des épaiffeurs
par·tout égales, & qu'elle doit avoir trois lignes de plus
au culot , qu'iJ. faut retrancher au noyau, on reculera
de rroislignesa la gauche
le
centre dufecond cercle, on
11
ne paro1t pas nécefláire dºétendre plus ló'in les obfeF•'
vations for tout ceci ; les onvriers doivem (avoir u'né
infinité de petites chafes
'!Ui
feroienc d' un détail au!fi
long qu'ennuyeux
a
expliquer.
p
L A N
e
H
t
x·x
l
v.
Fig.
r.
Profil de l'affCtt du Capitaine Efpagnol.
2 .
Plan du meme affut.
0 •
L'aiffieu de l'affut
&
un des moyeuxdes roues.
Olí
trouve la defcription de toutes ces figures a la fin .
de J'article CAN
O
NS.
Il
faut y ajouter ce qtli
fui
t.
E
E:
longueur de J'aiffieu non compris les fu(ées.
E F,
1 G
longueur des fufées. F
G
iongueur avec les
fu(ée~.
L N
ou
M
O groffeur de J'aiffieu dont Ja
largeur fe voit dans
le
p)an. L
&
M
entailles q_ul
re~oivem
les fla{ques.
N
&
O deux étriers de
fet
qui affemblent l'aiffieu avec le deffous des Rafques.
P
anneau qui
re~oit
les .crochefs des deux équi–
g.nons.
P
Q F un des deux équigooos.
S S
les deux
brebans,
E
Ó>
E
les deux heurtequins.
Pl'..ANCHE
XXV:
Fig.
4. Plan de l'avant
~
train du Capitaine Efpagnol..
















