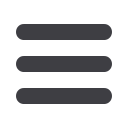
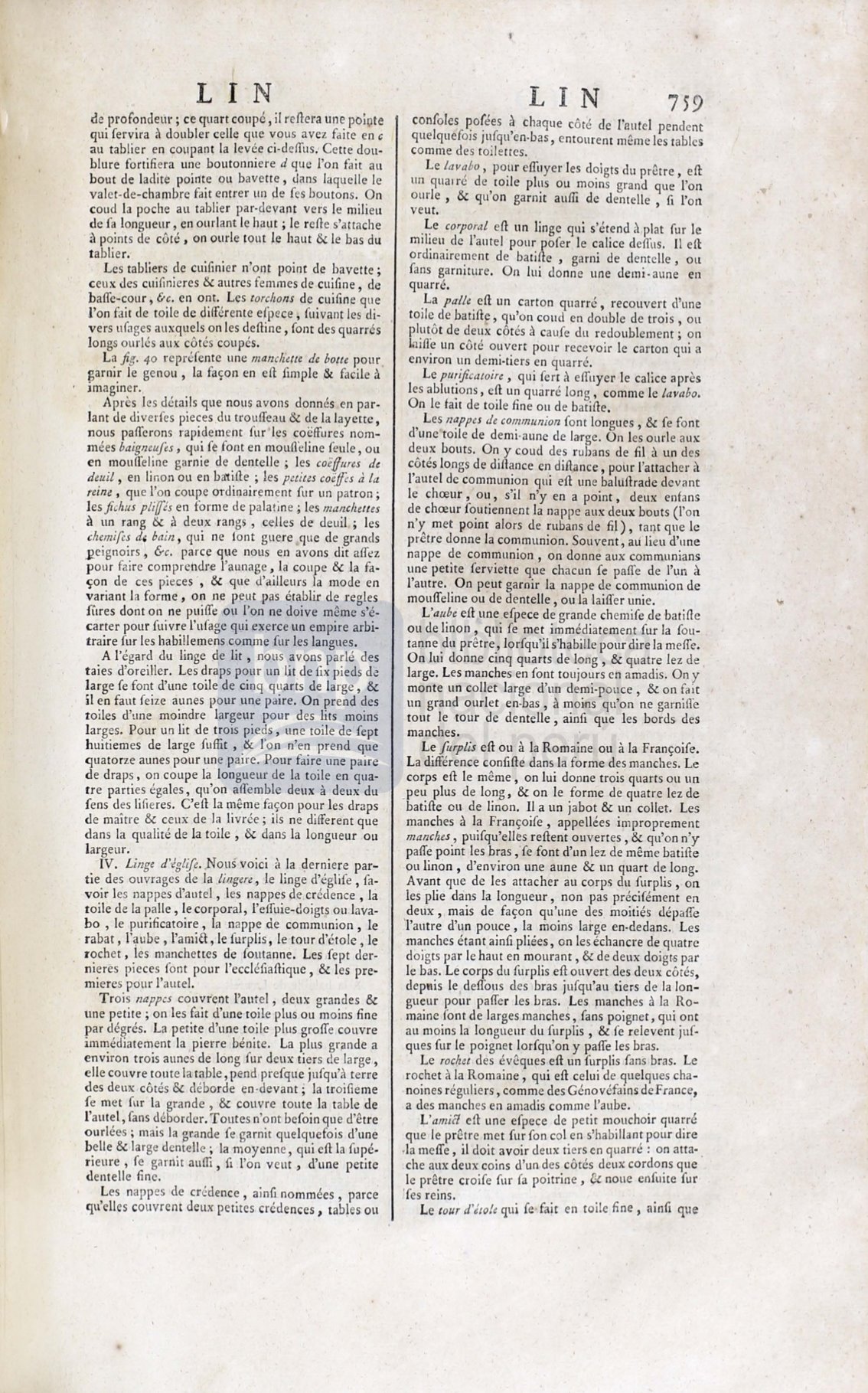
LIN
cle profondeur; ce quart coupe , il refiera une poiote
qui fervira
a
doubl er Celle que
VOllS
avez fa ite en
C
au tablier en coqpant la levee ci-defTus: Cett e dou–
blure fortifiera une boutonniere
d
que l'on fait au
bout de ladite poirlte ou bavette , <lans laquelle le
valet-de-chambre fait entrer un de fes boutons. On
coud la poche au tablier par-devant ve rs le milieu
de
fa
longueur, en ourlant le haut ; le rell:e s'anache
a
points de cote , on ourle tout le haut
&
le bas du
tablier.
Les tabliers de cuifi nier n'on t poin t de bavette;
ceux des cui finieres
&
autres femmes de cuifine, de
bal'fe-cour,
&c.
en ont. Les
core/ions
de cuifine qu e
l'on fait de toile de differente efpece , fu ivant Jes di–
vers ufages auxquels on !es dell:ine, font des qu arres
longs ourles aux cotes coupes.
La
fig.
40
reprefente une
nzancfze{ce de houe
pour
garnir le ge nou ' la fac;on en ell: fimple
&
facile
a
imaginer.
Apr' s !es de
tails que nous avons donnes en par–
lant de diverfes
pieces.dutro u!feaH
&
de la layette ,
nous palferons
rapidement fu r'les coeffures nom–
mees
haigneufes
1
qui fe font en moufieline fe ule,
OU
en mou!feline garnie de dentelle ; Jes
coiffures de
deuil ,
en li r. on
OU
en bati(l:e ; Jes
petiteS coif{es
a
la
reine
,
qu e l'on coupe ordinairement fur un patron;
Ies
ficlius pliffes
en fo rme de pala tine ; !es
mancfzettes
a
un rang
&
a
deux rangs '
ce) les
de deuil ; Jes
chenzifcs de bain ,
qu i ne font guere que de grands
,Rei gnoirs ,
&c.
parce que neus en avons <lit alfa
pour fa ire comprehdre l'auQage , la coupe
&
la
fa–
~on
de ces pieces ,
&
que d'ailleurs la mode en
variant la forme , on ne peut pas erablir de regles
ff1res dont on ne puilfe ou l'on ne doive meme s'e–
carter pour fui vre l'ufage qui exerce un empi re arbi–
traire fur les habi!Jemens comme fur !es langues.
A
l'egard du linge de lit , nous avons parle des
taies d'oreiller. Les draps pour un
I.it.defix piecls de
large fe font d'une toile de cinq q
uarts de large ,
&
J1
en fau t feize aunes pour une paire. On prend des
toiles d'une moindre largeur pour des lits moins
larges. Pour un lit de trois pieds, une toile de fe pt
huiti emes de large fu ffit ,
&
l'on n'en prend que
<jUatorze aunes pour une paire. Pour fa ire une pai re
de draps , on coupe la longueur de la toile en qua–
tre parties egales ' qu'on alfemble deux
a
deux du
fen s des li fi eres . C'ell: la meme fai;:on pour !es draps
de maitre
&
ceux de la livree ; ils ne diffe rent qu e
dans la qualite de la toile ,
&
dans la longu eur ou
largeur.
IV.
Linge d'-egtife.
Nous voici
a
la derniere par–
tie des ouvrages de la
li11gere,
le linge d'eglife ,
fa–
voir Jes nap pes d'autel' les nappes de credence , la
toile de la palle, le corporal, l'effuie-cloigts ou lava–
bo , le purificatoire , la nappe de communion , le
rabat ,
l'~u be ,
!'amilt , le furp lis, le tour d'eto le , le
rochet, les manchettes de foutanne. Les fep t der–
nieres pieces fon t pour l'ecclefia fii que ,
&
les pre–
mieres pour l'amel.
Trois
nappcs
couvrent l'autel , dcux grandes
&
une petite ; on les fait d'une toile plus ou moins fin e
par degres. La petite d'une toile plus grol'fe couvre
immediatement la pierre benite. La plus gr;mde a
environ trois aunes de long fur deux tiers de la rge,,
elle couvre toute la table , pend prefque jufq u'a
ter~e
cles deu;x cotes
&
deborde en·devant ; la troifie me
fe met fur la grande ,
&
couvre toute la table de
l'autel , fans deborder. Toutes n'ont befoin qu e d'etre
ourlees ; mais la i rande
fe
garnit que lquefo is d'une
belle
&
large dentelle ; la moyenne, qui efl: la fu pe–
rieure ,
Ce
ga rnit auili , fi l'on veut , d'une petite
clentelle fin e.
Les nappes de credence , ainG. nommees , parce
qu'elles COUVrent deux petites credences
1
tables OU
LI N
75 9
confoles
~o(ees ~
chaque cote de l'autel pendent
quelquefo1s 1ufqu en-bas ' entourent meme !es tables
comme des toilettes.
Le
lav~ho ,
po.urelfuy
er !es doigts du pretre , efl:
un qua1 re de
,toile pit.isou mains grand que l'on
ourle ,
&
qu on g
arn1t auffi de dentelle , fi l'on
veut.
.~e
corpo;at
ell: un linge qui s'etend
a,
plat fu r le
m1l~eu .
de l aute l pou r pofer le calice delfus. II efl:
ordma1rement de batill:e , garni de dentelle , ou
fans garniture. On lui donn e une demi- aune en
quarre.
.La
palle .
ell: un carton quarre , recouvert d\me
toile de bat1fr
, qu'on coud en double de troi s , ou
plutot de deux cotes
a
caufe du redoublement ; on
Jail!~
Lill
core
o~v.ert
pou r recevoi r le carton qui a
environ un dem1-t1ers en quarre.
Le
purificatoire ,
qui
fen
a
elfuyer le calice apres
les ablutions , efl: un quarre long , comme le
lavabo.
On le fait de toile fin e ou de batill:e.
Les
11appes de communion
font longues ,
&
fe fo nt
d'une toile de demi-aune de large. On les ourle aux
deux bouts. On y coud des ruhans de fil
a
un des
cotes longs de difiance en dillance' pour !'attacher
a
l'autel de communion qui efi une balull:rade clevant
le chreur , ou, s'il n'y en a point, deux enfa ns
de chreur fouti ennent la nappe aux deux bouts (!'on
n'y met point alors de rubans de
fit),
ta
Qt
qll e le
pretre donne la communion. Souvent, au lieu d'nne
nappe de communion , on donne aux commllnians
une petite ferviette que chacun fe palfe de l'm'l
a
l'autre. On peut garnir la nappe de communion de
moulfeline ou de dentelle, ou la laiffer unie.
L'auhe
efl: une efpece de grande chemife de batifi e
ou de linon , qui fe met immediatement fur la fou–
tanne du pretre, Iorfqu'ii s'habille pour dire la melfe.
On Iui donne cinq quarts de long ,
&
quatre Jez de
large. Les manches en font toujou rs
ch
amadis. On y
monte un collet large d'un demi-pouce,
&
on
fa
it
un grand ourlet en-bas '
a
mains qu'on ne garnilfe
tout le tour de dentelle , ainfi que les bords des
m
anches.
l.Jefurplis
ell: OU
a
la Romaine OU
a
la Frani;:oife.
La
difference confill:e clans la fo rme desmanches. Le
corps ell: le meme , on lui donne trois quarts OU
llll
_peu plus de long ,
&
on le fo rme de qu atre lez de
batill:e ou de linon. II a un jabot
&
un collet. Les
manches
a
la
Fran ~oife ,
appellees impro,prement
nzanclzes ,
puifqu'elles rell:ent Ollvertes,
&
qu'on n'y
paffe point les bras' fe font d'un lez de meme bati!te
ou linon , d'environ une aune
&
un quart cle long.
Avant que de les attacher au corps du furplis , on
les plie clans la longueur, non pas precifement en
deux , mais de
fa~on
qu'une des moities depaffe
1
l'a11tre d'un pouce , la moins large en-dedans. Les
manches etant ainfi pliees, on les echancre de quatre
doigts par le haut en mourant,
&
de deux doigrs par
le bas. Le corps du fu rplis efi ouvert des deux cotes,
depflis le ,de!fous des bras jufqu'au tiers de la lon–
gueur pour palfer les bras. ,Les manches
a
la Ro–
maine font de larges manches, fans poignet , qui one
au mains la longue ur du furplis ,
&
fe
relevent juf–
ques fur le poignet lorfqu'on y palfe !es bras.
Le
rocket
des eveques.efi un fo rplis fans bras. Le
rochet
a
la Romaine, qui ell: celui de quelques cha–
noines reguliers, comme desGeno vefa ins deFranee,
a des manches en amadis comme l'aube.
L'anzifl
ell: un e efpece de petit mouchoir
qua~re
que le pretre met fur fon col en s'habillant pour dire
,la mel'fe , ii doit avoir deux tiers en quarre : on atta- .
che aux deux coins d'un des cotes deux cordons que
le pretre croife fur fa poitrine ,
&
noue enfuite fur ·
'fes reins.
Le
tour d'etole
qui fe fait en toile fi ne , ainfi que
...
















