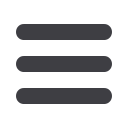
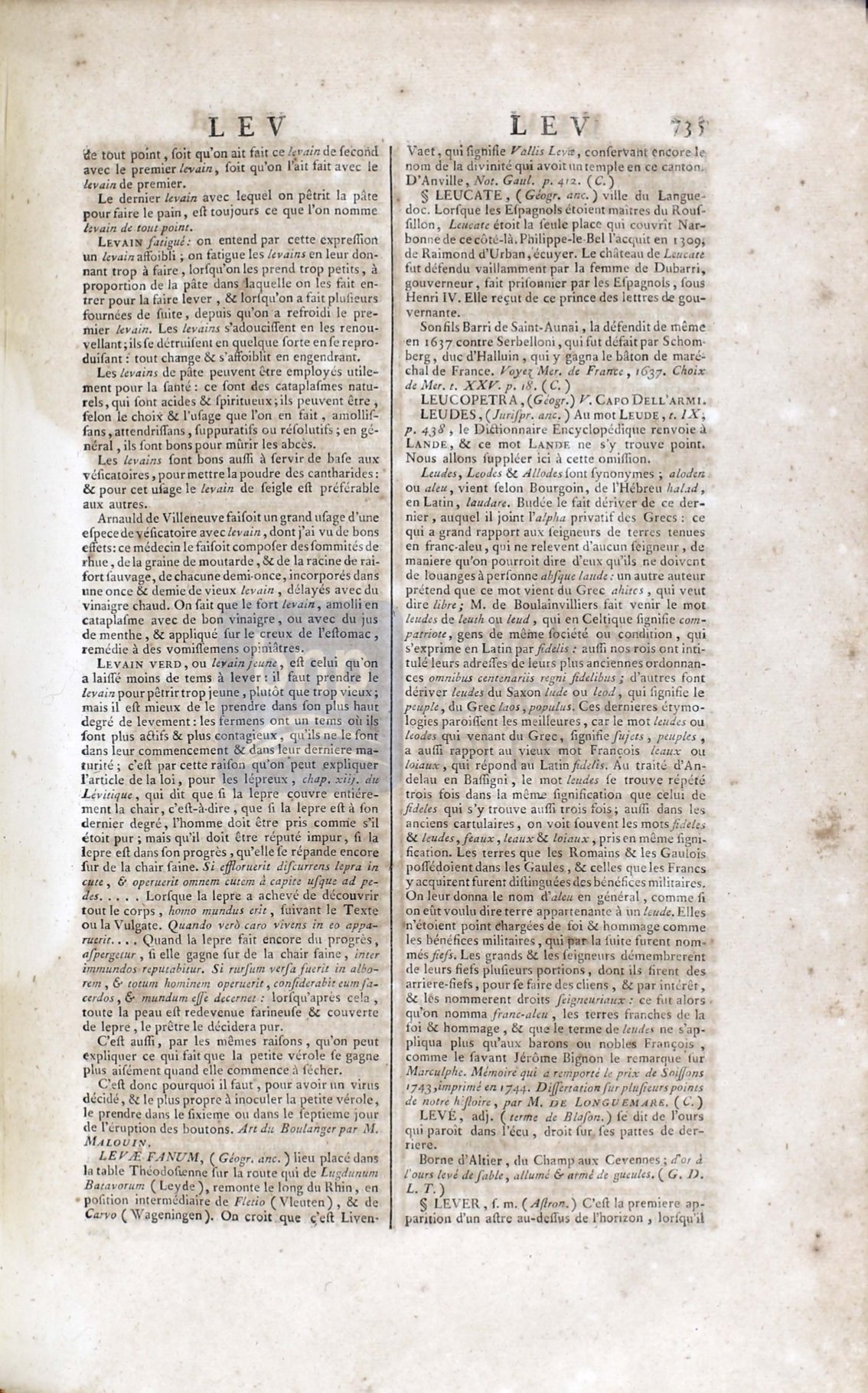
LEV
lie tout }Joint, Coit qu'on ait fait ce
l~r'.ain
?e fecond
avec le premier
Le-vain.,
foit qu'on l'a1t
fait
avec le
levain
de premier.
Le dernier
levain
avec lequel on petrit la pltte
pour faire le pain, ell toujours ce que l'on nomme
b.vain
d~
tout point.
LEvAI
fatigue:
on
~ntend
p.ar~ette
expreffion
un
levain
affoibli ; on fatigue !es
levains
en
leur don–
nant trop a faire' lorfqu'on !es prend trop petits' a
proportion de la pate clans laqu e,lle on
~es
fait en–
trer pour la
fai~e
lever ,
_&
lo;fqu on a fa!t _plulieurs
fuurnees de fu1te, dept11s qu on a refro1d1 le pre–
mier
tevain.
Les
Lev:Zins
s'adouai!fent en !es renou–
vellant; ils fe detruifent
e~ qu~lq_ue
forte en fe re13ro–
duifant: tout change
&
s affo1blit en engendr.ant.
Les
Levains
de pate peuvent &re employes utile–
ment pour la fahte : ce font des cataplafmes natu–
rels' qui foht acides
&
fpiritueux; ils peuvent etre'
folon le choix
&
l'ufage que !'on en fait , amollif–
fans, attendri!fans, fuppuratifs
OU
refolutifs; en ge–
neral ils font hons pour mlirir Jes abces.
Les'
Levains
font hons auffi
a
fervir de bafe aux
velicatoires. pour mettre la poudre des cantharides:
&
pour cet ufage le
levain
de feigle ell preferable
aux amres.
Arnauld de Villeneuve faifoit un grand ufage d'une
efpece de velicatoire
aveclevain'
dont j'ai vu de bons
effets: ce medecin le faifoit compofer des fommites de
rhue, de la graine de moutarde,
&
de la racine de rai–
fort fauvage, de chacune demi-once, incorpores clans
une once
&
demie 'de vieux
levain
,
delayes avec du
vinaicrre chaud. On fait que le fort
Levain,
amolli en
cataplafme avec de hon vinaigre, ou avec du jus
de menthe,
&
applique fur le creux de l'.efiomac,
remedie a des vomi!femens opiniatres.
LEVAIN VERD, ou
le"lainj~une,
ell celui qu'on
a
lai!fe moins de terns
a
lever
I
il faut prendre Je
l evain
pour petrir trop jeune, plutot que trop vieux;
mais il ell mieux de le prendre clans fon plus haut
degre de levement: !es fermens ont un terns ol1 ifs
font plus albfs
&
plus £ontagieux, qu'ils ne le font
d2ns leur commencement
&
clans leur derniere ma–
tu_!:.ite; c'ell par cette raifon qu'oil
0
peut .expliquer
l'article de la loi, pour les lepreux,
chap. xii). du
L evitique,
qui <lit que fi la lepre c;ouvre entiere–
ment la chafr' c'ell-a-dire' que
ft
la lepre ell
a
fon
dernier degre' l'homme doit erre pris comrrie s'il
etoit pur ; mais qu'il doit etre repute impur'
fr
la
lepre elldans fon progres' qu'elle
fe
repancle encore
for de la chair faine .
Si ejflonarit difcurrens lepra in
CUte
,
Y operuerit omnem CUtem
a
capite ufque ad pe–
des .
.• , .
Lorfque la lepfe a acheve de decouvrir
tom le corps,
homo mundus erit,
fuivant le Texte
ou la Vulgate.
Quando vero Caro vivens in eo appa–
ruerit.
• • •
Quand la lepre fait encore du progres,
afpergewr ,
Ii
elle gagne fut de la chair faine,
inter
immundos repittabiwr. Si mrfum verfa fuerit in albo–
rem
,
&
totllm hominem opemerit, co!ljiderabit eumfa –
cerdos,
&
l}lundum effe decernet.:
lorfqu'apres eela ,
toute la peau ell redevenue farineufe
.&
couverte
de lepre , le pretre le decidera pur.
C'efi auffi' par les memes raifons ' qu'on pent
~xpliquer
ce qui fait que la petite verole fe gagne
plus aifement quand elle commence
a
fecher.
C'e!l done pourquoi ii faut, pom avoir un vims
decide'
&
le plus propre a inoculer la petite verole;
le prendre clans le lixieme ou clans le feptieme jou.r
de
I'
'ruption des boutons.
Art d1t Boulanger par
1\1.
MALOUI:Y.
.
LEV./F.-FANUM,
(
Giogr. anc.)
lieu placedans
la table TheodoG.enne fur la route qui de
Lugdunum
Batavorum
(Ley de ), remonte le lon.g du Rhin en
pofition
interm~diaire
de
Flecio
(
leuten) ,
&
de
Carvo
(
Wagenmgen ), On croit . que c'efl Liven-
·'
LEV
3
Vaet, qui fignifle
Vallis Levee ,
confervaht encore
1
nom de la di vioite qui avoit un temple en ce canton.
D'Anville,
Not . Gaul. p. 412.
(
C.)
§
LEUCATE, (
Geogr. anc.)
ville du Langue–
doc. Lorfque !es Efpagnols etoient ma'itres du Rouf–
fillon,
Lmcate
etoit la feule place qui couvnt Nar–
bonne de ce cote-la, Philippe-le-Bel !'acquit en
1309,
de Raimond d'Urban ;ecuyer. Le chateau de
L
ucatt
fut defendu vaillamment par la femme de Dubarri,
gouverneur; fait prifo1mier par les Efpagnols, fous
Henri IV. Elle refitll de ce prince des lettres
de
gou–
vernante.
Sonfils Barri de Saint-Aunai, la defendit de meme
•en 1637 contre Serbelloni, qui fut defait par Schorn–
. berg, due d'Halluin , qui
y
gagna le bllton de mare–
chal de France.
Voye{
Mer.
de Frante, 1637. Choix
de Mer.
t.
XXV.
p.
18 .
(
C.)
LEUCOPETRA,
(Geogr.) V.
CAPO DELL'ARM
I .
LEUDES,
(Jurifpr-. anc. )
Au mot LEUDE,
t.
I X;
p. 438;
le Di.ltionnaire Encydopedique renvoie
a
LANDE ,
&
ce mot LANDE ne
s'y
trouve point,
Nous allons fuppleer ici
a
cette omiffion.
Leutles , L eodes
&
Allodes
font fynonyrpes;
aloden .
ou
aleu,
vient felon Bourgoin, de l
1
Hebreu
hal.1d,
en Latin,
laudare.
Budee le fait deriver de ce der–
nier, auquel il joint
\'alpha
privatif des Grecs : ce
qui a grand rapport aux feigneurs de terres tenues
en franc-aleu, qui ne relevent d'ancun feigneur, de
maniere qn'on pourroit dire d'eux qu'ils ne doivcnt
de louanges
a
perfonne
abfque Laude;
Un autre auteur
pretend que ce mot vient du Gree
ahitM,
qui veut
dire
Libre;
M.
de Boulainvilliers fait venir· le mot
1
leudes
de
leut!i
ou
feud,
qui en Celtique fignifie
com–
patriou,
gens de m&ine fociete ou condition , qui
s'exprime en Latin par
fide/is:
auffi nos rois ont inti–
tule leurs adreifes de leurs pins anciennes ordonnan–
ces
omnibus cemenariis
1~gni
fidelibus;
<l'amres font
deriver
Leudes
du Saxon
lude
ou
leod,
qui lignifie le
p euple,
du Gree:;
taos, popul11s.
Ces dernieres etymo–
l9gies paroilfent les meilfeures, car le mot
leudes
ou
Leodes
qui venant du Gree, lignifie
fuiets
l
peuples
t
a auffi rapport au vieux mot Frangois
Lenux
ou
Loiau.-c ,
qui Fe pond au Latin
fiddis.
Au
traite d'An–
delau en Baffigni, le mot
leudes
fe
trouve repete
trois fois clans la me!l1£ fignification que celui de
jideles
qui s'y trouve auffi trois fois; auffi clans !es
anciens cartulaires, on voit fouvent !es
mots fideles
&
Leudes ,feaux, lea11x
&
loia11x,
pris en meme figni–
fication. Les terres que !es Romains
&
les Gaulois
poifeQoient clans !es Gaul es,
&
celles que les Francs
y
acquirent furent difiinguees des benefices mil itaires.
On leur donna le nom
d'alcu
en general, comme
ft
on ef1t voulu dire terre apparrenantc
a
un
teude.
Elles
n'etoient point c!hargees de foi
&
hommage comme
!es benefices militaires, qui
par la
fuice furent nom–
mesfiefs.
Les grands
&
les feigneurs demembrcrent
de leurs fiefs plulieurs portions, dont ils firent des
arriere-fiefs, pour fe faire des cliens,
&
par interer,
&
!es nommerent droits
faigmuriaux:
ce
fut
alors
qu
1
on nomma
franc -a/en
,
!es terres franches de
la
foi
&
hommage,
&
que le terme de
Leudes
ne s'ap–
pliqua plus qu'aux barons ou nobles Franc;ois ,
comme le favant Jerome Bignon le r marque.
for
Marculphe. Memoire qui a remporti Lepri.-.: de Sniflons
17
43~imprime
en 1744.
D
iffertationfur plujieurs points
de notre .hifloire, par M. DE LoNGUEMARE.
(
C. )
LEVE, adj. (
terrtze de Blafon.)
fe die de
I'
ours
q_ui paroit clans l'ecu , droit fur fes panes de der–
nere.
Borne d'Altier, du Champ aux Cevennes;
d'or
a
/'ours Leve de f able, .illumJ
&
nrme de gu ules.
(G.D.
L. T.)
§
LEVER,
(.
m. (
Ajlron.)
C'ell la premiere ap:
par~tion
d'un afire au-deffus de
~'horizon
, lorfqu'il
•
















