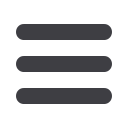
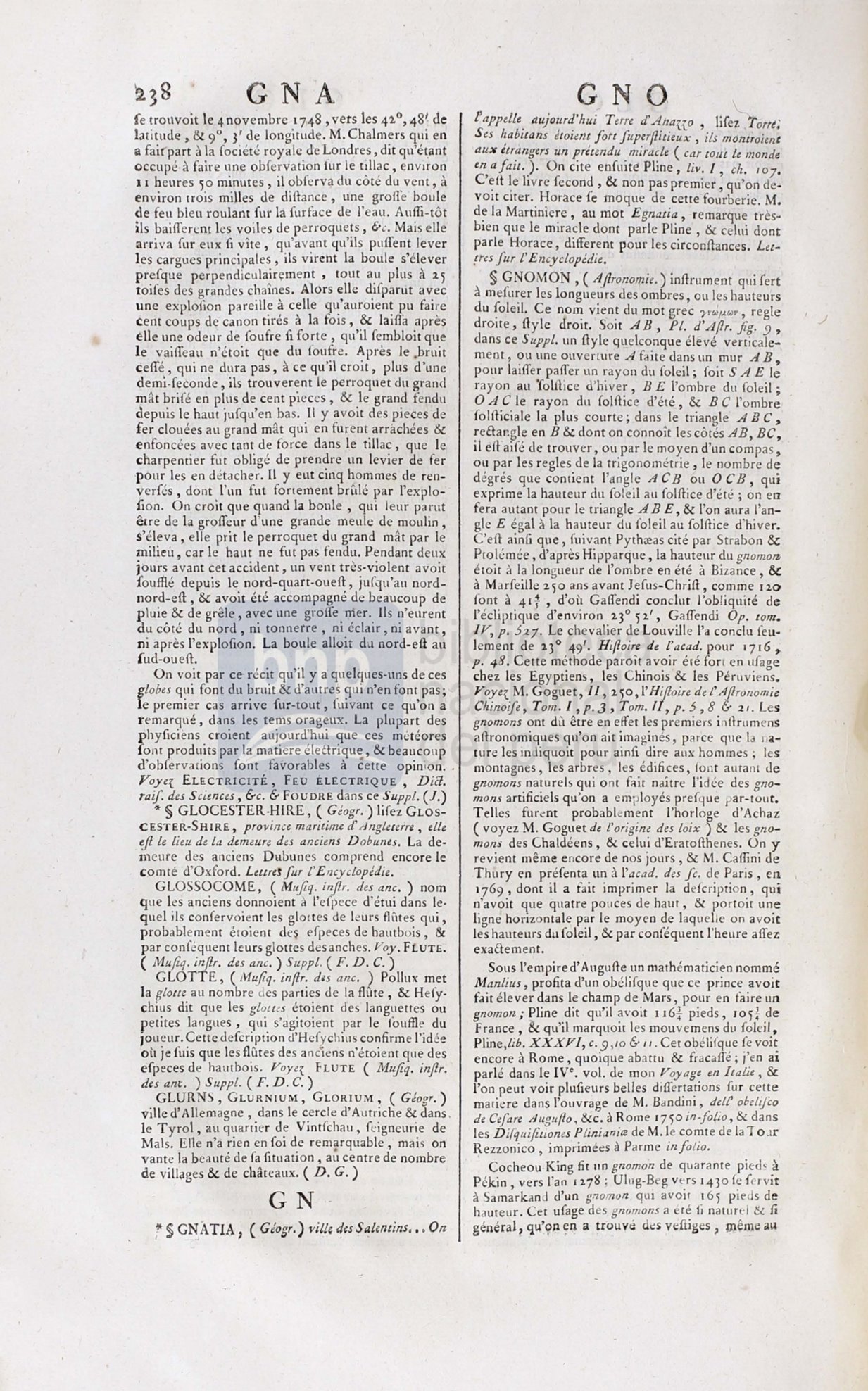
GNA
fe trot1voit le 4 nov embre 17,48 , vers les 4?.
0
,
48 (
de
latitude,
&
9°, 3'
de longitude. M.
Chalm~rs
qui en
a
fai(pa rt
a
la fociete
royale.de~ondre_s'
dit qu'e.t.ant
occupe·a faire une obfe rvauon lur le t1llac , environ
11 heures
50
minutes' ii obferv9 du cote du vent'
a
en viron trois miHes de dill:ance, une gro!fe bou le
de feu bleu roulant fur la furface de l'eau. Auffi-tot
ils bai!ferenJ les voiles de perroque ts ,
&c.
Mais elle
arri va fur eux fi v'ite, qu'avant qu'ils pufi'ent lever
les caraues prin cipales , ils vireht la boule s'elever
prefqu~
perpendicula}rement ' tout a_u plus a 15
toifes des grandes chames. ;\\ors elle d1fpa rut avec
une explofion pa rei lle
a
celle qu'auroient pu fa ire
c ent coups de canon tires
a
la fois,
&
laiffa
a
pres
elle une odeur de foufre fi forte , qu'il fembloit que
le vaiffeau n'etoit que du foufre. Apres le ,bruit
c effe ' qui ne dura pas'
a
ce qu'il croit '
ph~s
d 'une
d emi-feconde , ils trouv ere nr le perroquet du grand
m a t brife en plus de cent pieces'
&
le grand fendu
c\epuis le haut jufqu'en bas.
11
y avoit des pieces de
fer clouees au grand m;\ t qui en furent.arrachees
&
.enfo ncees avec tant de force dans le t1ll ac, que le
charpencier fut oblige de prendre un levier de fe r
·pour les en detacher.
II
y eut cinq hommes de ren–
verfes, dont l'un fut fonement brCile par l'explo–
fi o n. On crbit que quand la boule , qui leur parut
etre de la gro!feur d' une grande meule de moulin'
s'eleva' elle prit le perroquet du grand mat par le
milieu, car le haut ne fut pas fendu. Pendant deux
j bu rs avant cet accident, un vent tres-violent avoit
fouffle depuis le nord-quart-ouell:, jufq u'au nord–
nord-ell:,
&
avoit ete accompagne de beaucoup de
p luie
&
de grele , avec une gro!fe mer. ll s n'eurent
d u co re du no rd' ni tonnerre ' ni eclair, ni ava nt'
ni apres l'explofion. La boule alloit du nord-eil au
fud-ouell:.
On voit par ce· recit qu'il y a quelqueS•tlns de ces
globes
qui fo nt du bruit
&
d'autre5 qui n'en fo nt pas;
le premier cas arrive for-tout, fuivant ce qu'on
a
r emarque , dans !es terns orageux.
La
plupart des
p hyficiens croient aujourd'hui que ces meteores
fo nc p roduits par la matiere
eleltriqu~,
&
beau coup
d'ob(e rvacions font favorables
a
cette opinio n. .
Yoyez.
ELECTRICITE ,
FEu
ELECTRIQUE ,
Dill.
raif des S ciences,
& c. & FOUDRE
clans ce
Suppl.
(I.)
""§
GLOCESTER -HIRE, (
Giogr.)
li fez Gtos–
CESTER-SHrnE,
province,maritime d' Angleterre , elle
efl
le lieu de la demwre des anciens D obunes.
La
de–
ineure des anciens DHbunes comprend encore le
comte d'Oxford.
LettreS fur l'E ncyclopedie.
GLOSSOCOME, (
Mujiq. injlr. des anc.
)
nom
q ue les anciens donnoie nt
a
l'e(pece d'etui clans le–
qu el ils confervoient les gloc tes de leurs fl utes qui,
probablement e10ien c
de~
efpeces de hautbois'
&
par confequent leurs glottes desanches.
Voy .
FLUTE.
(
Mufiq. injlr. des anc.) Suppl.
(
F. D.
C. )
G LOTTE, (
Mujiq. inffr. dis anc.
)
Pollu x met
la
glotte
au nombre des parties de la fl i'ite,
&
Hefy–
c hius dit que Jes
glotus
etoie nt des languetteS
OU
petites langues, qui s'agitoient par le fouffi e du
1ou eur. Ce tte defcription d'He(ychiu confirme l'id 'e
Ott je fuis que Jes fl Cites des anc'iens n'eroient qu e des
e fp eces de hautbois .
//oyez.
hUTE (
Mujiq. injlr.
des am;.
)
Suppl.
(
F .
D . C.)
GLURN , GLURN ! UM, GLORTUM, (
GJogr. )
ville d' Allemagne , clans le cercle d'Aurriche
&
clans .
le T yrol, au quan ier de Vintfchau, feigneurie de
Mais. Elle n'a ri en en foi de remFquable, mais on
vante Ia bea ute de
fa
fitu ation, au centre de nombre
de villages
&
de chateaux. (
D. G. )
GN -
G
NO.
P
appelle.
au)our~'hui
Tetre
tf
Anaz.z.o
,
life~
0
m;
Ses lzabuans Jtoiult fort f upetffitieux , ils mdnuoient
aux terangers un prhendu miracle
(
car tout le monde
en a fail.
).
O n cite enfuite Pline,
Liv.
I,
ch.
1
o
7 ,
C':fi
~e
livre fecond ,
&
non pas p·remier, qu'on de–
vo1t c1ter. Horace fe moque de cette fourberie. M.
d~
la Martinie'.e, au mot
EgnatitZ;,
remarque tres–
b1en qu e le miracle dont parle Plme ,
&
celui dont
parle Horace, different pour !es circonil:ances.
Let·
.ms
fur l'Encyelope.die.
§
GNOMON, (
Ajlronomie. )
infl:rument qui (ert
a
mefu rer Jes longu eurs des ombres,
OU
les hauteurs
du
~oleil.
Ce non: vien! du mot grec
?'",,;,,,,,,.. ,
regle
drott e , fiyle dro1t. Solt
AB ,
PL.
d'Aflr. fig.
9 ,
clans ce
Suppl.
un fiyle ql!elconque ele ve ven icale–
ment, ou une ouvenure
A
faite clans un mur
AB,
pour laiife r pa
If
er un rayon du folej l ; foit
SAE
le
rayo n au 'folfiice d'hive r,
BE
l'ombre du foleil;
0
AC
le rayon du fo lll:ice d'ete ,
&
B C
l'ombre
folll:iciale la plus courte; clans le triangle
AB C,
rectangle en
B
&
dont on connoit !es cotes
AB, BC,
il efFaife de trouver, ou par le moyen d'un compas ,
ou par les regles de la trigo nometrie , le nombre de
degres que concie nt !'angle
A
CB
ou
0
CB,
qui
exprime la hauteur du fol eil au folfl:ice d'ete ; on ea
fera autant pour le triangle
AB E,
&
l'on aura l'an·
gle
E
egal
a
la hauteur du foleil au folll:ice d'hiver.
C'efl: ainfi que, fuivan\ Pyrhreas cite par Strabon
&
Prolemee , d'apres Hipparque, la hauteur du
gnomon–
ecoir
a
la longueur de !'ombre en ete
a
Biza nce,
&
a
Marfeille
250
ans avant Jefus-Ch rift, comme 120
font
a
41
r ,
d'oi1 Galfendi con cl'ut l'ob!iquite de
l'ecliptique d'environ
23°
p',
Galfendi
Op.
tom.
IV,
p .
.527.
Le chevalier de Lou vill e
\'a
conclL1 feu–
lement de 2
3
°
49'.
Hifloire de
l '
acad.
pour 1716
,
p .
48.
Cette methode parolt avoi r ece fo n en ufage
chez Jes Egyptiens, Jes Chinois
&
Jes Peru vims.
Yoyez.
M. Goguet,
II,
2
50, I'
Hi(toire
deL'
A(lronomie
Chinoife , Tom.
I,
p .
3,
T om.
If,
p.
5 , 8
t.,.
21.
Les
gnomons
Ont
dt\ etre en effet
Jes
premiers
j
firum enS
afhonomiques qu'on air ima gines , parce que la
na·
ture Ies i n iquoit pour ainfi dire aux hommes; les
moncagnes' les arbres ' les edifices' fon t
auram
de
gnomons
naru rels qu i o ne fair naitre l'idee des
gno–
mons
artificiels qu'on a employes prefque · ar- tou t.
T elles
fur~nt
probabl ment l'horloge d 'Achaz
( voyez
M.
Goguer
de l'origim des loix
)
&
les
gno–
mons
des Chaldeens,
&
celui d'Eratofthenes. On
y
revient meme encore de nos jours,
&
M.
Caffini de
T hury en prefenta un
a
l'acad. des
Jc.
de Paris, en.
1769 , dont il a fa it imprimer la defc ription, qui
n'avoit que quatre pouces de ham,
&
po rcoit une
ligne horizontale par le moyen de Iaqu elle on avoit
!es hauteurs
dµ
foleil,
&
par confequent l'heure a!Iex
exaClemen t.
Sous l'empired'Augufl:e un mathematicien nomme
Manlius,
profita d'un obelifque que ce prince avoit
fait elever clans le champ de Mars, pour en fai re un
gnomon;
Pline dit qu'il avoit 116-1- pieds, 105f de
Fran ce ,
&
qu'il marquoit !es mouvemens du fo leil,
Pline
lib.
XXXFI,
c.
9
,10
&
11 .
Cet
o~eli(que
fe voit
enco;e
a
Rome, quo ique abatcu
&
fracalfe;
j'en
ai
parle clans le
IV".
vol. de mon
Voyag: en ft alie ,
&
!'on peu t voir plufieurs belles
d1lfer.ra!10ns fu r
ce_t ~e
ma riere dans l'o uvrage de
M.
Bandrn1 ,
deft'
obelijco
de Cefare Auguflo,
&c.
a
Rome
175oin-fo(io ,
&
clans
!es
D i(quifitiones PLiniani12
de M. l.e co1:1te de la
1
o ..ir
Rezzonico, imprimees
a
Parme
in
folio.
Cocheou.King fi r un
gnomon
de quarante
pi ed~
a
Peki n vers !'an 1278 ; Ul ug-Beg vt·rs 1430 fe fervit
a
Sa m~rkan d
d'un
gnomon
qL1i avoir 16 5 p ieds de
hauteur. Cer ufage de
gnomons
a e re
Ii
na1urel
&
ii
general?
qu'.9~ ~~
a trou
ve
d~s
vefiiges
~
ineme
a~
'
.,/
















