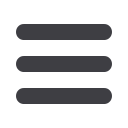
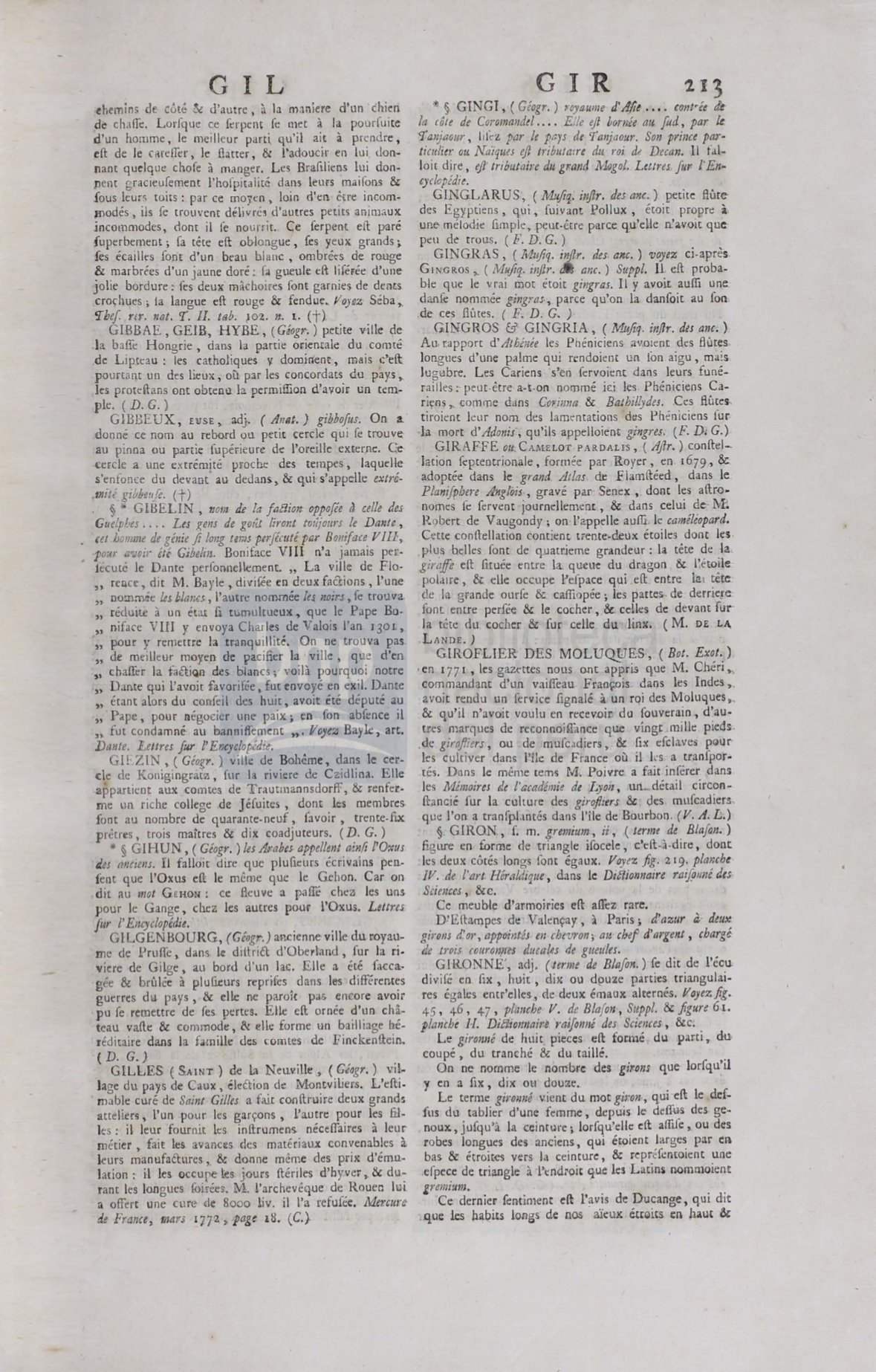
GIL
themins de
Coté
&
d'autre,
11
la maniere d'un
chim
dé
chafli:. Lorfque ce ferpent fe tlJet
a
la
poorrui te
d'un homme, le meilleur parti qu'il ait
a
prendre,
ell: de le cardrer, le flarter,
&
l'adoucir en lui uon–
nant quelquc chofe a manger. Les Brafiliecs lui don–
pen e ¡;;racleufement ]'hofpitaliní dan! lel1fs maifons
&
fous leurs toits: par ce mOJen, loin d'en. Cire incom–
modés, ils fe trouvene délivrés d'aunes petits anl111áUl{
jncommodes, dom il fe nourrir.
Ce
ferpent ell: paré
fuperbement; fa rece ea oblongue, [es yeUl{ <>rands;.
fes écaillrs fO/1t d'un beau blanc, ombrérs
d~
rouge
~
marbrées d'un jaune doré : fa gueule
tÍt
liféfée d'une
Jobe bordure
~
fes deule rnachoires fonE garnies de dents
croehues; la langue eft rouge
&
fendue,
flo)'oz
Séba,.
<Ibef
rtr.
nato
'I'.
II.
tab.
¡02.
n.
l.
(t )
GIBBAE, GElB,
HYBE,
(Giogr.)
petiee viII!: de
la
ba/fe Hongrie, dans la partie oEientale du cOnJeé
de Lipttoau: les eathol iques
y:
domirtent, m,lis c'efl
pourtam un des lieux , Oll par les eoncordats di.! pay.s,.
les protdtans ont obteollla perruifIion d'avoir un tem–
ple.
(D. G.)
GIBBEUX ,
HJSE,
ad}
(AI/llt-.) gibboJiIS.
On
a.
oonné ce nom au rebord ou petit cercle qui fe trouv¡:.
au pinna ou partie fupérieure
d~
I'oreille ex.ternc.
C-e–
cercle
a
une extréruité pFOche des tem.pes, laquelle
s'enfonce du devant au
dedan~,
&
qui s'appdle
eXlré–
_tllité gibbe/lje,
(t)
§"
GlBELlN ,
710111
de la jafliolt oppofée O celle des
Gurlpl.'es
. . ..
Le~
gens de goal líront
tri/íjOIl/'S
le Dante,
iel
hOI/lJíle de gbJie ji lo/tg lams perftc/lté PQr BOJliface VII},
poó/r a'!loil"
lté
Gibeltll.
Boniface VIII n'a jamais per-
1ecuté le Ddnte perfollnellement. " La ville de Flo·
" reoce, dit M. Bayle , divifée en deux faél:ions, I'une
"
oom.~e
Ú$
bla)¡c~,
l'alltre nommée
le.¡
//pirs
,fe
trouva.
" réduire
a
un éta.t
li
tumultueu". que le Pape Bo–
" nifare
VUI
y envoya Charles de Valais I'an
130L,
" pour
y
rememe la tr.allquillité. On oe trouva pas
" de rueiUeur moyen de pacifier la ville, que d'en
,. eha/fer la faétiQn des. bJancs; voila pourquoi notre
" Danee qui l'avoit favorifée, fut eovoyé en ex il. Ddnte
" éeant alors du coofeil des huit, avoit été député au
" Pape, pour oégo¡;ier une pail{; en fOil abfence il
,. fut condamné- au banoi/fement ,,'
lIoJe')J
Bayle, arto
Dante. Lettres f¡g l'Er.cyclopédie.
G
1"
ZIN , (
Géogr.
)
ville de Bobc!me, daos le cet–
de de Konigi ngrat2, fm la riviere de Czidli na. Elle
appanieot aux comees de Trautlllannsdorff,
&
renfez–
me
1m
riche college de Jéfuires, dont les membres
font au nombre de quarante-neuf, favoir, trente· Ex
prétrts, trois maleres
&
dix coadjuteurs.
(D. G. )
*
§
Glf-IUN , (
Géogr.
)
les
Af¡abe~
appel!6nt
ah¡Ji
1'0:4l1s
des nI/ciens.
f1
falloit dire que plufieurs écrivaíns peD.
feot que l'OxllS e!l: le rueme que le Gehon. Car
00
dit au
mol
GEHON: ce: Reuve a
pafi'é
chea les un!.
pour le Gange, cru:z les autres
pOUf
I'Q"us.
LeltreI
f/lr l'Encyclopédie.
GILGENBQURG,
(Géogr.)
ancienne villedu r,oyau–
me de LJru/fe, dans le diitriCt d'Obertand, fur la
ci–
viere de Gilge. au bord d'un lac. Elle
a.
été face","
gée
&
brulée
11
pluú.curs reprifes dans les différentes
guerres. dkl pays,
&
elle ne parOl! pas encore avoir
pu fe relDettre de (es pertes. Elle ea ornée d'UA cha–
teau vafre
&
commode,
&
elle forme un bailliage
ué–
réditaire dans la famille des comtes de Finclctn!l:ein.
(D. G.)
GILLES (SAINT ) de
la
Nmville,
(Géogr.)
vil.
lage du pay.s de Cal1x , éleaion de Montviliers. L'e:fti.
mable cure de
Saint Gil/es
a faie eon(l:ruire deux grands
atteliers, I'un pour les
gar~ons,
l'autrc: pour les
ill–
lts: il lellr fOllrnlt les infrrumens. o.éee/faires
a
leur–
méeier , faiE les
avalX~S
eles matéóa1lX conveoables
a,
kurs manufaCtures '.
&
donne mcme des prix d'ému.–
lation:
il
le! oecupe les jours ll:ériles d'byver,
&
du–
rant les longues tOi.l'ées. M. l'archevéque de Rouea l\li
a offert une cure de
8000
liv. il I'a refufée,
Mercure
de France, tlIars
1772,
pagt
18.
(C.).
G 1 R
~I3
-:j¡
§
GINGI, (
Géogr.
)
1'oyallllle d'Ajie
••••
con/"Ee
rJt.
la cú¡e de Coro/IJandd ..•. Elle
eJl
¡'omie flIt
fud,
par
le
c¡'alljaollr,
Illt-z
par le pt:ys dI 'I'anjaour. Son prince par–
liculíer ou.
Na/ques
eJl
tribu/flIre du
roí.
tU
Decall.
11
falo
loit dire,
eJl-
tributaÍ/'e
du.
granel Mogol. Lettres Jilr- tEn-
6)'clopédie.
GING.LARUS,
(Mlljiq. ¡nfor. des anc.)
perite Rute–
des Egyptiens, qui, [uivant Pollux, étoie proprc
a
une-
mélodi~
fllllple. peut.ecre parce qu'elle túvoit que–
pClI
de trollS.
(1/. D. G. )
GINGRAS,
(Mlljiq. il1Jl-r.
des.
anc.
)
voyez
ci.apres
G
1NG
ROS ,. (
MI/jiq. i¡¡fil·.
~
anc.) Suppl.
II
ell: proba–
ble que le vrai mot étoit
gingras.
11
y
avoit auffi une
danfe nommée
gingras.,
paree qu'on la danfoit au fon
de ces fiCHes. (
F. D. G, )
GI GROS
&
GlNGRIA,
(MRjiq. inj/r. dtI a/lC,
)
Au,
rapport d'
Alhiilée
les Phéniciens
a~01ent
dcs flútes
longues d'une palme qui
r~ndoient
un Ion aigu , ma!s
lugubrc. Les Cariens s'en fervoient dans leurs funé–
railles: peut-etre a-t-on nommé ici les Phéniciens Ca–
riel'ls" comme dans
Cori/l/III
&
BathillydeJ.
.ccs flutes·.
tiroienr lcm nom des lammearions dus Ph¿niciens fur
la mort
d'Adonis,
qu'ils appelloient
gingres. (F.
DI
G.)
GIRAFFE
011
CAMELOT
PARDALI~,
(Afor.
)
conll:~I
lation ftptentrionale, formée par Royer, en
1679,
&
adoptée daos le
gral1d Atlas
de
F
lam(téed, dans le
Plal1ifphere dnglbiJ
,
gravé par SenelC , dont les all:ro–
nomes fe fervent journellement,
&
dans celui de
M~
Robert de Vaugondy; on l'appelle auffi. le
caméléopard.
Cetre coní1:ellation contiene trente.deux étoiks dont les
plus belles font de q.uatrjeme grandeur: la tete de la
giraffe
ell: fltuée entre la queue du dragon
&
l~étoile
polalre,
&
elle occupe l'efpaee qui e(l: entre lal tete
de la grande ourfe
&
e.affiopée; les patees de derrie[c
font entre perfée
&
le eocher,
&
celles
de
devallt fur
la téte: du eoelle!
&
fur eelle du
¡¡Oll,
(M.
DE
LA,
LANDE. )
GIROFLIER DES MOLUQ.fJES·, (
Bot.
Exol. )
' eo
177
I , les gaz('ttes nous om appris que M. Chéri
h
commandant d'un vlli/feau Fraoy,ois dans les Indes , .
avoir rendu \ln ferviee fignaJé
a
un roi des Moluques._
&
qu'il n'avoit voulu en recev.oir do fouverain, d'au–
tres margues de reconnoiffan<:e qll.e vÍngt ruille pieds
.de
girojliers,
ou de mufcadiers,
&
fix
efclaves pOUl'"
les eultiver daos 1'¡le de Franee ou íl ks a tranfpor.
tés. Dans le meme
tem~
M>.
PoivIe a fait in(érer dans
les
Mimoires de l'úcadémie de Lyon,
un..déeail circon–
fi:ancié [ur -la culture des
girojlier..¡
&
des mufcadiers,
que I'on a cranfpJ,lntés daos I'tle de Baurbol).
(V. A. L.)
§
G1RON,
f.
m.
gremium,
ji,
(tmm
de
BlaJon.)
/i.gltre en forme de triangle ¡focele, c'e!l>a-dire, dont
les deux coeés longs font égaulC,
Voyez fig.
219.
planche
IV. de ['art Héraldiqlle,
dans le
Diflioll//aire raijjillílé des
Scimces,
&c.
Ce meuble d'armoiries
ea
alfez rare.
])!E[l:ampes de Valenyay,
11
Paris;
d'az/lr
a'
deu:t:
giro/lS d'
01',
appointb
ell
chtvroll; au chef d'argel1t, cbarg6
de /.J"Ois
COUrO/I/res
ducalPos de gueules.
GIRONNE', adj.
(tenlle
de B/aJon.)
fe dit de l'écu.
divifé en fix, huit, dix ou dguze parties triangulai–
res égalr:s entr'elles, de deu" émaux alternés.
f'oyezjig.
45,
4fí,
47,
plilllche
1".
de BlaJol1 , Srtppl.
&
jig/lre 6.1.
planche N. Ditt:io/tnair.e raifollllé des ScienctS,
&c.
Le
gironné
de huit. pieces en: fatlné du parti, du.
coupé, du tranehé
&
du taillé.
On ne nornme le n.ombre des
gir:ons
que larfqu'il
y
en a fix, di" Ol! douze.
Le tenue
girolmé
vient du mot
gi/ron,
q
ui
eí\¡ le dcf–
fus du tablier d'une: fcrume, depuis le de(l:¡,¡s des ge–
noux, jufqu'a
la
ceinture; lorfqll'elle eft arMe, ou des
robes longues des anciens, qui
é~oient
larges par
e~
bas
&
étroites vers la ceimllre,
&
repréfentoient une
efpeee de triangle
a
l'tndroic que les Laü1l$ nommoient
lremium.
Ce dernier fentiment eft l'!lvis de Ducange, qui dit
que:
les
habits longs de nos aleux éUOlts en haue
&
















