
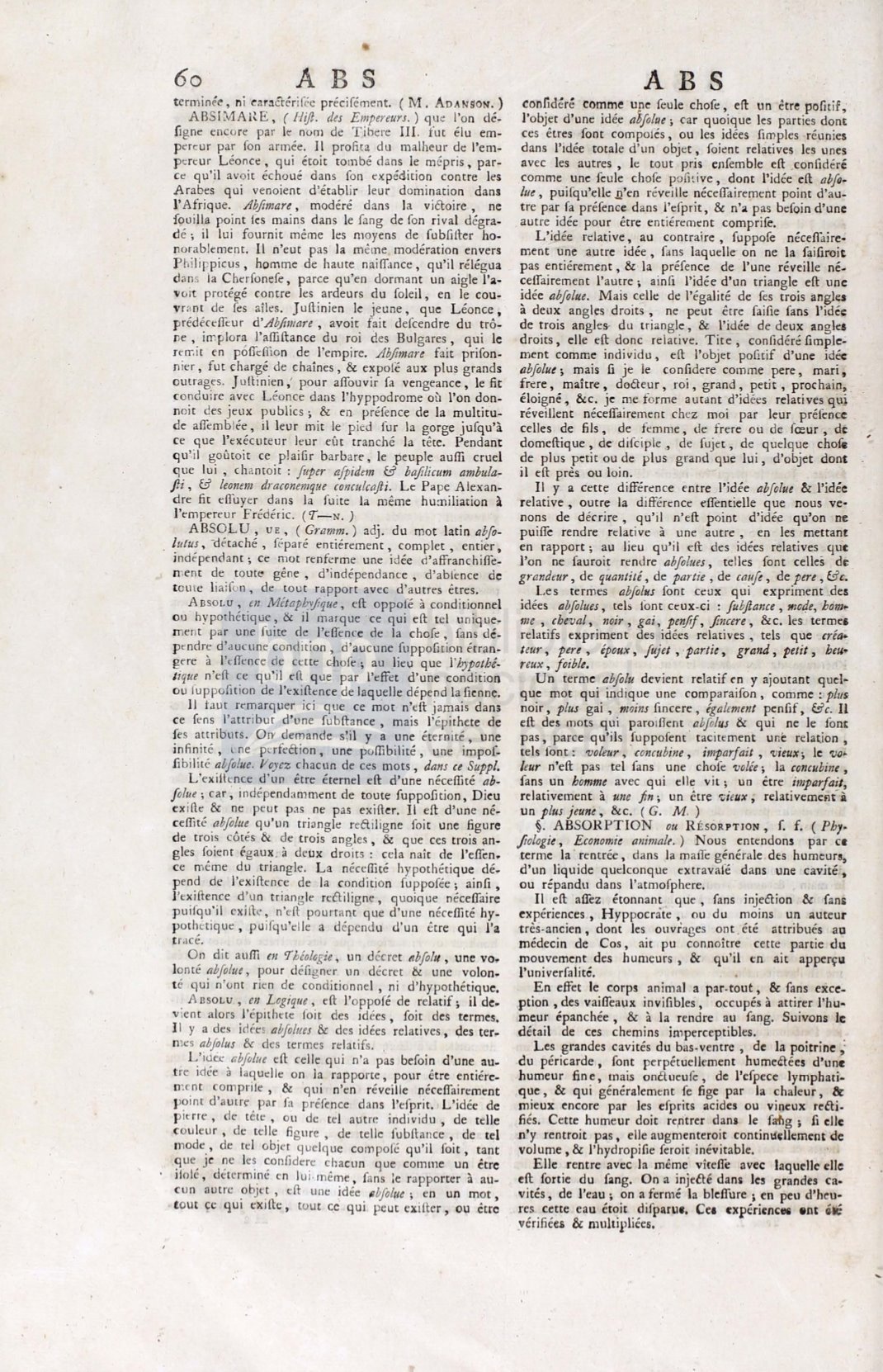
60
A B S
terminée, ni caraété
riréeprécirérnent. ( M . A
o
ANSON. )
ABSIMAltE ,
(
Hi.ft. des Empereurs.)
que l'on dé–
figne enca re par
k
norn de Tibere
III.
fot él u em–
percur par fon armée.
JI
profüa du malheur de l'em–
pcrrn r Léonce, qui étoit combé daos le mépris , par–
ce
qu'il avoit échoué dans fo n ex pédition contre les
Arabes qui venoient d'écablir leu r domi nati on dans
l' Afrique.
/lbjimare,
modéré dans
la viél:oi re ,
ne
fou illa poinEfe s mains dans
le
fang de fon rival dégra–
dé ; il
lui fourni t merne les moyens de fubfilter ho–
norabltment. ll n'eut pas la meme modération envers
Philippicus , homme de haute naiffa nce, qu'il rélégua
dans la Chcrfonefe, parce qu'en dormant un aigle l'a–
voit protégé contre les ardeurs du foleil, en le cou–
vrn nt de fes ailes. Juíl:in ien
le
jeune, que L éonce ,
prédécdfeur
d'.Abft111are
,
avoit fai t defcendre du tró–
ne , implora l'afiiíl:ance du roí des Bulgares, qui le
rtn~i t
tn pÓ!fdT1on de l'empire.
Abjimare
fai t prifon–
nier , fut chargé de chaines ,
&
expole au x plus grands
outrages. J utli nien ,' pour alfouv ir
fa
vengeancc,
le
fit
cood uire avcc L éonce dans l'hyppodrome ou l'on don–
noi t des jeux publics
¡
&
en préfence de la multitu–
dc a!fcmbiée ,
il
leur mit le pied fur la gorge jufqu'a
ce que l'exéc uteu r ku r eut tranché la tete. Pendant
<¡u'.il goutoit ce plaifir barbart, le peuple aufii cruel
que lui , chanroit :
fiper afpidem
&
bajilicum ambula–
jli,
&
leonem draconemque conrnlcajti.
Le Pape Alexan–
dre fit t:!fuyer dans
la fu ite la meme humiliation
a
l'trn pereur F rédéric.
( 'f-N.)
ABSOLU,
UE, (
Grnmm. )
adj . du mot latin
abfo–
lurus ,
-détaché , frparé entiérement, complet , entier,
indépend ant; ce rnot renfe rme une idée ct'affranchi!fe–
ment de
toute gene , d'indépendance , d'abtence de
tou te liaifon , de tou t rapport avec d'a utres étres.
A
nsoLu,
en
Métaph_if¡que ,
eíl: oppofé
a
conditionnel
ou · hypothétique, & il ma1qt1e ce qui e!t te! unique,
ment par une fuite
de
l'e!fenre de l
a chofr , fans dé–
pendn: d'aurnne condicion, d'aucune
fuppofiti.onérran–
gere
a
l'dTence
de
cettt:
c~1ore;
au l
ieu que l'hypothé–
lique
n'eíl: ce qu'i l
d\
q ue par l'effet d'u ne condi tion
ou fuppofition de l'exiíl:ence de laquelle dépeod la ficnne.
JI
taut
r~marquer
ici que ce mot n'eíl: jamais dans
ce feos l'attribur d'une fubíl:ance , mais
l'épithete de
fes attribms.
ÜIY
demande s:il
y
a une éteroité , une
in finité ,
l
ne perfeél:ion, une poffibilité, une irnpof–
.fibi lité
abfolue. //o)'CZ
chacun de ces mots,
dans
ce
Suppl.
L'exiflence d'un etre éternel eíl: d'une nécefiité
ab–
Jolue;
car ; indépend arnment de tome fuppofition, Dicu
ex iíl:e
&
ne peu t pas ne pas exiíl:er. ll ell: d' une né–
ceffité
abfolue
qu'lln triangle reéliligne foi t une figure
de trois cótés
&
de trois angles ,
&
que ces trois
~n
gles fo ienr égau x.
a
deux droits : cela nait de l'eífen.
ce mérne du triangle. L a nécefficé bypotbétique dé–
pend de l'exiíl:ence de la condi tion fuppofée ; ainfi ,
l'exifren_ce d'tin tr ian gle reél:i ligne , quoique nécelfaire
pu ifqu 'il exiíl:t', n'eíl: pourtant que d'une néceffité hy–
p ocbétique ' pu ifqu'dle a dépendu d'un erre qui l'a
t racé.
On dit auffi
e11
'Théologie ,
un déc ret
abfolu,
une vo.
Ionté
abfolue,
pour défigner un décret
&
une volon–
té
qui n'ont rien de condi tionnel , ni d'hypothétique,
AnsoLu. ,
en
L ogique
,
eíl: l'oppofé de relatif; il de.
vien t alors l'épnhet-e foir des
idées , foit des termes,
11
y
a des idées
abfol11es
&
des id ées relatives , 9es ter.
mes
abfoltis
&
des rermes relatifs. .
L' idtt
abf~lue
eíl: celle qui n'a pas befoin d'une au–
t re idée
a
la9udle on Ja rapportc, pour étre entiére–
men t compnte ,
&
qu i n'en réveille néce!fairernent
point d'autre par fa préfence dans l'efprit. L'idée de
p inre, de téte , ou de te!
autr~
ind ivid u , de telle
(:ouleu r , de telle. figure , de tellc fubíl:ance , de tel
mode., de re! obJer quelque compofé qu'il foit, tant
9 ue, JC
~e le~ c;-onlide~e
c.hacun que comme un étrc
iiole , determine en h11- merne , fans :e rapporter
a
au–
cun autre .ºbJe_t , eíl: une idée
11bfol11e
;
en un mot,
tour
~e
qut e!¡ofte, tour e.e qui peut exiíl:er, ou
erro
A B S
conlidéré comme une feule chofe, eíl: un étre pofitif;
l'objet d'une idée
abfolue;
car quoique ks parties dont
ces etres font compoles, ou les idées fi.mples ·réunies
dans l'idée torale d'un objet, foient relatives les unes
avec les autres , le tout pris enfemble eíl: ,confidéré
comme une fcule chofe pofüi ve, dont l'idée eíl:
abfo·
/11e,
puifqu'elle !!'en réveille néce!fairement point d'au–
tre par
fa
préfence dans l'efprit,
&
n'a pas befoin d'unc
autre idée pour étre entiérernent comprife.
L'idée relative, au contrairc , fuppofe néceffai rc–
ment une autre idée , fans laquelle on ne la faifir-0it
pas entiéremeot,
&
la préfence de l'une réveille né–
ce!fairement l'autre ; ainfi
l'idée d'un triangle ell: une
idée
abfolue.
Mais cellt: de l'égalicé de fes trois angles
a
deux angles droits '
ne peut etre faifie fans l'idée
de trois angles- du triangle ,
&
l'idée de deux anglea
droits, elle eft done relative. Tite, confidéré fimplc–
ment commc individu, eíl:
l'objet pofitif d'une idéc–
abfolue
;
mais fi je le
confidere comme pere, mari,
frere, maitre, doéleur , roi, grand, petit , prochai n,
éloi~né,
&c. je me fo rme aucant d'idées relatives qu·
réve1llent néceífairemenc chez moi par
leur préfence
celles de fils, de fcrnrne, de frere ou dti fceur , de
domeíl:ique, de· difciple , de fuj et, de quelque chofe
de plus pctit ou de plus grand que lu i , d'objet dont
il
eíl:
pres ou loi n.
11
y
a cette différence entre l'idée
abfolue
&
l'idéc
relative, outre la différence e!fentielle que nous ve•
noos de déc rire, qu'il n'eíl: point d'idée qu'on ne
pui!fe rendre rdative
a
une autre ,
en
les mettant
en rapport; au Jieu qu'il eft des idées relatives que
l'on ne fauroit rendre
abfolues,
telles font cellcs de
grandeur,
de
quanliti ,
de
partie
,
de
ca11ft ,
de
pere,
&c.
Les
termes
abfo/J1s
font ceux qui expriment des
idées
abfolues ,
tels font ceux-ci :
fu bflance
,
mot/e, hom•
me
,
cheval, noir , gai, penftf , jincere ,
&c. les terme•
relatifs expriment des idées relatives , tels que
créa•
Jeur, pere
,
ipoux , fujel
, ·
partie , grand, petit
,
heu•
reux, foible.
Un terme
abfolu
deviene relatif rn
y
ajoutant quel–
que rnot <¡UÍ indique une comparaifon, comme:
plui>
noir,
plus
gai ,
nwins
fincere ,
igalemenl
penfif,
&
c.
It
eft des mots qui paro11Jent .
abfolus
&
qui ne le font
pas' parce qu'ils .fuppofent
tacitement une relarjon '
tels font :
voleur, concttbine,
imparfait
,
'Vieux;
le
w•
/eur
n'eíl: pas
tel fans une chofe
volée;
la
"concubine
,
fans un
homme
avec qui elle; vit; un etre
imparfaiJ,
rclativement
a
une
fin;
un etre
ú eu:t,
relativemetlt
a
un
plus j eune,
&c. (
G.
M .
)
§.
ABSORPTION
ou
R É SORPTION'
f.
f. (
Phy·
jiologie, Economie anímale.
)
Nous entendons
par et
terme la rencrée , dans la maífe générale des humeurs,
d'un liquide qudconque extravafé dans une cavjré
~
ou répandu dans l'atmofphere.
Il eíl: a!fez étonnant que , fans injeél:ion
&
fans
expériences , Hyppocra'te, ou du moins un auteur
tres-ancien' doot les ouvrages ont .été
atrribués
ªº
médecin de Cos , ait pu connoitre
cette parrie du
mouvernent <les humeurs ,
&
qu'il en ait
apper~ia
l'uni verfalité.
En effet le corps animal a par.tout,
&
fans exce–
ption , des vaiífea11x invifibles, occupés
a
attirer l'hu–
meur épanchée ,
&
a
la rendre au fang. Suivons le
détail de ces chemins imperceptibles.
.
Les grandes cavités du bas-ventre , de la poitrine;
du péricarde, font perpétuellement humcétées d'une
humeur fin e, mais onélueu fe , de l'efpece lympbati–
que,
&
qui généralement fe fige par
la chaleur,
&
mieux encore par les efprits acides ou vincux reéti–
fiés. Cette humeur doit re,rttrcr dana
le fafig ;
fi
clic
n'y renrroit pas, elle augmenteroit contim!cllement de
volume,
&
l'hydropilie
feroi~
inévitable.
·
Elle rentre avec la méme viceífe avec laquclle elle
eft fortie du fang. On a injeété dans les grandes ca–
vités, de l'eau ; on a formé la bleífure ; en peu d'heu·
res cette eau étoic difparu1, Cea expéricnce11
11nt
~lé
.vérifiées
&
multi1iliées.
















