
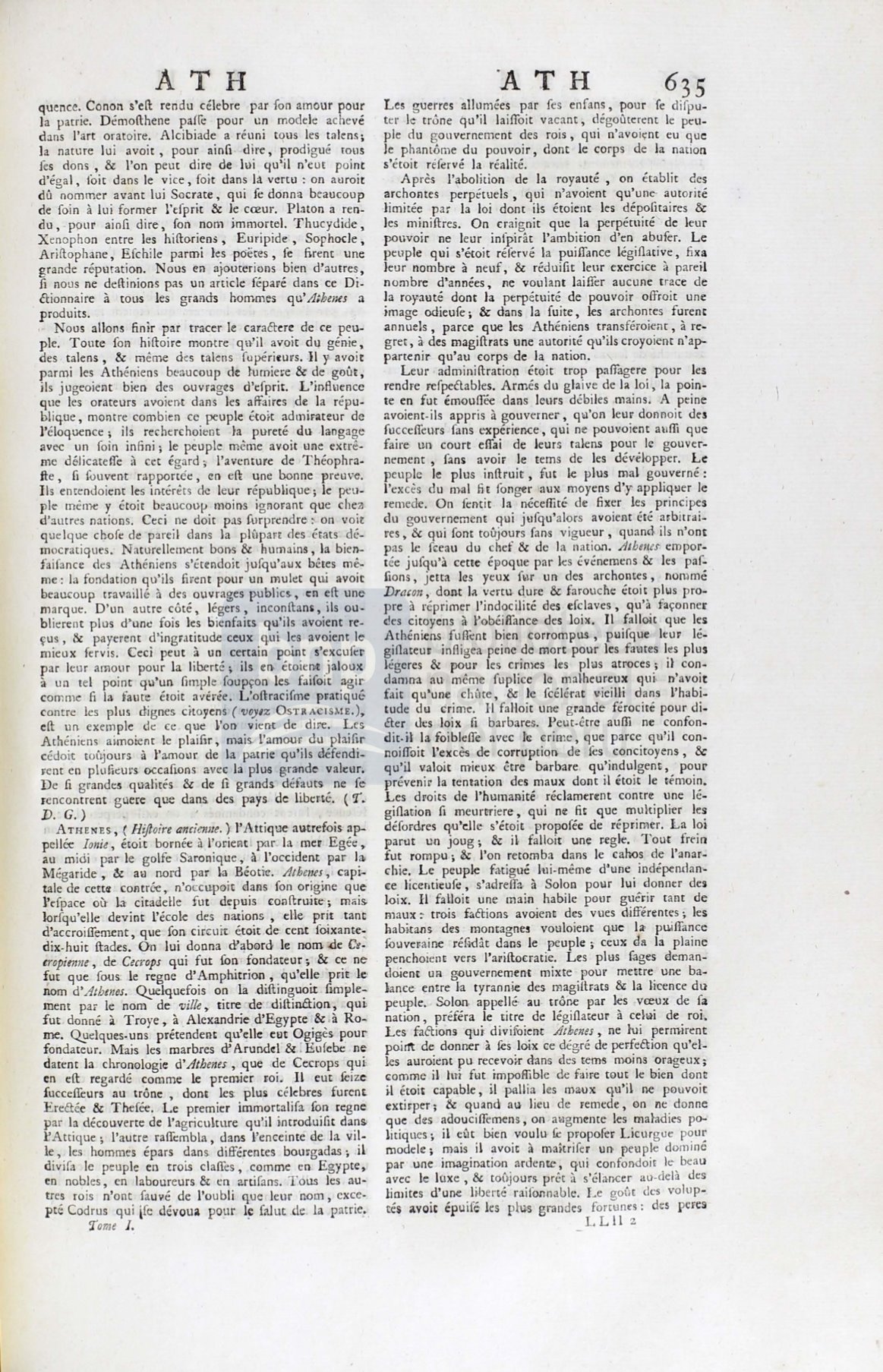
ATH
quence. Conon s'eíl: ren du célebre par fon amour pour
Ja patrie. Démoíl:hene paffe pour un modele achevé
da
ns
l'art oratoire. Alcibiade a réuni tqus les talens;
la
nature lui avoit , pour ainfi· dire, prodigué rous
fes dons ,
&
l'on peut dire
de
lui qu'il n'eut point
d'éga l, foit daos le vice , foit daos la vcrtu : on au roit
dú nommer avant lui Socrate, qui
fe
donna beaucoup
de foin
a
lui former l'efprit
&
Je creur. Pbton a ren–
du, pour ainú di re, fon nom immortel. Thucydide,
Xrnophon entre les hiíl:oriens , Euripide , Sophocle,
Ariíl:ophane, Efchi le parrni les póeres, fe
firent une
grande répuration. Nous en ajouterions bien d'autres,
fi
nous ne deíl:inions pas un anicle fépaFé daos ce Di–
él:ionnaire
a
tous
les grands hommes qu'
A;henes
a
produits.
' Nous allons finir par tracer le caraél:ere de ce peu–
ple. Toute
fo¡.¡
hiíl:oire montre qn'il avoir du génie,
des ralens,
&
meme des calens fupéritm<s.
ll
y
avoit
p armi les Athéniens beau coup de turniere
&
de
goú~,
ils jugeoiellt bien des ouvrages d'efprit. L'infh1ence
que lesorateurs avoient dans les affaires de la répu–
bliq.ue,monrre cambien ce peuple étoit admirateur de
l'éloquence ; ils
recherchoient }a pureté du laogaoe
avec un foln infini; le péuple meme avoit m1e exrrt
me déJicatelfe
a
cet égard
~
!'aventure de Théophra–
fte ,
¡¡
fouvent rapportée, en
efi:
une bonne preuve.
l is
entendoienc les
inrér~rs
de
leur répub1ique; le
peu–
ple
meme
y
étoi~
beaucoup moins ignorant que
che~
d'autres nations. Ceci ne doit pas forprendre
~
on voit
q ue lque chofe de pareil daos la plilpaFE <les éms dé-
1nocrariques. Natmellemen.t bons
&
humains, la bien–
fa ifance des Achéniens s'émidoit jufqu'aux bétes
me..
me :
la fondation qu'ils füent pour un mulet q ui a·voic
beaucoup u availlé
a
des ouvrages publ ics. ,
e¡¡
eíl: une
marque. D' un autre coté, légers, inconíl:an,, ils ou–
blierent plus d'une fois les bien.faics. qu'ils avoient re–
~us,
&
payerent d'ingratitude ceux qui les avoient le
mieux fervi s. Ceci peut
a
un cercain point s'excufer
par leur arnom pour la liberté ; ils en. étoimt jaloux
a
un te! poin t qu'un limpie
foup~on
les. faifoit agir
comme
fi
la faure émit
avér~e.
L'oílracifme
p~atiqué
conrre les plus dignes citoyens
(
voy1z
OsTRA.ClSME. ),
ell: un exemple de ce que l'on viene de dir:e. Les
Athéniens aimoien t
le
plaifir, mais. L'amou·F du plaifi.r
cédoit wUjours
a
l'amour de la patrie qu'ils Séfendi-
9ent en plufieui:s. occafwns avec la plus grnnde valeur.
De
fi
grandes qualités
&
de
fi
grands défauts ne fe
renconuent guere
qill!
dans. des pays de libetté. (
'!'.
D.G.)
·
ATH
ENES , {
Hifloire anciemre.)
!"Attique
a~tref.ois
ap–
pellée
Jonie ,
étoi.t bomée
a
l'o~ieflt
par la mer Egée,.
au midi par le golfe Saronique ,
a
l'occident par la.
Mégaride,
&
au nord par ta Béotro.
Atbenes ,
capi–
tale de cemi co11trée , n'occup©i& clans fon
orig~ne
que
l'efpace oU-
La-
citacldle fot depuis
~011íl:rnice-; m~is.
lorfqu'elle devi nt l'école des n
ations , die prit tanc
d'accroiífement, que
ÍO!lJ
cirrnit
étoit.decent foixante–
dix-huit íl:ades. On lui doona d'ab©rd le nom .de
Ce–
cropienne,
de
Cea ops
qui
fu.t
fon fondateur;
&
ce ne
fut que fous le regoe d'Amphitrion, qu'elle
pr,i~
le•
nom
d'Athm6s.
Q__uelquefois on
la
.diftinguoit úm¡.ile–
ment par le nom de
vitre,
ti
ere
tle difünél:ion,
qu ~
fut
donné
a
Troye,
a
Alcxandrie d'Bgypte
&
,¡¡
Ro–
me.
~elqu~s-uns
prétendent qu'elle cut Ogiges pour
fondaceur. Mais les marbres
d'
Arund~l
& ;
fü1febe ne
datent la chronologie
d'Athenes,
que de Ceci:ops qui·
cm
eíl:
regardé comme
le
premier ioi.
11
eut feize
focceffi:urs au trone , donl
les: plus célebres furent
Ereélée
&
Thefée. Le premier immortalifa fon regne
p ar la découverte de l'agriculmre qu'.il i.ntroduifit danS>
l:Attique; l'autre raffembla, dan5 j.'enceinte de Ja vil–
le,
les hommes épars dans. différentes bomgadas ; il
divifa le peuple en trois cl alfes , comme en. Egypte,
en nobles , en laboureurs
&
rn artifa ns. Tous les au–
tres ro is n'ont fauvé de l'oubli que leur oom, cxce–
pté Codrus qui
¡re
dévoua pour
I~
fal uc ele.
la
patrie.,
'lome l .
.A T H
635
Les guerres allumées par fes enfans, pour fe difpu–
ter le trone q.u'il lailToit vacant ' dégoücerent le peu–
ple du gouvernement des rois , qui n'avoi,nt eu que
le
phantome du pouvoir, done le corps de la nacion
s'éroit réfervé la réaliré.
A
pres
l'abolition de la roya
u
té , on établit des
archontes perpétuels , qui n'avoient qu'une· aurorité
limicée par la loi dont ils étoient les dépofitaires
&
les
miniftres. On craignit que la perpérn iré de leur
ponvoir ne leur inlpirat l'ambition d'en abufer. Le
peuple qui s'étoit réferv é la puiJfance légiflacive , fi xa
leur nombre
a
neuf'
&
réduifit leur exercice
a
pareil
nombre d'années, ne voulant lai!fer aucune trace de
la
roy>auté dont la perpétuité de pouvoir offroit une
image odieufe;
&
dans
Ja
fuite, les archonres forent
annuels, parce que les Athéniens transféroiem ,
a
re–
gret ,
a
des rnagi!hats une aurorité qu'ils croyoient n'ap–
parrenir qu'at1 corps de la 11ation.
Leur adminiíl:ration étoit trop palfagere pour les
rendre refpeélables. Armés <lu glaive de Ja loi, la poin–
te en fot émouffée dans lems débiles mains.
A
peine
avoient-ils appris
a
gouverner' qu'on leur dom10it des
fuccelfeurs fans expérience, qui ne pouv-0ient a11ffi que
faire
un
court dfai de leurs talens pour
le
gouver–
nemcnt , fans avoir
le tems de
les dév.élop.per.
Le
peuple
le plus iníl:ruit , fiut
le
plus mal gouverné :
l'exces du mal
fi
t
fonger au>1 rnoyens d'y appliq.1ier Je
remede. On fem it la néceffité
de
fixer les principes
du gouvernement qui jufqu'alors avoieat
é1é
a~bi rrai
res,
&
qui font tolijours fans vigueur, qu3nd ils n'ont
pas
le
faeau du chef
&
de la nation.
A1bmes-
empor–
tée jufqu'a
eme
époque par k s événemens
&
les paf–
fion s, j eita les yeux for un des archonres, nommé ·
Dra&on ,
done la
vcrm
d_me
&
farouche
~toit
pli.ispro–
pre
a
réprimer l'indocilité des
efe
laves, qu'a
fa~onner
(les ciroyens
a
l'obéilfance des loix.
11
falloit qt1e les
Athéniens fuff<::nt bien cor.rompus, puifque ltuP
lé–
giílateur infligea peine de rnort pour les
fa~ms l~s
plus
légeres
&
pour les crimes les
pl111s atr-oces ;-
il con–
damna au· meme fu.plice
le malheur.eux qui. n'avoit
fait q u'une chí1 re,
&
le fcéJ érat v-ieilli daAs 1'habi–
tude du c>rirne.
H
faHoi t une grande férocité pour di–
cfrer tles Joix
fi
barbares. Peut-etre auffi ne confon–
dit-il la foibleífe avec
1':
crime , que parce qu'il con–
noilfoit l.'exces de corruprion de: fes c:onciroyens,
&
qu'il 11aloit mieux erre barb<lre qu'indulgent' pour
prévenir la tentation des maux dom i.l étoi.t le
~émoin.
Les dPoits de l'humaaité
réclamtr~nt
centre une lé–
giílation
¡¡
meurl'riere, qui nit
fit
que muhiplier les
défordres q.u'clle s'éroit propofée de répr.imer.
La
loi
parut
un joug;
&
it falloit une r.egle. Tout freiri
fue rompu.;
&
l'on retomba dans
le
(ahos
de
l'anar–
düe. Le pc:upl1: fatigué h1i-meme d'une
indépenrlan~
'!:e licentieufe, s'adrelfa.
a
Solon pour lui donntr des
loix.
1:1
faUoit u
ne mai11 habite pom gué'rir tant de
maux
~
rrois faél:
ior.isavoienn des v
ues différentes; les
hab~tans d~s
montagne5 vouloient
q.ue
la>
pu.ilfance
fouver.aine téNdat <lans
Je
peuple ;· ceux
da
la
plai ne
f>enchoienc vers l'ariftoc;:ratie. Les pl1:1s
f.ages
cleman–
doient uR g-0uvernement mixte pour meme u.ne ba–
lance· entre la tyran ni.e des magilhats
&
la J.icence du
peuple. Solon. appdlé· au. trone par les vreux
de
fa
nation' préféra le titre de légiílateur
a
celui de roi,
Les faétions
qu ~
divifuient
./fthcnes ,
ne lui permirent
po.irrt de donner
a
ks ioix Ce dégré de peFfeé\;iofl qu'el–
les auroient pu recevoir dans des tems moins orageux;
c;omme il lui fot impoffible d
e faiFernut le bien
don~
~l
étoit capable, il pallia les
ma.uxq1:1'il ne pouvoit
e::xti~per;
&
quand au lieu de remede, e n ne donne
que des adouciffernens, on al<1gmcme les ma}adies po–
litiques; il eut bien voulu
l.i:
proporer 1.icu.rgue pour
modele; mais il avoic
a
maitrifer ur> prnp le dorni11é
p<w une imagination arden
te,
qui confondoiE le beau
avec le loxe ,
&
toCtjours pret
a
s'élimcer au-dela des
limites d'une liberté raifonnable. Le goí\t
eles
volu p–
tés
avoit
épuifé les plus gran des fomrnes: des
peres
LL ll
2
















