
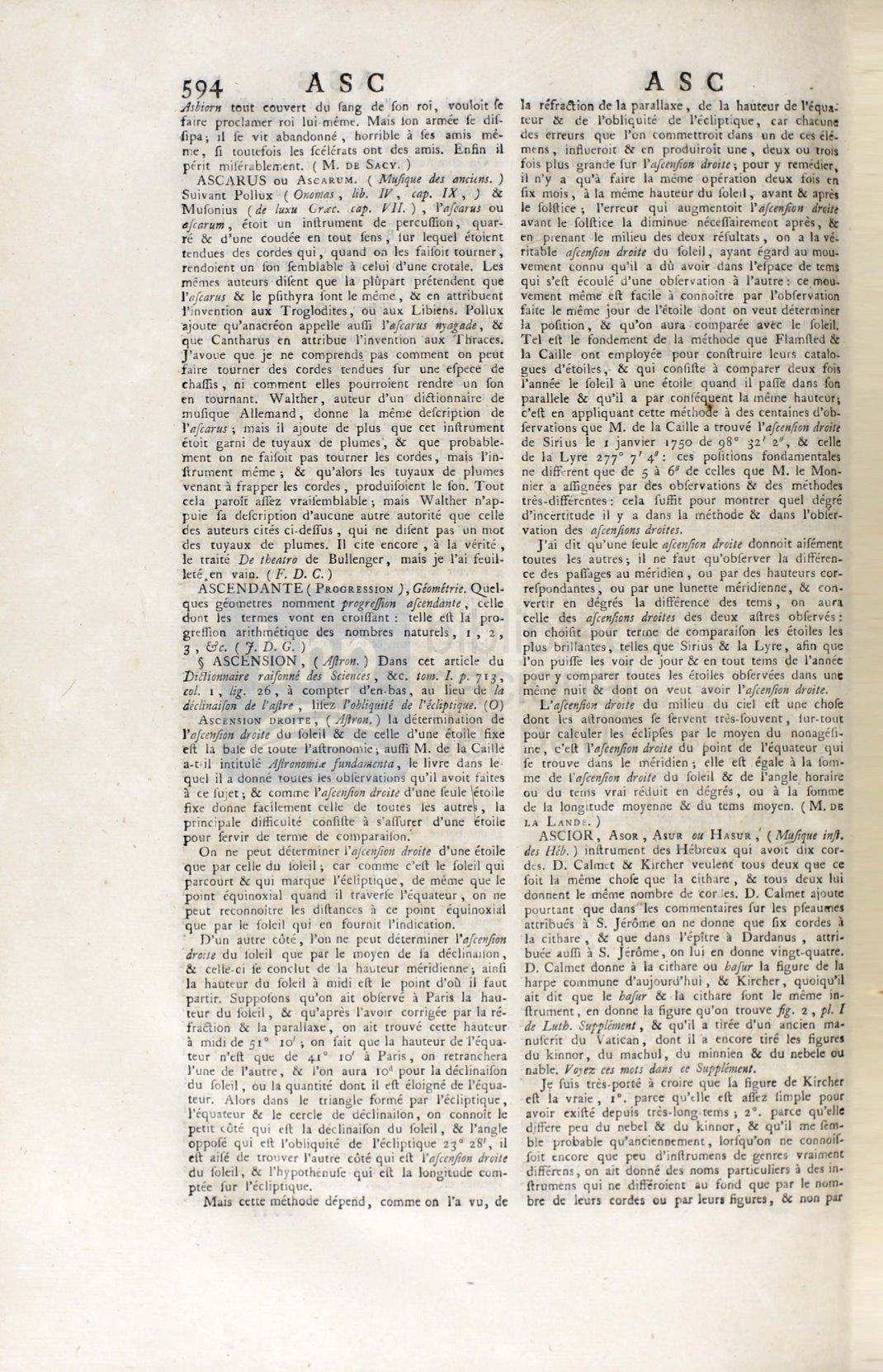
594 -
A S C
Asbior11
tout couvcrt du rang de fon roi, vouloit fe
fa 1re proclamer roi lu i méme. Mais fon armée fe dif–
iipa; 11
fe vic abandonné , horrible a fes amis mé–
me,
Ii
toutc::fois les fcélérats ont des amis. Enfin il
pfrit miférablement. ( M. DE SACY. )
ASCJ\.RUS ou Asc ARUM.
(Mu.fique des 011cit11s.)
Suivant Pollux (
Ono11111s , lib. 1/1, cap. IX, )
&
Mu foni us
(de luxu
ra:c.
cap.
//JI.
) ,
l'afaanu
ou
tJjcarum,
éroit un
inflrummt de percuffion, quar–
ré
&
d'une coudée en tour fens, fur lequel éroknt
tt:ndues des cordes qui, quand on les faifoic cournt r,
reodoient un fon femblabk
a
celui d'une crocale. Les
memes auteurs difenr que la plúpart préteodent que
l'afcarus
&
le
p!i thyra fo nt le meme •
&
en
amibutn~
i'invenrion aux Troglodires, ou aux Líbicos. Pollux
·ajoute qu'anacréon appelle auffi
l'ajcarus 11yo_gade ,
&
que Camharus en actribue l'invention aux Thraces.
J'avoue que je ne
comprend~
pas commenr on peut
faire courner des cordes
tendues fur une efpece de
chaffis , ni comment elles pourroienr rendre un fon
en
rournanc. Walrher, auteur d'un diétionnaire de
mufique Allemand, donne
la meme defcription de
l'afcarus
;
mais il ajoute de plus que cer inftrument
étoit garni de tuyaux de plumes ',
&
que probable–
'ment on ne faifoir pas tourner les cordes, mais l'in–
ftru ment méme ;
&
qu'alors les
ruyaux de plumes
venanc
a
frapper les cordes , produifoient le fon. Tout
cela paroi[ affez vraifemblable; mais Walther n'ap–
puie fa defcription d'aucune autre autorité que celle
des auteurs cités ci-deffus, qui ne difent pas un mot
des
tuyaux de plomes. 11 cite encore ,
a
la vérité ,
le craité
De thtt1tro
de Bullenger, mais je l'ai feuil–
kté. en vai a.
(F. D.
C.)
ASCENDANTE ( PROGRESSION),
(;éométrie.
~el
ques· géometres nomment
progrejfion afcendante,
cd le
done les
termes vont en croiífanr : telle efl la pro–
grellion arithmétique des nombres narurels , r ,
2,
3
,
&r. (
J.
D. G.
)
§ ASCl::NSION, (
Aflro11.
)
Dans cet anide du
1Jillion11aire roifo11né des Scie11m
,
&e.
tom.
J.
p.
713 ,
col.
1 ,
lig.
26 , a comptcr d'en .bas, au
lieu de
lt1
décli11aifon de /"aflre
,
lilez
l'oblíq11ité de Nclip1iq11e.
(0)
ASCENS ION DRO JT E' (
Aflron.)
la détermination de
l'ajce'njion droite
du foleil
&
de celle d'une étoile fixe
eíl: la bJJe de toutt: l'aftronomie; auíli M. de la Caille
a-t-il intitulé
Ajlro11omia: /11ndai;1e11ta,
le livre dans Je.
qutl il a donné toutes les oblervations qu'il avoit faires
a
ce fujet;
&
comme
1'11fce1¡/ion droitt
d'trne feule éroile
fixe don ne faci lemenr cdk d.:
to utes
les autre · ,
la
p ri nc ipale diffüul té confifle
a
s'affu rcr d'une
' toilc:
pot3r fervir de terme de comparaifon:
On ne peut détcrminer
l'afm¡Jion droite
d'u ne étoile
q ue par ctlk do foleil; car comme c'efl
le
foleil qui
parcourt
&
qui marque l'éclipt1que , de memt: que le
pomt équinoxial quand il traverle l'équareur, on ne
peo r reconnoitre les d1flances
a
ce point équinox ia l
que pa r le foleil qui en fourn it l'indicacion.
· D'un autre córé , l'on ne peut déterminer
l'afcenjion
droi
te du Jolci l que par lt: moyen de fa décl ina1Jon,
&
celle.cile
conclut de la hau teur méridienne ; ainfi
la hauteur du foleil
a
midi efl le poinr d'ou il fau t
partir. Suppofons qu'on ait obfervé a Paris la hau–
ttur du fokil,
&
qu'apres l'avo1 r corrigée par la ré–
fraél:ion
&
la parallaxe, on ait rrouvé cene hauteur
a
midi de 51
o
!0
1
;
on fai t que
la
hameur de'l'équa–
teu r n'efl que de 41
º
1
o'
a
Paris , on retranchera
!'une de l'autre ,
&
l'on aura
JOd
pour la décl inaifon
du foleil, ou la quantité dont il efl éloigné de l'éq ua–
teur. Alors d.1ns
le
trianglt: formé par l'écliptique,
l'~q uateur
&
le cercle de déclinailon , on connoit Je
pttit coté qui eíl:
la decli naifon du foleil .
&
l'angle
oppofé qui efl l'obliqu ité de
l'écliptique 23º
28
1 ,
il
cíl: aifé de trouver l'autre coté qui eft
l'ajm¡/ion droite
du foleil,
&
l'hypothenufe qui eft Ja lonuitude com-
ptée fur l'éclip11que.
0
Mais cctte métho e dépend, comme on l'a vu, de
ASC
la rffraé\ion de la parallaxe, de la hauteur de l'équa:
tt'.U r
&
de
l'obliquité de l'écliptique, car chacune
des erreurs qut: l'on commettroit dans un de ces élé–
mrns, inftueroir
&
en produiroi t une , deu x ou tro1s
fois pl us grande fur
l'llfw!fion droiu;
pour y remédicr,
il n'y a qo'a faire la meme opérarion deux fois en
fix mois, a la meme hauceur do fo le1 l , avant
&
apres
le fol!lice ;
l'c::rreur qui augmenroit
I'
ajcenjio11 drqite
avanr le fo lflice la diminue
néc~ffairemc::nt
apres ,
&
en prenant le milieu des deux réfultats , on a la vé.
rirable
t1jcenjion droite
du folcil, ayant égard au rnou.
vcment connu qu'il a du avoi r dans l'efpace de tems
qui s'efl écoulé d'une obfervation
a
l'autre: ce,mou–
vemen t méme eft facile
a
connoitre par l'obferv ation
faire le méme jou r de:: l'étoile dont on veur détermincr
la poGtion,
&
qu'on aura comparée avtc le foleil.
T e\ efl le fondement de::
la m¿thode que Flamfltd
&
la
Caille ont employée pour conílruirt: lcurs catalo–
gues d'étoiles ,
&
qui con!iftt:
a
comparcr deux fois
l'année le foleil
a
une étoile quand il paffe dans fon
parallele
&
qu'il a par conféq_uent la meme hauteur¡
c'efl en appliquant cettt: méthoi!e
a
des cencaines d'ob–
fervatio ns que M. de la Caille a trouvé
l'ajw1/io11 droilt
de Sirius Je
1
janv ier 17 50 de 98° 32
1 2 11
,
&
celle
de la Lyre 277º 7
1
4
9 :
ces pofitions fondamentalcs
ne diffcrent q11e de
5
a
6°
de celles que M.
le
Mon–
nier a affignées par des obfervations
&
des méthodcs
tres-difftrentes: cela fuffit pour montrer que! dégré
d'incenitude il y a dans la rnéthode
&
dans l'obfer–
vation des
ajcenjio11s droites.
J'ai die qu'une feule
afw¡/ion droite
donnoit ai íémC"nt
tou tes
les aurres; il ne faut qu'obferver la différen–
ce dts paífages au méridien, ou par des haureurs cor–
refpo ndantes , ou par une lunette méridienne,
&
con–
verm en dégrés
la di ffé rencé des
tems , on
au ra
celle des
afcenjions droites
des deux aflres obfervés :
on choi!i t pour tcrrne de comparaifon les étoi les les
plus bri llantes , telles que Sirios
&
la L yre, afin que
l'on puifft: les voir de jour
&
en rout tems de l'année
pour y comparer toutes les étoiles obfervées dans une
meme nuit
&
dont on vem avoir I'
afcenjio11 droite.
L 'afcenjion droite
du milieu du cit:I eft une chofe
done ks athonomes fe fervent trc!s-fouvent, fur-tollt
pour calculer les éclipfes par Je moycn do nonagé!i–
me, c'e!t
l'afcenjion droite
du point de l'éq uateur qui
fe
trouvt: dans le méridien; elle efl égale
a
la forn –
me de
l'afcenjion droite
do foleil
&
de l'angle horaire
ou du ccms vrai ré tuit en dégrés , ou
a
la fomme
dt: Ja longtrude moyenne
&
do tems moyen. ( M.
DE
I. A
LANDf.. )
ASC IOR, AsoR, AsuR
011
H AsuR ,'
(Mu.fique injl.
des
Héb.)
inflrumcnt des H t breux qui avoit dix cor–
dcs. D. Calmct
&
K1rcher veulent rous deux qlie ce
foil la meme chofe que la cithare '
&
rous deux luí
donncnt
le
meme nombre d.: ·cor 1es. D. Calmet ajoure
pourrnnc que dans les commenca¡res fur les pfeaurncs
amibués a S. J éróme on ne donne que fix cordes
a
la cithare ,
&
qut: dans l'építre
a
Dardanus , ami.
buét: auffi
as.
J éróme. on lui en donne vingt-quarre.
D. Calrnet donne
a
la cithare Oll
bafur
la figure de la
harpe commune d'aujourJ'hui ,
&
Kircher, quoiqu'il
air dit que le
bafttr
&
la cithare fon r le meme in–
flrument, en donne la figure qu'on trouve
jig.
2 ,
pi.
l
de Lttth. S11pplé111ent,
&
qu'il a rirée d'un ancien ma·
nulcric do Vadean , dont il a encore tiré les figures
do kinnor , du machul, do minnien
&
du nebele ou
nable.
f7o)eZ us mots dans ce Supplémt11I.
J e fuis tres-porté
a
croire que la figure de Kircher
efl la vraie,
1
º.
parce qu'dle eíl: aífcz Jimple pour
avoir exifté depois m:s.long.tems; 2º . parce qu'elle
djfferc peo du nebel
&
du kinnor,
&
qu'il me fcm·
ble probable qu'ancien nement , lorfqu'on ne
co~noif
foit encore que peu d'iníl rumens de genres vra1ment
dilférrns, on ait donné des noms particuliers
a
des
in–
ftrumens qui ne différoient au fond que par le nom·
bre
de
leurs cordes ou par ltura figures,
&
non par
















