
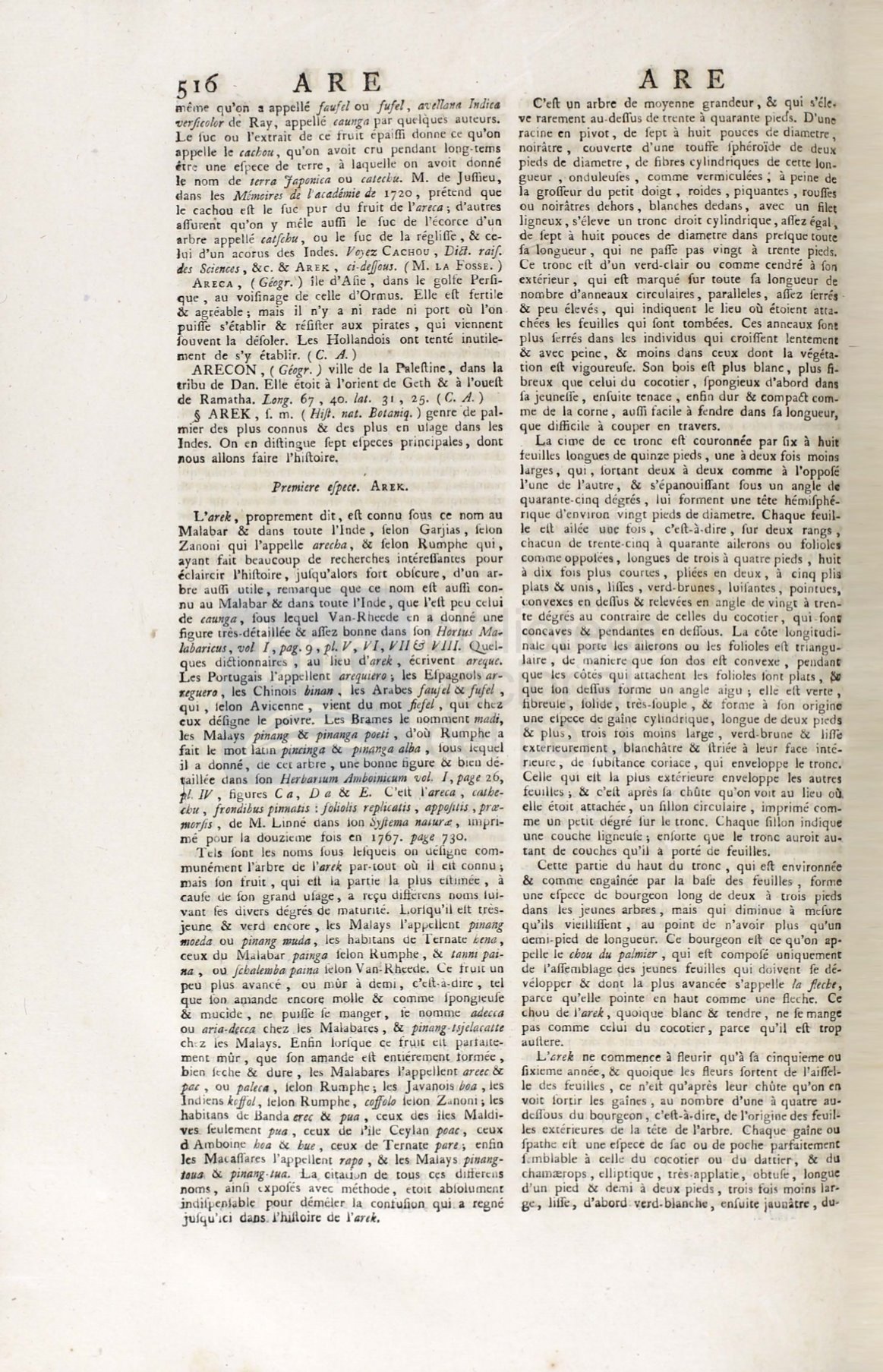
516
A R E
méme qu'C!n a appellé
f.aufel
ou
fufe!, a;·ella111t lHdica
"!Jerjicolor
de Ray, appelle
cou11g11
par que-lq ues auteurs.
Le
fue ou l'extrait de ce fruir épaiíli donne co: qu'on
appelle le
cachou,
qu'on avoit cru pendant
l?ng-tem~
•ue
une efpece de to:rre,
a
laqudle on avo1t donne
le nom de
terra Japo11icn
ou
caucbu.
M. de J wlfüu,
daos les
MémaireJ de l'11.cadémie d?
1720 , prétend que
le
cachou
dl:
le fue pur du fruir de
l'areca;
d'autres
alfu r.erit qu'on
y
méle auíli
le
fue de
}'é~orce d'~n
arbre appellé
catfchu,
ou le
fue
de la regl11fe_,
&
c~h1 i d'un acorus des Jodes.
/lo)'eZ
CACHOU ,
D1él.
raif.
Ju
Sciencu,
&c.
&
AR EK,
ci-dej/ouJ.
(M.
LA
FosSE.)
ARECA, (
Géogr.)
ile d'Mie, daos
le
golfe
Per~<¡Ue ,
au voifinage de celle d'Ormus. Elle eíl:
fertile
&
agréable; mais
il n'y a ni rade ni port ou l'on
puilfe s'éq1blir
&
réfiíl:er aux pi_rates , qui, v!ennent
fouvent la défoler. Les Hollando1s ont tente 10ut1le–
ment de s'y établir. (
C. A.
)
ARECON , (
Géogr. )
ville de la Paleíl:ine, daos la
tdbu de Dan. Elle étoit
a
l'orient de Geth
&
a
l'ouell:
de Ramatha.
Long.
67 , 40.
la/.
31 , 25.
(C.
_A.
)
..§
AREK, f. m. (
Hijl.
nat. Botaniq.)
genre de pal–
mier des plus connus
&
des plus en ulage daos les
Jndes. O.n en diíl:ingue frpt efpeces principales, done
11ous allons faire l'hiíl:oire.
Premiere efpm.
AuK.
L'arek,
proprement dit, eíl: connu fous ce nom au
Malabar
&
dans toute l'Inde , felon Garjids, fdon
Za non i qui l'appelle
arecha,
&
felon Rumphe qui,
ayant fait beaucoup de recherches
int~relfances
pour
éclaircir l'hiíl:oire, jufqu'alors fort obtcure, d'un ar–
bre auffi utile, remarque que ce nom eíl: aulli con–
nu au Malabar
&
dans toute l'Iode, que l'eíl: pt:u cdui
de
caunga,
fous lequel Van-Rheede en a ponné une:
fioure tres-détaillée
&
alfez bonne daos fon
HorJus Ma.
Jabaricus, vol.
I,
pag.
9 ,
~l.
V,
JI
I,
JI
JI
&
JI
]JI.
~ti
ques diél:ionnaircs , au Jieu
d'arek,
écrivent
areq11e.
Les Portugais J'appellent
arequiero;
les Efpagnols
ar–
tregum1,
les Chinois
binan
• ks arabes
Jau/el &fu/el
,
qui , felon Aviccnne, v1ent du mot
fiefel,
qui chez
eux défigne le poivre. Les Brames
le
nomn1ent
madi,
les Malays
pinang
&
pinangn poeti
, d'ot1
~umphe
a
faic le mot !aun
pincinga
&
pi11(lnga alba,
lous kq u:I
il a donné, de cet arbre , une bonne figure
&
b1rn de–
~aillée
dans fon
Herbar1um Amboiµicum vol.
I,
page
26,
pl.
JJI
,
figu res
Ca,
D
a
&
E.
C'e!t
.l'areca
,
wthe–
cbu
,
Jrondibus pinnatiJ
:
foliolis replicatiJ
,
appojztiJ
,
pr11!-
1t1orfis,
de M. L in né dans fon
Syftema natur,c,
impri–
mé pour la douzicme fo1s en 1767.
page
730.
Tds font les noms fous
ldquels on Jéf1gne com–
rnunémenc l'árbre de
l'arrk
par-tout
OLI
il ett connu;
mais fon fruit ' qui efl la partie la plus dtunée '
a
cau fe de fon grand ufage , a
n:~u
difterens noms lui–
vant fes divers dégrés d.: maturné. Lorlqu'il dt tres–
jeune
&
verd encere , les Matays l'appdlent
pi11ang
moeda
ou
pinang muda,
les. hab1 tans de Tt:rnate
hma ,
ceux du Malabar
pamga
felon Rumphe,
&
ltmm
pai-
11a,
ou
fcbalemba poma
[don Van-Rhcede. Ce fru1t un
pcu plus avan(é ' ou mu r
a
demi' c'cíl:-a- dirt: ' td
que fon ai;namk encore molle
&
commc:
fpong1eufe
&
mucide , ne pu1lfe
fe
manger,
fe
nomme
adecca
ou
aria-d.ecca
chez les
Malabarc~
,
&
pina11g-tf}elacatte
cht z les Malays. Enfin lorfque ce (nt1t
dl
partane–
ment mür, que fon amande eíl: entiérement tormée,
b ien ftche
&
dure ,
le>
Malabares l'appellent
arete
&
pa~,
ou
palu11,
felon Ru:nphe; les J avanois
boa ,
ks
Indiens
lcojfol ,
telon Rumphe,
coffolu
lclon z .noni ; les
h-abilans de Banda
erec
&
pua
, ceu x des ilcs Maldi–
ves.. ft:ulement
pua
, ceux de
J'ik
Ceylan
poac,
ec:ux
d Amboine
boa
&
bue
, ceux de Ternate
pare
; enfin
les Macaffares l'appd lent
rapo,
&
les Matays
pinang–
toutJ..
&
pi11ang-tua..
-La, citali,in de to11s ces d1tferrns
noms, ainfi <Xpofés avee méchode , etoit abfolument
jndifpenfa bl~
pour démeler la confufion qui. a regné
jufqu'1ci dans_1'h.Uloirt de
l'arelc.
ARE
C.::'eíl: un arbre de moyenne grandeur,
&
qui s'éle.
ve rarement au-delfus de trente
a
quarante pieds. D'uno
racine en pivot' de ft:pc
a
huit po¡,¡ ces de diametre
noiratre, couvcrte d'une
touffe fphérolde de
deu~
pieds de diametre, de libres cylindriques de cette Jon–
gueur , onduleufes , eomme vermiculées ;
a
peine de
la grolfeur du petit doigt , roides , piquantes , rouffes
ou noiratres dehors, bl anches dedans, avec un filet
ligneux, s'éleve un tronc droit cy lindrique, affez égal,
de fept
a
huit pouces de diametre dans prclque toutc
fa
longuem , qui ne palfe pas vingt
a
trence picds.
Ce tronc ell: d'un verd-clair ou comme cendré
a
fon
extérieur, qui ell: marqué fur teute
fa
longueur de
nombre d'anneaux eirculaires, paralleles , alfez ferrés .
&
peu élevés , qui indiqucnt le lieu oii étoic:nc atea.
chées les feuilles qui font tombées. Ces anneaux font
plus ferrés daos les individus qui croilfent lentement
&
avec peine,
&
moins daos ccux dont la végéta·
tion eíl: vigoureufe. Son Qois eíl: plus blanc, plus
fi–
breux que celui du cocotier, fpongieux d'abord dans
fa jeunelfe, enfuite tenace, enfin dur
&
compaét com–
me de la come , au íli facile
a
fendre dans
fa
longueur
que difficilt
a
couper en travers.
•
La cime de: ce tronc
en:·
couronnéc par fix
a
huit
teuillts longues de quinze pieds' une
a
deux fois moins
larges ' qu i, fortant deux
a
deux commc
a
l'oppofé
)' une de l'autre ,
&
s'épanouiffanc fous un angle de
quarante-cinq dégrés, lui forment une tete hémifphé–
nq ue d'env1ron vingt pieds de diametre. Chaquc: feuil–
le ell ailée u
ui;
fois , c'eíl:-a-dire , fur deux rangs ,
chacun de: trente-cinq
a
q uarante ailerons ou folioles
cornme oppolees, longues de rrois
a
quatre pieds , huit
a
dix fo1s plus courtes ' pliées en deux'
a
cinq plis
plats
&
unis, lilfes, verd-brunes, lu ifantcs, pointues,
<:onvext:s en delfus
&
relevées en angle de vingt
a
m:n–
te dégrés au contraire de celles du cococier, qui -fona
concaves
&
pendantes en delfous. La cote: lonoi tudi–
nale qui porte ks ailerons ou ks folioles eíl: rr'iangu–
laire, de: maniere que fon dos ell: convexe , pendant
que ks cótés qui arcachent k s folioles font plats,
~
c¡uc:: Ion ddfus forme:: un angle aigu ; elle:: eíl: v-erce,
fibn:ulc::, fohde, tres-fouple,
&
forme
a
fon orioinc
une elpecc:
d~
gai1_1e cyl_mdrique, longue de deux p'ieds
& plus , tro1s to1s moms
large , verd- bru ne
&
Jilfo
txceneureme.nt' blanchatre
&
ll:riée
a
leur face inté–
neure, de fubíl:anee coriace, qui enveloppe le tronc.
Celle qui
tll:
la plus extérieure enveloppe les autres
feuilks ;
&
c'eíl: aprcs
fa
chúte qu 'on vo1t au
Ji~u
ou
elle:: écoit actacbée, un fillon circulaire, imprimé com–
me un pc:tit dégré fur le cronc. Cheque fillon indique
une eouche ligneufe; enforte que le tronc auroic au–
tant de cou ches qu'il a porté de feuilles.
Cerce panie du hauc du tronc , qui eíl: env ironnée
&
commc:: engainée par Ja bafe des feuilles , forme
une efpece de bourgeon
long de deux
a
trois pieds
dans k s jeunes arbres, mais qui diminue
a
mcfurc
qu' ils vieillilfc:nt , au point de:: n'avoir plus qu'un
oemi-pied de longueur. Ce bourgeon elt ce qu'on ap·
pelle k
cbou du palmier,
qui eíl: compofé un iq uement
de l'aí(emblage pes jeunes feu illes qui doi vent fe dé·
vélopper
&
dont la plus avancée s'appdle
la jlecbt,
parce qu'dle pointe en hauc comme une fleche. Ce
chuu de
l'arek,
quoi que blanc
&
cendre , ne
fe
mange
pas comme cdui du cocotier, parce qu'il eíl: trop
auílere.
L 'ueh
ne commence
a
lleurir qu'a
fá
cinqu ieme ou
fixieme annéc,
&
quoique les lleurs fortent de:: l'ailfel–
le _des_ frui llcs , ce n'e1t qu'apres leur chúte qu'on en
vo1c forcir les gaines , au nombre d'une
a
quatre au·
dclfous du bourgeon, c'e-íl:-a-dire, de )'origine des ftu il–
lt:s extérieu res de la tete de l'arbre. Chaque ga1ne ou
fpathe eíl: une efpece de fac ou de poche parfaicement
f, mblable
a
celk du cocotier ou du datcier-,
&
du
charna:rops, elliptique , tres -applatie , obtufe , Jonguc
d'un pied
&
demi
a
deu x pieds' trois fois moins lar–
ge, lilTe, d'abord vcrd- blanche , enfuite jaunacrc:, du-
















