
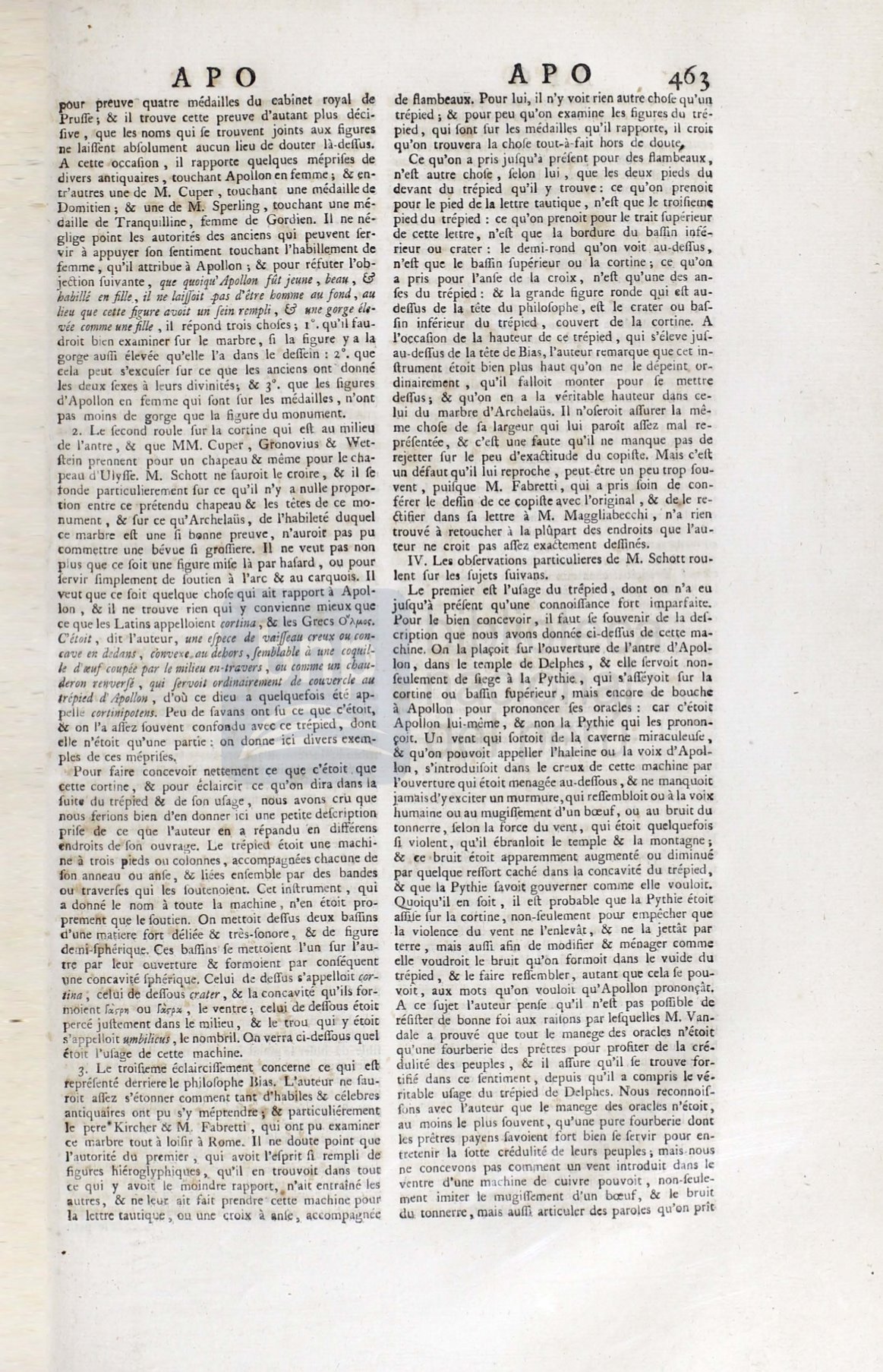
APO
pour preuve- quatre médailles du cabinet royal de·
Prulfe;
&
il trouve cette preuve d'autant plus déci.
five, que les noms qui fe trou vent joints aux figures
11e laiífent abfolument aucun lieu de doucer la-ddfus.
A cette occafion , il rapporte quelques méprifes de
divers anciquaires, touchant Apollon en femme;
&
en·
t r'aucres u11e de M. Cuper , wuchant une médaille de
Domitien ;
&
une de M. Sperling , touchanc une mé·
daille cde Tranqmlline, femrne de 9ordien.
11
ne né·
glige point les autorités des anciens qui peuvent fer·
vir
a
appuyer fon fentiment touchant l'habille_ment de
frmme, qu'il attribue
a
Apollon ;
&
pour réfuter l'ob·
jeél:ion fuivante,
que quoiq11'Apollon
fut
je1111e, bea11 ,
&
habillé en fille_, il ne laijfoit .pas d'étre homme au fo11d, au
/ieu que cette
jgrire
avoit un Jein rcmpli
,
&
1111e gorge él1·
vée comme unefille
,
il répond trois chafes;
1
º.
qu' il fau–
droit bien examiner fur
le
rnarbre, fi
la figure
y
a la
gorge aum élevée qu'elle l'a dans le delfein
!
2°.
qqe
cela peut s'excufer fur ce que les anciens ont · donné
ks deux
fexe~
a leurs divinités;
&
3°. que les figures
d'Apollon en femme qui font fur les médailles, n'ont
pas moi ns de gorge que la figure du monument.
2.
Le fecond roule fur la conine qui eíl: au rnilieu
de l'antre,
&
que MM. Cuper, Gronovius & Wet–
íl:ei n pn:nnen c pour un chapeau
&
meme pour
le
cha–
peau d'Ulylfe. M. Schott ne fauroi t le croire,
&
il
fe
t?nde
panic ulier~menc
fur ce qu'il n'y a nulle propor–
t1on entre ce préccndu chapeau & les teces de ce mo-
11umcnt,
&
fur ce qu'Archdaüs, de l'hahileté duque!
ce marbre eíl: une fi b<inne preqve, n'auroir pas pu
comm~ttre
unr; bévue fi groíliere.
11
ne vq1t pas non
p lus que ce foit une qgure mifc; la par hafard,
01,1
_pour
fervir fimplement de foutien
a
!'are & au
carquo1~.
Il
veqt que ce foit quelque chofe qui ait rapport a Apol–
lon ,
&
il ne trouve rien qu i
y
convienne mieux que
ce que les Latins a_ppelloient
corti11a ,
&
les Grecs
o">.f-or.
C étoit ,
die l'a uteu r,
une efpece de vaif!eau creux ou con–
cave en
aedans '
clmvexe. att dehors ,Jemblable
a
une coquil–
le d'a:uf coupée par le milieu m-11·avers, ou comme un cbau–
f.eron re11verfé
,
qui ftrvoit ordi11airemmt de cotwercle au
lrépied d'dpollon,
d'ou ce dieu a quelquefois été ap–
pelle
cortinipote11s.
Pc:u de favans ont fu ce que c'étoit,
&
on l'a alfez fouvent confondu avec ce trépied, don.t
elle n'étoit qu'une parcie : on donne ici divers exern–
ples de ces
méprife~
Pour faire concevoit: Mttement i;e que c'étoit .que
cette cortine,
&
pour
~clairci(
ce qu'on dira dans la.
fuitt du rrépied & de fo.n u.fage" nous avons cru que
11ous ferions bien d'en donner ici une petice defcri pt1on–
prife de ce que l'auteur en. a répandu 'en
différen~
endroits de fon ouvrage. Le trépiect étoit une machi–
ne
a
trois pieds ou colonnes, accompagl).ées chacun,e de
fon anneau ou anfe,
&
liées enfemble par des bandes
ou traverfes qui les fouren.ojent. Cec iníl:rument, qui
a dohné le nom a toure la machine , n'en étoit pro–
premeht qu,e le foutien. On mettoit de!fus deux baffi.ns
d'une r.oaüere fort déliée
&
tres-fonore"
&
de figure
demi-fphériqu.e. Ces ballins fe mettoie!lt l'un fur l'au–
tre par leur o.uverture
&
formoien.t pa
r conf.équent
\)ne
concavi~é
fphé;.íq_qe. Celui de deffus ¡'appello.it
(Or–
ti11a,
celui de delfous
{rat
er , & la
concavi~é
qu'ils for–
moienr
fi>pn
ou
fa>p. ,
le
ven.t.re;celuj de de!fous étoit
percé ju!tement dans le milieu,
&
le trou.qui
y
é~oit
~·appdloit
JVnbiliaus,
le
nombril.
Qn
verra.ci-ddfous que!
éroit l'ufage de cette machine.
3. Le troífü:me éclairci!femeot. concerne ce qui e!b
tepréfcnté dérriere le phjlofophe Bias. L'auteur ne fau–
roic a!fez s'étonner comment tant d'habiles
&
célebres
antiquai
res onc pu s'y
~épr.endre;
&
particuliérement:
le
pere•
Kirch.er&
M,.
Pabretti , qui onc pu, examiner
ce marbre tout
aloifir a Rome. Il ne doute point q_ue
l'autorité du prcmier, qui avoit l'efprit
fi
rempli de
fi gures
hiéroglyph)qt~es
,_ qu'il en trouvoit
d~ns
tout
ce qui y ayoit
'le
inojndre rap¡Dort, n'ait encrainé les
:nttres, & ne l<;ut ait fait prendre · cene machi ne pour
la leme tamiq9e " ou une <;roix
a
¡¡ni~, accompagné~
A P O
463
de flambeaui. Pour luí, il n'y voic ríen aut(e chofe qu'l1q
trépied ;
&
pour peu qu'on exa!TlÍpe les figurns du tré–
pied, qui ÍOQt fur les médaílks qu'il rapporte, il croit
qu'on trouvera la chofe tout-a-fait hors de
douce~
Ce qu'on a pris jufqu'á
préfen~
pour des fla.mbeaux,
n'eíl: autre chofe , felon lui , que k s c;leux pieds du
devant du trépíed qu'il y trouve : ce qu'on
prenoi~
po\Jr
le
píed de la leme tautique, n'eíl: que
le
troilie111c:
pieq du trépied : ce qu'on prenoit pour le trait fupérieur
de cette lettre, n'eíl: que la bordure du baffin il)fé–
ríeur ou crater : le dcmi-rond qu'on voit a.u-delfus,
n'eft que le bamn fupérieur ou la cortine; ce qu'on
a pris pour l'anfe de la croix, n'eíl: qu'une <;les an–
fes du trépied : & la grande figure ronde q!)i €íl: au–
deífus de la tete du philofophe , eíl:
le crater ou baf–
fin ínférieur du trépied , couvert de la cortine. A
l'occafion de la hauteur de ce trépied, qui s'éleve juf–
au-delfus de la tete de Bias, l'ameur remarque que cet in–
íl:rurnent étoit bien plus haut qu'on ne Je dépeint or–
dinairement , qu'il
fa lloit monter pour
fe mettre
de(fus ;
&
qu'on en a la véritable hauteur dans ce–
lµi du
ma~bre
d'Archelaüs. Il n'ofcroit alfurer la me–
me chofe de fa largeur qui luí p.arolt alft:z mal re–
préfentée,
&
c'eíl; une fauce qu'il ne manque pas de
rejecter fur le peu d'exaébitude du copiíl:e. Mais c'eíl;
l1n défaut qu'il luí reproche ,
pe~t-etre
un peu trop fou–
vent, puifque M. Fabretti, qui a pris foin de con–
férer
\e
deffin 'de ce copitle a,vec !'original ,
&
de le re–
~i~er
dans (a lettre
a
M. Magglíabecchi , ' n'a rien
trouvé
a
retoucher
:i
la
pl~part
des endroits que l'au–
teur ne croit pas alfez exaél:ement dellinés.
IV.
Lea obfervations particulieres de M. SGhott rou.
lent fur les fujets fuivaos.
'
Le premier eíl: l
'ufage du trc!pied, dont oa n'a eu
jufqu'a préfent qu'
u.necon.noilfance fon
imparfai te.
fo\lr le bien concevoir, il faut fe fouvenir de la def–
cription que nous avons donnée ci-delfus de cet\e ma–
chine. On la pla1=oit fur
l'ouv~rture
de l'antre d'Apoi.
lon, dans le temple de Delphes ,
&
elle f'ervoí t non.
feulement de fiege
a
la Pythie. , qui s'afilyoit fur la
cortíne ou, bafün fupérieur , inais encare de bou.che
a
Apollon pour prononcer (es oracles : car c'étoit
Apollon lui -meme,
&
non la Pythie qui les p.ronon–
¡:oic. Un vent qll:i fortoit de la.
cav~rn.e
miraculeufc:,
&
qu'on pouvojr appeller l'haleine ou la voix d'Apol–
~on,
s'introduifoit dans le cr ux, de cette machine par
l'ouverture qui étoit menagée a.u-de!fous,
&
n.e manquoit
iamaisd.'yexciter u.n murmure,qui relfembloít ou
a
la voíx
humai ne ou au Il\Ugill,"em;:nt d'un bceuf, ou au bmic du
tonnerre,_.felon la force du v.en.t , qu i étoit quelquefois
Ii
violent, qu'il ébranloit le temple
&
la montagne;
&
ce bruit étoit apparemment augn:ienté ou diminué
par quelque relfort caché dans la concavité du trépied ,
&
q,ue la Pythie lavoit gouvcrner comme elle vouloit.
Q.Eoiqu'il en foit, íl eíl: probable que la Pythie éroitt
affi.fefur la cohine, non-feulemenr pow ernpecher que
·
laviolence du vent ne l'enleva_c ,
&
ne la jectat par
terre, mais aufft afin de modifier
&
ménag,er comme
elle voudroit
le
bruit qu'on formoit dan.s le vuide du
trél?ied ,,
&
le faire relfcmbler, amane que cela
fe
pou–
voi t , aux mots q.u'on vouloít qu' Apollon pronon1=ar.
A ce
fu
jet l'auteur penfe qu'il n'eCt pas pollible de
réliíl:er de bonne foi aux raifons par lefquelles M. Van.
dale a prouvé que tout le manege des oracles n'étoit
qu'u ne fourberie Cles prt cres pour proliter de la eré.
dulité des peuples ,
&
il aífure qu'il fe
trouve for–
tifi.é dans ce fentiment, depuis qu'il a compris levé–
ricable ufage du trépied de Dclphes. Nous r<lconnoif–
foiis avec i'auteur que le manege des oracles n'éroit,
au moins le plus fouvent, qu'une pure fourberie dont
les pretres payens favoient fort bien fe forvir pou-r en–
frtteni r la fotte crédulité de leurs peuples ; mais,nous
ne concevons pas com¡nent
u.n
venc introduit dans
le
ventre d'une machine de cuivre pouvoit ,
non-feul~menr imirer le
mugi!f~ment
d'un ba:uf,
&
le
bru1t
du, tonnerre , mais aufü articuler des paroles qu'on prlt
















