
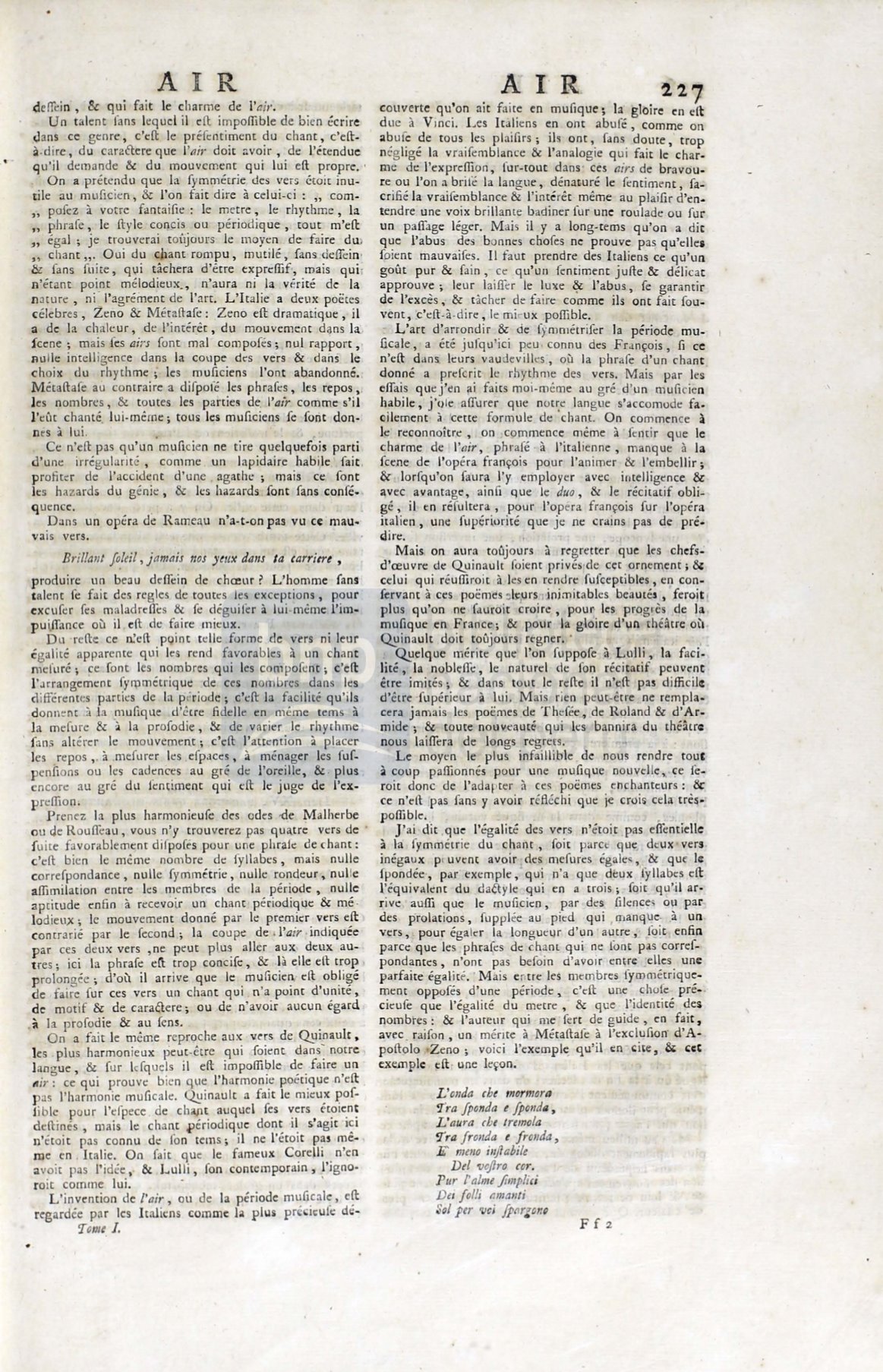
AIR
d effein ,
&
qui fa it le charme de
l'air.
Un talent fa ns lequcl il
dl
impoffible de bien écrire
dans ce gc:n re, c'dl: le prffcntiment du chant, c'efr–
?l-dire, du carzél:ere que
l'aii'
doit avoir, de l'étendue
c¡u'il dema nde
&
du mouv ement qui luí e!l propre. ·
On a p rétendu que
la
fymmétrie des vers étoit inu–
tile au nrnficien ,
&
l'on fait dire a celui-ci : ,, com–
" pofez a votre fantaifie : le metre, le rhythme , la
,, p hrafc , le fryle concis ou périoélique , tout m'eíl:
,, égal ; je trouverai toíijou1•s le moym de fa ire du;
,, cliant ,,. Oui du chant rompu, mutilé , fan s deffe in •
&
fa ns fo ite ,
q~1i
tachera d'étre exprdiif, mais qui1
n'écant poi_nt mélod ieux. , n'aura ni la vérité de la
m tu re , ni_l'agréinent de
l'art.
L'ltalie a de\lX poetes
céleb res , Z eno
&
Mérafrafe : Zeno eft dramatique, il
a de la cha\c ur, de l'intér_et, du mouvemcnt
d~ ns
la,
fcone ; mais fes
1úi·s
font mal compofés; nul rapport , .
nu lle intell igcnce dans la coupe des vers
&
daos le
choix du rhythme ;· les muficiens l'ont abandonné.
M étaíl:afe au concraire a difpoié les phrafes, les repos ,.
les nombres ,
&
toutes les panies de, l'aii- comrne s'il
l'eC\t chanté. lu i-mecne; taus les muficiens
fe
forit don-
nés
a
luí.
.
'
Ce n'eíl: pas qu'un muítcien ne tire quelquefois partí
d'une irrégu lari té , comme un lapidaire habile fait .
profitcr de l'accident d'une agathc ; mais ce font
les hazards du génie ,
&
les hazards font fans confé.
q uencc.
.
Da
ns un opéra de R ameau n'a·t-on pas vu
ce mau–
vais vers.
Brillan/ Jo_leil , j amaís nos
yeux
dans ta carritre
,
produire un beau ddfein de chel!ur? Uhomme fans ·
t alent fe fait des regles de romc:s les excc:ptions , pour
excufer fes maladreffes
&
fe
déguifer
a
Jui -méme l'im–
pu \ffance ou il eíl: de fa ire mic:ux.
D u ·refte ce U:eíl: point telle forme de vers ni leur
égalité apparente qu i les rend favorables
a
un chant
mefuré ; re fon t les nombres qui les compofent; c'eíl:
l'arrangemc:nt fy fll métrique de ces nombres dans les
d ifférentes parties de la
p~riode;
c'eíl: la fac ilité qu'ils
donnent
a
Ja muúq ue d'etre fidelle en méine tems
a
Ja rnefure
&
°?1
la profod ie ,
&
de varier le rhythme
' fon$ alcércr le mou vement ; c'dt l'attention
a
placer
les repos ,.
a
.meforer !t:s .efp accs'
¡¡
ménager les
fuí–
pen.iions oll les cadenC-es au gré de: l'oreille,
& .
plus
encare au g ré du li::ntiment qui eft k jugc: de l'ex–
preffion .
Prenez la plus harmonieufe des odes -de M alherbe
ou de Rouffeau, vous n'y trouverez pas qu ittre vc:rs de
fu ire favo rablernent difpo[és pou r une phrak de chant:
c'eíl: bien le meme nombre de fy llabes ' mais nulle
correfpondance , nulle fymmétrie, nulle rondeur, nul le
affimilation entre les membrcs de la périodc , nulle
apti tude en fi n
a
recevoir un ,chant périodi9llc:
&
mé ·
lodiet1;c; le mouvement doone par
lt:
prea11c:r vers eíl:
contrarié par le feco nd; la coupe de
d 'air
-indiquée
p ar ces deux vers ,ne peut
pl u~
aller
a~)(·
deux au–
t res; ici la phrafe di: trop conc1fe,
&
~a
elle efr
t~o~
•
p rolongée ; d'ou il arrive que le .
m~fic1e~
cíl: ,ºb!1!?e
de faire fur ces vers un chant q u1 n a potnt d u
ni
te,
de motlf
&
de caraélere; ou .de n'avoir aucun égard
,11
la profod ie
&
au fens.
.
On a fai t
le
meme reproche aux vers de
~rnault,
les plus harrnonie ux ¡:ieut-etre qui foit:nt
dans~
notre .
lano-ue
&
fur kfquels il eíl:
i mpoffibl~
de f aire un
11ir
~
ce' q ui prouve bien qll: l' harmoni_e poéri_que .n'eíl:
p as l' harmonie muficale.
~inau lt
a fa1 t le mteu;c I:'of–
lible pour l'dpece de chant auquel fes
~ers , e1?1c_n~
ddtinés mais le chant .périodique dont ·11 s ag1t 1c1
n'étoi t pas connu de fo n tems ; il ne l'étoit pas me–
me en . I rnlie. On fait que le fameux Corelli n'en
avoit pas l'idée ,
&
Lulli , fon contemporain, l'igno-
roit comme lui.
·
'
L 'in vcntion de
l'ai1·,
ou de la période
m~fi.cal:, e~
regardée par les I tafans comme la plus pr1:c1•ule de–
'Iome.
J.
A
1
R.
'.127
•
•
¡; .
li
1
couverte qu on a1t 1a1te en mu 1que; a· gloire en
e!t
d ue
a
Vinci. L es Italiens en ont abu fé , comme on
;ibufe de tous k s plaifirs ; ils ont, fans doute ,' trap
négligé la vraifemb lance
&
l'analogie q ui fait le char–
me de
l'exprdiion, fur-tout dans · ces
airs
de bravou–
te ou l'on
a
brile la lang ue, dénaturé le fentiment, fa–
crifié la vraifemblance
&
l' intéret meme au plaifir d'en–
tendre une voix brillante bad iner fur une rolllade ou fur
un paffage léger. Mais il
y
a long-tems qu'on a die
q~e
l'abus ?es bonnes chofes ne prouve pas qu'dlc:a
fo1ent mauva1fes .
11
faut prendre des ltaliens ce qu'un
gout pur
&
fain , ce qu'un fc ntiment jufte
&
dél icat
approuve ; !eur lailfer
le
luxe
~
l'abus , fe garantir
de l'exces ,
&
racher de faire comme ils ont fait fou–
vent, 'c'dl:-a-di re, le mir ux poffible.
L'art d'arrondir
&
de fymmécrifrr la période mu- 1
(iq le, a été j ufq u'ici peu. connu dc:s
Fran~ois
,
[¡
ce
n'e(t dans kurs vaudevillc:s , ou la phrafe d'un rhant
donné a preferir
le
rhythme des vers. ·Mais par les
elTais qlle j'en ai faics moi- méme au gré d' un muficien
habile, j'ole alTurer que notrc langue s' accomude
fa–
<dlement
a
'cene fo rmule de 'chan.t. On commence
¡¡
k
reoonnoitr.e , on .commence meme
a
ft:ntir q ue le
charme de
l'air,
phrafé ·
·¡¡
l' ital ienne , manque a la
feme de l'op éra fran\:ois pour l'animer
&
l'embellir;
&
lorfqu'on faura l:y employer avec intelligence
&
:\Vec avantage, ainfi que le
duo ,
&
Je récitatif obli–
gé,
il
rn
réfultera , pour l'opéra
fra n~ois
fur l'opéra
icalien , une fupériurité que je ne crains pas de pré-
din:.
,
. ,
Mais, on aura toujours
a
regretter que les chefs.:
d'reuvrc: de
~inault
foient privésrde cet ornement;
&
celui qui réuffiroit a les en rendre fufceptibles, e? con–
fervant a ces poemes :ill:ws ·11nimitables beautés, ferojt 1
plus qu'on ne 'fauroit croire, pout' les
pFqgr.esde la
mufique en Fraoce;
&
polir la gfoire 4'un thé&cre
0\1.
~inault
doit toujours rfgner. ·
,
~elque
mérite que l'on fuppofe
a.
Lulli, la faci–
lité , la nobkffc:, le naturel de: fon récitatif peuvent
ctre imicés;
&
daos tollt
le
rdl:e il 11'¡:¡ft pas d ifficile
d'etre ·fupérieur
a
lui . M ais ríen peut-etre ne rempla–
cera jamais les poemes de Thcfée_, de Roland
&
d' Ar–
mide;
&
toute nou11eauté qui ks bannira du théam:
nous lailTera de lo.ngs
regr~ts.
Le moyen le plus infaillible de nous rendre touc
a
COL1p paffionn és pour une
~nufique
DOll yd le,,
~e
fe.
roit done de l'adapter
a
ce~
poernes ehchanti:¡urs :
&
ce n'eíl: pas fans y avoir réfiéchi que je crois cela
tre~-.
poffiblc:. _
,
J'ai <lit .que l'égalité des vers n'étoit ,pas effentíelle
a
la fymmécrie du chant , foit parce q ue, dcux vers
inégaux p1uvenc avoir des mefures égab ,
&
quf le
fpondée·, par exernple ,' qui n'a q ue d!:ux 'fyll abt:s eíl:
l'équivalent du dalty le qui en a trois; foit qu' il ar–
rive auffi que le mu ficicn, par des file nces
0\1
par
des prolatio;is, fop plée au p ic:d qui , manque: a un
vers, pour egakr la longut l)r d' un autre, f91 t enfin
p arce que les phr.a(es de chanL c¡ui ne fo nt pas corref–
pondantc:s, n'ont pas befoi n d'avoir cnm: _elles une
p arfaite égalité. · M ais entre les mrn1bres tymmérrique–
menc oppofés d'unc: période , c'eft une chofe: pré-.
cicufe que l'égalité du metre ,
&
que l'ideotité des
nombtes:
&
l'aurem qui me fert de guide , en fait,
avec raifon un mértte
a
M étaíl:afe a l'c:xclulion· d'A–
poíl:~lo Ze~o
; voici
l'exempl~
qu'il <!n c:ite ,
&
ccc
c.xc:;nple eft· une le\:on.
L 'o11da che mormorn
'Ira fponda e fponda
,
L'aura che tremola
<Ira fronda
e
fro11da,
Ji.'
mmo
i11jlabí!e
Del vojlro
cor.
P111·
/'
alme jimplici
Dei
f ol!i ama11ti
Sol per vci
JP
rgono
Ffz
















