
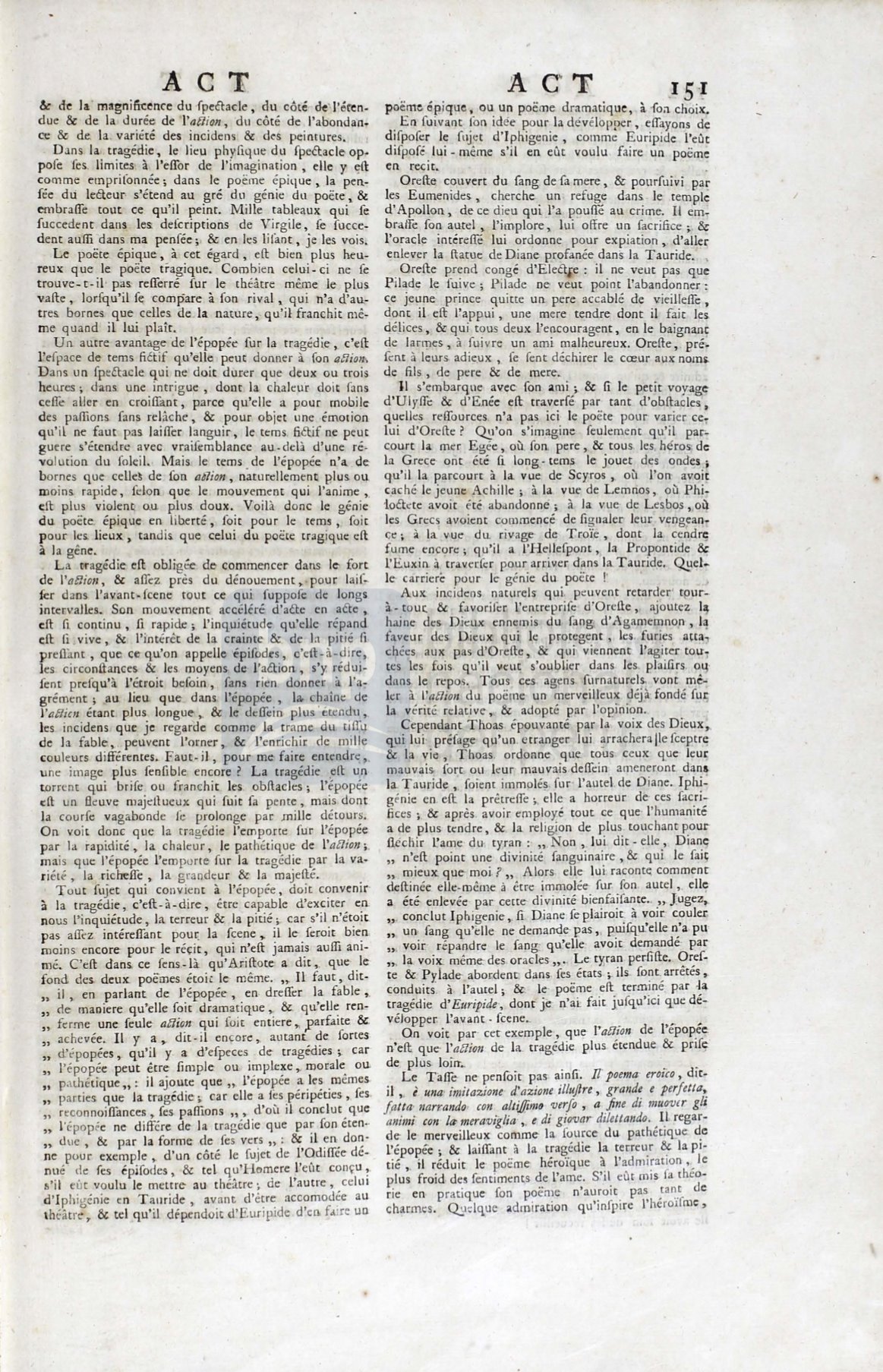
ACT
&
d-c la. magniñcence du -fpeél:acle' du coté de· J•ércn–
due
&
de la durée de
l'aélion,
du coté de l'abondan–
c.-e
&
de. la. variété des incidtms
&
des peintures.
D ans la tragédie, le lirn phylique du fpeélacle op–
pofe fes. limites¡ a l'elfor de l'imagination ' elle
y
eíl:
c?mme
emprifon~ée;
dans
le_ poeme.
~pique,
la pen–
foe du leéteur· s'etend au gre dll genie dti poece,
&
embralfe
tout ce qu' il peint. Mille tableaux qui fe
fuccedtnt dans les. defcriptions de Virgile,
fe
fucce–
dent auffi dans ma penfée;
&.
en ks lilant, je les vais,
Le poece épiq.lle,
a
cet égard , eíl: bien plus heu–
reuic
que
le
pofae tfagique. Cambien celui- ci ne fe
trouve- t-il · pas relforré fur le cbéatre méme le plus
vaíl:e, lorf-qu'il
fe:;
·com¡5.are
a
fon
rival • qui n'a d'au–
tres. bornes que celles. de la. nature, qu'il franchit mé–
me
quand il lui plait,
Un.
autre avantage de l'épopée fur la trag6die , c'eíl:
l'efpace de tems fiétif qu'ello peut donner
a
fon
atlion,
Dans un fpeél:acle qui ne doit du.rer que deux ou trois
heures ; c.lans une
intrigo~
, done la chaletfr doit fans
celfe allcr en croiliant, parce qu'elle a pour rnobilc–
des paffions fans relache,
&
pour obijet une -émotion.
qu'il ne faut pas. lailfer languir,
le
t~ms.
fiél:.if ne peut
guere s'étendre avec vraifemblance au-dela d'une ré–
volution du foleil, Mais le tems . de l'épopée n'a. de
bornes que
celle~
de
fon
M7ion,
narn rellement P.lus ou
moins. rapide , fdon que
le
mouvemeot qui !'anime '·
e.íl:plus
vioJen~
o.u plus doux. Voila done le oénie
du poete. épique en liberté , foit pour le
tems ,"' foit
pooc les lieux., candis. c¡ue celui du pofae cragique eíl:
a
la gene,
L a tragédie eíl: obJigée- de comrnencer dans le fort
de
l'atJio11,
&
affez pres du dénouernent, pour laií–
íer
daos l'avant- fcene tour ce qui fuppoíe de longs
intervaJles, Son rno.uvemeot. accéléré d.'aél:e en aéte ,,
c.íl:íi cootinu ,
fi
rapidt: ; l'ioqujétude qu'elle répaod
eíl:
!i .
viv·e,
&
l'iotéret de la craime
&
de la pi cié li,
preffiint, que
Cfr
qu'on appelle 'épifodes, c'cft-a- dire,
les circonfrances
&
les moyens, de l'aél:ion., s'y. rédui–
fent preíqu'a l'éuoit bofoin' fans rien donnec
al'a7
grément ; au lieu que dans l
'épop.ée,
la.
chai.nede
l'aélirn
étant plus longue ,.
&
l!! deffein plus ·étend\1,
les incidens que je regarae c.omme la trame du ti!fu
de la fable, peuvent l'orner,
&
l'encichic de mi ll e
coulel:Hs difffaentes. Faut- il, pour
mi:-
faire entt"ndrcc ,.
une imagc plus feofible encere
2
La tragédie
,c~!t
un
torrent qui bri(e
Oll
franchit les oofracles; l'épopée
dl:
un fleuve majct1ueux qui fuit fa pente, mais dont
la courfo vagabonde
fo
prolonge par ,mille détoors.
On voit done que la tragéd ie l'emporce fur l'épopée
p ar la rapidité, la chaleur, le pathétique de
l'atlion
;.
mais que l'épopée l'empurce fur la tragédie par la va–
riété , la richdfe , la gra ndeur
&
la majefté.
Tout fojet qui conviene a l'épopée, doit convenir·
a
la tragédie' c'eft-a -dire, étre capable d'exciter en.
nous l'i nquiétude, la terreur
&
la pitié ; car s'il n'étoit
pas alfez intérelfant pou[! la fcene,. il
le
íeroi~
bien
moi ns encore· pour le ré1=it, q_ui 11'.eíl: jamais auffi ani–
mé.
C'eíl: dans. ce fens- la. qu'A.riftote a die,. qut:
le
fond des del!lc. poemes étoic le
mC.me.,.
Il
faut, dit–
,, il , en parlant de l'épopée , en. dreífer
la fable ,,
,, de maniere qu'elle foir dramatique,.
&
qu,'elle reo–
" forme une feule
atlion
qui foit entiere,. .Parfaite
&.
,, achevée.
Il
y
a ..
dit. il oncore, autant de. forces
,, d'épopées, qu'il y
a
d'eípeces de tragédies.;. car
,, l'épopée peut étre limpie ou impl.exe,. monale ou.
,, palhétique,,: il ajoute que ,, l'épopée a les mfanes
,, parties que Ja traoédie; car elle a fos .péripéties, fes.
reconnoiffirnces
f~s
paffions ,, , d'ot1 il conclut que
,
li
'
,. l'épop€c ne différe de la trag_édie que par on eten··
,, duc ,
&
par la forme de fes ver_s ,, :
&,
il
~n. do~ne pour exemple, d'un cote le
fuJCC
de 1Od1ífee de–
nué de fes épifodes,
&
tel qu'Homere l'eilt
con~u
?'
s'il eút voulu le mettre au thé:i.tre; áe l'autre, cellll
d'Iphigénie rn T amide , avant d'etre acoomodée au
\ héatre,
&
tel qu'il drp.endoit rl'E uripide d'eo. f.ure un
A C
'F
.15
.¡
poéimeógique, ou un poeme dramatique, a.fea
choi~.
. En fuivant
~on i~ée ~our_
la dévélopper, elfayons de
d1fpofer le ÍllJet d Iphigenie , comme Euripide l'eut
difpofé luí -
me.mes'il en eut voulu faire un poeme
en recit,
Oreft:e couvert du fang de
fa
mere,
&
pourfuivi
¡:¡a~
les Eumenides,, cherche un refuge dans. le temple
d'
Apollon, de ce dieu qui .l'a pou!fé au crime.
11
emr
bralfe fon aucel , !'implore, lui offre un facrifice ;
&
l'oracle intére(fé lui ordonne pour expiation ,
d'alle~
enlever la !latue de Diane profanée dans la Tauride.. ,
. Oreíl:e prend congé d'Eleél:¡e : il ne veuc pas que
Ptlade le íuive; Pi lade ne veut point l'abandonner:
ce jeun.e prince quitte un pere accablé de vieillelfe
done il
dl:
l~appui
, une mere tendre dont il fait le;
délices,
&
q_ui t?us deux
l'e~couragent,
en le baignant
de larrpes, a íu1 vre un ami rnalheureux. Oreíle, pré.
[en.e
a
lcurs
adie.ux, fe Cent déchirer le cre_ur aux noim.
de fils , de pere
&de mere..
11
s'embarque- avec- fon ami ;.
&
u
le petit vov:aoe
d'UI yífi:
&
d'Enée efr tra.vcrfé· par tant
d'ohft:aÓJe~
qu_elles. rdfources. n'a pas id le poece pour varier
ce~
lm d'Oreíle ? Qg'on s'imagine
feulement qu'il par.–
court la mer Egée, oU. fon. pere,
&
tous les, héros: de
la Grece ont écé f1
long,. tems
le jouet des on.des ;
qu'il la parcourt
a
la vue de Scyros ,.
Oll
l'on avoit
caché le jeune Achille ; a la vue de Lemrios, ou Phi–
i.oél:ete avoit été abandonné;
a
la vue de L esbos , ou
les Grc:cs avoieot commencé de lignaler leur. vengean–
ce;
a
la. vue du. rivage de
Tro"ie,
doot
la
ce~drc;
fome encon::; qu'il a l'Hellefpont,, la Propontide
&.
l'Euxin
a.
traverícr pour arriver d'ans la. Tauride.
~d
Je.
carriere pour
le
génie du poete
!'
·
,
Aux incidens nacurels- qui, peuvent retarder' tpur•.
a-
touc.
&
favoriltor l'encrepriíe d'Orelle ,, ajoutez l;
haine des D.ieux ennemis. du fang¡ d'Agameainon ,
I~
faveu~
des Dii::ux. qui le pr.otegent, les. (uries atta,.
chées au x pas d'0reíl:e,
&
qui vieonenc-
l~agiter
tou-
7
tes les fois. c¡u' il veut s'oublier dans. les. plaillrs.
OL\·
daos le rtpos. Tous ces. agens fornaturels, vont me.
kr
a
l'afiion
du. poeme un merveilleux. déja· fondé fui;
la vérité relative,
&
adopté par l'oei nion.
Cependant Thoas. épouv.anté par la voix. des Dieux,
q_ui lui préfage qu'un. etrangec lui
~rrachera
jle fceptrc;
&
la
vie,
Thoas. ordonne- que. tous ceux que leur
mauvais. forc ou leur mauvaü delfein ameneront. dan&
la.Tnuride ,. folent
immolé~.
for l
'a.ucel.deO iane.
Iphi~
génie en eíl:. la precrelfe ;. elle a horreur de ces facri–
fices ;.
&
apres. avoir employé tout ce que· l'humanité
a. de plus cendre,
&
la religion de plus.
t.ol!chant poui.–
fiécliir !'.ame dl11 tyran :· ,,.Non , lui. die - elle, Dianc;
,, n'eíl: point une divinicé fanguinaire,
&
qui le fai;
,,. mieux: que
moi ? ,,
Alors elle luí raconte, comment
deíl:inée elle-méme
a
em: immolée fur fon autel ,. elle¡
a été enlevée par cecee divinité bienfaifante.. ,,.Jugez,.
,,. conclot Iphigenie ,. li D iane feplairoit a voit: couler
,, un faog qu'elle ne demande-pas , , p.u.ifr¡_u'elle n'a pu
,,. veir répandre
Je
fang: qu'elle avoit demandé par
,,, la
voix_
meme: des oracles ,, .. Le ry,ran per!iíl:e. Oref–
te
&.
Pylade- a
bor.deot dans, fes états ; ils fon
t.
arretés,
conduits~
a
!~a
li.te);
&
le·
poerne el\: terminé. par
~a
trag~die
d'
Ettri
pide·,
dont
je
n'ai. fait jufq,u'ici que dé-
vélopper l'allant . fcene..
,
•
,,.
,
On voit par· cet exemple, que
1
a[/ion
de
1
epop_ee.
n'eíl:. q_Lle
l'atlion
de la
trag~die
plus étendue
&
prifc;
de pi us loirr..
.
..
•
Le Talfe- ne peníoit pas ainfi.
Ir
poema- erozco,
dtt-
il ,,
e
una· imitazione d'azione itlttjlre, grande e perfetla,
fp.tta• narr:ando• con altijfjmo ver/o
1
a fine di muovtr gli
animi con- la- meraviglia·,, e di giovar dilettando.,
I_L regar–
de- le merveilleux comme la fource du pathetiq_ue
~e
l'épopée ;
&
lailfant
a
la tragédie la tetreu_r
~
la p1-
tié " il réduic-
le-
poeme héro"ique
a
l'adnurat1on, ' le
plus freid. des fentiments de l'ame.
S~ il
eut mis fa theo–
rie en· pratique fon poeme n'auroit pas
_ca~.t
de
charmes. QJd que adrniration qu'infpire l'hero1frne
>
















